Repenser la doctrine d’emploi des forces armées de la RDC :
Privilégier les techniques de contre-insurrection
Par Jean-Jacques Wondo Omanyundu
La présente analyse est un condensé extrait de notre deuxième ouvrage Les Forces armées de la RDC : Une armée irréformable », paru au en décembre 2014. Un ouvrage qui fait le bilan de la réforme des FARDC.

La guérilla comme le prototype des guerres menées au Congo
Depuis 1960, écrit El Mahoya Kiwonghi, la forme des guerres la plus en action au Congo est la « guérilla » où les techniques ou tout simplement la philosophie de la guerre asymétrique est employée. Depuis les rebellions des années 1960 en passant par les deux guerres du Shaba (aujourd’hui Katanga) et les invasions des années 1990, les armées du Congo font face à l’asymétrie, avec un bilan discutable. Nous nous sommes toujours demandé pourquoi les expériences de la guerre du Vietnam ou de l’Afghanistan n’ont jamais été la source d´inspiration dans la formation des officiers congolais? Pourquoi les connaissances militaires dans le domaine de la contre-insurrection, de l’anti-guérilla, etc. ne figurent pas en bonne place dans l’idéologie militaire de la RDC? Et pourtant, dès 1960 Mobutu était parmi les premiers parachutistes congolais formés en Israël. Il portait « toujours » ses ailes de parachutiste sur son uniforme militaire. Les héros des armées du Congo comme Tshatshi, Ikuku (serpent des rails), Mahele, Budja Mabe, Mamadou Ndala, etc. sont avant tout des membres des unités des forces spéciales.
Ainsi, face à la guerre asymétrique, il faudrait retourner à la source. Est-ce une ironie de l´histoire? Décidément le général Belge qui avait dit que « Avant l’indépendance est égal à après indépendance » pouvait avoir raison. Quand les congolais se rendent compte que la guerre asymétrique est la priorité sur laquelle nous devons trouver une parade, retourner vers la stratégie mise en œuvre pendant les conquêtes des territoires qui deviendront l’EIC est une nécessité. « FOB » (Forward Operating Base) ou base opérationnelle avancée. Ce concept appliqué par les troupes de l’ISAF en Afghanistan est très proche des « postes » mis en place par Henry Morton Stanley au Congo. Exactement comme en Afghanistan, les « postes » FOB, précurseurs de la Force Publique, avaient permis de réduire le temps de réaction des troupes et d’assurer la conquête des territoires en maintenant en permanence les forces de Léopold II. Ce concept a démontré depuis en Irak et en Afghanistan son efficacité dans les opérations de contre-insurrection.[1] »
« Nous citons expressément ce concept de « FOB » afin de faire comprendre que dans un avenir proche quand les experts militaires congolais réfléchiront à la formation des unités de réaction rapide, l´expérience datée de l´EIC peut valablement servir de base de départ. En effet M. Wondo dans son ouvrage Les Armées au Congo-Kinshasa souligne, à la page 440, démontre la nécessité de la « stabilisation » et même plus d’une défense « de proximité« . Il s’agit là des notions qu’on retrouve (aussi) dans l’ouvrage Les Guerres Asymétriques. Si l´expérience d’un pays comme la Colombie se base sur une maîtrise totale de la 3ème dimension avec plus de 70 hélicoptères Black Hawks et des avions Super Tucano, et certainement des drones, la RDC devrait en priorité commencer par la construction des « FOB » dans les zones menacées afin de réduire le temps de réaction face aux menaces asymétriques. Continuer à vouloir défendre l’Ituri ou Goma à partir de Kitona ou Kamina n’a pas de sens. La RDC doit construire des nouvelles infrastructures militaires et s’inspirer des « FOB » mis au point par HM Stanley. Nous devons retourner vers la source de la création de l´EIC afin d´assurer la survie de la RDC comme État[2]. »
« En effet, les troupes Rwandaises ont traversé le Congo de l’Est à l’Ouest avec plusieurs rotations des avions afin de s’emparer de la capitale via la base militaire de Kitona. Ce souvenir triste de la guerre récente au Congo exige une réflexion plus profonde sur le contrôle de la 3ème dimension, c´est-à-dire l´espace aérien du territoire congolais. M. Wondo cite l’expérience de la Colombie dont la stratégie face aux FARC se base sur une grande mobilité des forces spéciales[3]. Ce pays possède plus de 70 hélicoptères Black Hawks. S´il faut se pencher sur le concept « forces de réaction rapide » ou « forces d´intervention rapide« , les congolais devraient observer que les Etats-Unis ont formé un bataillon d’intervention rapide à Kisangani. Bien que les performances de cette unité pendant la récente guerre face au M23 sont positives, le temps de réaction n’a pas été à la hauteur parce que cette unité ne possède ni hélicoptères de transport, ni avions de transport. Nous sommes très loin des années 1980 quand la FAZA (Force aérienne zaïroise) possédait une flotte des Hercules C-130. L’Afrique du Sud qui possède encore quelques vieux Hercules C-130 planifie actuellement la création d´une force de réaction rapide (www.janes.com/article/41966/south-african-army-preparing-immediate-reponse…). Il faudra lire avec attention la manière dont ce pays planifie la création et l’implémentation de cette force en allant consulter le site African defense review (www.africandefense.net/south-africa-airlift-crisis ou encore www.africadefense.net/saafs-options-for-strategic-airlift/).
L’importance de repenser la doctrine d’emploi des forces congolaise et de l’intégrer dans les plans de réforme des FARDC est indispensable pour permettre à l’armée congolaise une mutation stratégique et opératique qui soit conforme à la menace et au milieu où elle est appelée d’agir. Cela est d’autant vrai que le général français Vincent Desportes, commandant du Centre de doctrine d’emploi des forces, recommande la remise en question et l’abandon progressif de la conception classique de la guerre, par le mode frontal et classique de confrontation frontale des armées massives déployées en ligne qu’a forgé le XXè siècle (guerre symétrique ou dissymétrique)[4].
Ce point de vue est également partagé par le capitaine d’origine congolaise, Phil Zongia, de l’armée canadienne. Pour lui : « Au-delà des conflits qui prennent les différentes formes, la guerre elle est de plus en plus asymétrique. Car les conflits ne mettent plus face à face des pays ou des nations, mais des gouvernements ou pouvoirs décadents face à des peuples opprimés. Cela conduit à des mouvements insurrectionnels qui faute des moyens usent de la guerre asymétrique dans laquelle l’ennemi classique disparait et fait place à un ennemi qui ne se dévoile pas mais qui est en même temps présent. L’ennemi peut donc être le vendeur des cacahuètes, l’instituteur du village ou le policier qui réglemente la circulation. Les armes utilisées sont donc létales ou non létales. Les opérations militaires se tiennent ainsi dans un spectre total- Full spectrum Ops[5] ».
M. Kiwonghi parle de l’inutilité de concevoir la doctrine militaire basée sur la guerre conventionnelle. Il cite Martin van Creveld qui, dans son ouvrage La guerre asymétrique et l´avenir de l´Occident. in POLITIQUE ETRANGERE 1/2003 affirme que les « guerres conventionnelles » sont inutiles. Seule la « guérilla » a fait preuve de son utilité et de son efficacité depuis la fin de seconde guerre mondiale. « Nous espérons que les « penseurs » militaires congolais tireront des enseignements de ces guerres au Kivu et vont influencer la formation des officiers et des troupes en RDC dans un futur proche. En RDC, nous continuons de de former et de préparer les officiers et les troupes pour une guerre symétrique qui n’aura jamais lieu au Congo. Les « BEM » (breveté d’état-major) et « TEM » (technicien d’état major) congolais ne possèdent pas suffisamment des solides notions de guerre non conventionnelle. »
Mêmes les armées occidentales qui forment les FARDC migrent progressivement vers l’asymétrie et/ou la guerre hybride
A ce propos, même les armées occidentales, jusqu’il y a peu friandes des techniques de guerre conventionnelle modélisées par Car von Clausewitz (le choc frontal avec des armées en ligne), face à la mutation de la menace, abandonnent progressivement cette stratégie quasi obsolète aujourd’hui, pour recourir aux techniques asymétriques. Le Général français Vincent Desportes, commandant du Centre français de doctrine d’emploi des forces, dit : « progressivement, les facteurs classiques de la puissance militaire, telle qu’imaginée au siècle écoulé, se trouvent remis en cause. La résurgence d’une opposition militaire de blocs ne peut, certes, être exclue et il est possible qu’une confrontation majeure se livre encore au cours du demi-siècle à venir sur le mode frontal et classique qu’a forgé le XXè siècle. En revanche, c’est une certitude que les armées auront demain beaucoup plus souvent à intervenir dans des conflits « gris », sans réelles frontières – entre « combattants » et « non-combattants », entre « extérieur » et « intérieur » – des conflits sans « cibles à détruire », sans adversaires clairement identifiables, des conflits où il s’agira davantage de lutter contre la « nuisance » que d’affronter la « puissance », des conflits où les effets à obtenir tiendront autant de l’immatériel que du matériel. Dans ces circonstances nouvelles, les éléments – hier constitutifs à eux seuls de la puissance des nations et du succès de leurs armes – voient leur pertinence se dégrader. Il faut donc repenser les outils et conditions des succès politiques. » (Cité in Les Armées au Congo-Kinshasa. Radioscopie de la Force publique au FARDC).
Pour s’en convaincre, on voit aujourd’hui les Etats-Unis privilégier le recours aux forces spéciales qu’aux armées classiques (Forces terrestre, aérienne et navale) . L’avantage de ces forces spéciales est leur mobilité et agressivité car capables de harceler l’adversaire à tout moment. Selon Henri Poncet, ancien patron du Commandement des opérations spéciales (COS) françaises, les forces spéciales américaines sont « une quatrième armée avec tout son environnement »(Christian Malis, Guerre et Stratégie au XXIè siècle, Fayard, Paris, 2014).
Conçues pour accomplir de manière totalement autonome des missions à haut risque en environnement hostile [reconnaissance et renseignement stratégique, capture ou exécution d’ennemis (Ben Laden au Pakistan, par exemple), libération d’otages, sabotage, récupération d’armes de destruction massive, assistance à des forces locales amies (exemple la présence d’une centaine de conseillers militaires américains en Ouganda dans le cadre de l’Africom pour aider ce pays à lutter contre la LRA de Joseph Kony)], les forces spéciales sont par définition dépourvues des moyens lourds (chars, artillerie, mortiers, etc) qui permettent aux forces conventionnelles (infanterie, blindée, artillerie, etc) de combattre durablement sur un espace ennemi et de le contrôler. Les soldats « spéciaux » sont eux-mêmes les « irréguliers« , les guérilleros d’une force conventionnelle.
L’emploi effectif des forces spéciales françaises lors des opérations « Harmattan » durant l’invasion alliée de la Libye et « Serval » au Mali en sont des illustrations les plus éloquentes du changement de paradigme doctrinal. Pour les Etats-Unis, l’expansion du rôle des forces spéciales est conforme à leur nouvelle doctrine militaire qui est déjà une doctrine « post-Afghanistan ». Parallèlement au rééquilibrage géostratégique vers l’Asie-Pacifique, l’accent est mis en effet sur la capacité à contrer la menace représentée par des groupes armés extrémistes violents, le plus souvent non étatiques, au moyen-Orient et en Afrique, dans un contexte de « prolifération du nombre d’Etats faibles ou en décomposition ».
Cela suppose de poursuivre des missions ciblées (Yémen, Afghanistan, Somalie, Pakistan notamment), de contre-prolifération, de contre-insurrection, mais en limitant dans toute la mesure du possible l’implication durable de forces conventionnelles désormais conçues comme jouant un rôle de dissuasion, par la dissymétrie (supériorité militaire en matériel) qu’elles créent, du fait de leurs capacités d’intervention massive. comme le prédit Christian Malis, le XXIè siècle a donc toutes les chances d’être un âge d’or pour les forces spéciales.
En termes d’effectifs, pendant que les effectifs militaires américains se contractent ou baissent (notamment pour cause de sous-traitance aux firmes privées), celui des forces spéciales connait une augmentation fulgurante : 65 000 hommes en 2014 contre 54 000 en 1987 et seulement 8 000 à la fin des années 1970. De même le budget militaire des Etats-Unis est passé de 720,3 milliards dollars en 2010 à 618, 7 milliards de dollars en 2013 (Source SIPRI), le budget de l’USSOCOM (US Special Operation Command) a quant à lui quadruplé en dix ans pour atteindre 10 milliards de dollars en 2014. (Christian Malis, Guerre et Stratégie au XXIè siècle, Fayard, Paris, 2014, pp.131-133). La fin de la guerre froide a entrainé une diminution progressive des effectifs des forces armées des Etats-Unis, sans que la présence américaine dans le monde s’en trouve nécessairement réduite. (Barthémémy Courmont et Darko Ribnikar, Les guerres asymétriques, IRIS, PUF, Paris, 2002, p.21).
Pourtant nous avions déjà proposé d’avoir une armée formée au combat asymétrique…
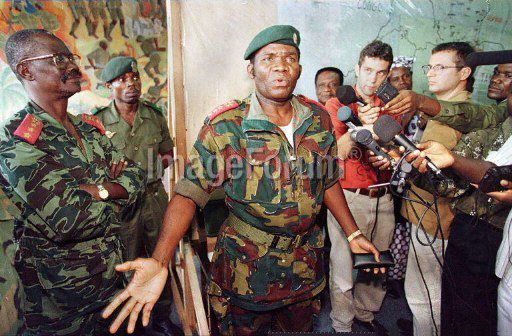
Déjà dans notre premier ouvrage, Les armées au Congo Kinshasa... (pp.439-440), nous avons défendu, compte tenu des similitudes en termes de configuration géographique et de menace asymétrique, la nécessité de constituer l’armée congolaise autour des unités de forces spéciales conçues sur le modèle de la Force de déploiement rapide colombienne FUDRA (Fuerza de Despliegue Rapida), qui entraîne notamment des unités spéciales françaises. Il s’agit d’une force de réaction moderne capable de se déployer dans différents secteurs par tous temps et qui a montré une certaine efficacité dans la lutte contre les FARC. Elle a pour devise : « Quelle que soit la mission, quel que soit l’endroit, quelle que soit l’heure, de la meilleure manière, prêts à vaincre».
A propos de l’option de la formation des unités de réaction rapide, plutôt que le modèle belge actuel des bataillons de réaction rapide (321è, 322è et 323è FRR), qui présente certaines insuffisances en termes de mobilité et d’autonomie des troupes, nous proposons que ces unités soient constituées sur le modèle de l’ex-SARM (Service d’Actions et de Renseignement Militaire) ou de l’ex- 31ème Brigade des troupes aéroportées (Les bérets rouges) du camp CETA (Centre d’Entrainement des Troupes Aéroportées qui comprenait en 1984 une Brigade Parachutiste d’environ 3.400 hommes formés grâce à la coopération militaire française) sous la IIème République, commandées à l’époque par le feu Général Donatien Mahele. Ces unités étaient capables d’aéroporter et parachuter un bataillon entier en tout point du Zaïre en 24 heures. Elles se sont, entre autres, distinguées, en faisant parler leur puissance de feu, leur habilité et leur combativité et ont fait preuve d’une remarquable efficacité dans le conflit de la bande Aouzou au Tchad dans les années 1980 contre la Libye ou lors de la guerre de « Moba I » en novembre 1984 ou encore au Rwanda en octobre 1990, lorsqu’elles ont repoussé les assauts de l’Armée patriotique Rwandaise, la branche armée du FPR. La même armée qui, quinze ans plus tard, en fait voir aux Congolais de toutes les couleurs.
Pour les FARDC, ces nouvelles unités auront pour mission d’être capables de lancer de petites attaques surprises et éclair (blitz), causant de gros dégâts (matériels et humains) et aussitôt stoppées lorsque l’ennemi est en position de faiblesse afin de ne pas permettre à l’ennemi d’être en sécurité permanente en le harcelant sans cesse. Une tactique qui devra porter un coup sur le moral et la combativité de l’ennemi. Pour ce faire, ces troupes doivent posséder une culture tactique appropriée, différente des règles tactiques classiques des troupes régulières. C’est sur cette base opératique que fonctionnent les différents régiments étrangers para-commandos français et a fonctionné l’ex SARM. Il s’agit de forces spéciales composées du personnel hautement qualifié, motivé, suréquipé et surentraîné, capable d’accomplir des missions « spéciales » (comme au Rwanda en 1990) à l’intérieur du dispositif ennemi (forward defense) par des raids, des sabotages, des infiltrations, des missions de reconnaissance (Recce), des assassinats ciblés, des destructions ciblées des sites et matériels stratégiques ennemis, des libérations d’otages ou des récupérations de pilotes battus ou des soldats capturés, des actions de contre-terrorisme, de contre espionnage ou de contre-insurrection en décapitant certains chefs rebelles ou des milices hostiles).
L’effacement de la guerre conventionnelle provoquera la dislocation de la stratégie, au sens clausewitzien du terme, c’est-à-dire que la stratégie du choc frontal; de même que les armes les plus puissantes aujourd’hui, dont l’efficacité dépend largement de l’environnement trinitaire pour lequel elles ont été conçues. (Martin Van Creveld, La Transformation de la Guerre, Ed Rocher, 1991, p.285). Il s’agit d’un environnement qui n’est pas souvent compatible à une menace asymétrique. Pour les armées occidentales, aussi profondément que la crise budgétaire elle-même, c’est la difficulté de penser la stratégie à l’heure des nouvelles asymétries qui menace désormais d’obsolescence les interventions militaires occidentales. Car les modèles de guerre sont aujourd’hui multiples et éclatés (Frédéric Charillon, « Questions sur le coût de la guerre », in Nouvelles Guerres. L’état du monde en 2015, La Découverte, Paris, 2014, p.84).
Une exigence doctrinale qui doit devenir un impératif stratégique national
Lorsqu’on constate que plus des deux-tiers des conflits dans le monde sont asymétriques et se déroulent dans des Etats déliquescents dont la RD Congo est l’épicentre. Cela exige une évolution progressive – si pas révolution – et une adaptation, non seulement aux nouveaux matériels militaires, mais aussi de la formation des troupes et des officiers, à l’évolution des techniques de combat et des procédures de commandement adaptée aux méthodes asymétriques. A cet effet, nous proposons même de mettre à profit les qualités combattantes des pygmées en formant des unités spéciales constituées uniquement de ces populations. En effet, la culture et le mode de vie des pygmées (solidarité, discrétion, détermination, combativité, bravoure et fidélité) sont des atouts capables d’apporter une valeur ajoutée considérable dans les techniques de guerre asymétrique).
Ce changement de paradigme stratégique et doctrinal se fait de plus en plus pressant aujourd’hui lorsqu’on voit une puissance militaire classique régionale de l’Afrique de l’ouest comme le Nigeria, avec une croissance des dépenses militaires de 22% depuis 2002, une armée de 80.000 hommes formés au combat classique et disposant de 250 chars, 78 avions de combat, 1 frégate et 2 corvettes navales, et un budget militaire colossal dépassant les 2 milliards de dollars en 2013[6], s’enlise dans la traque de Boko Haram et incapable jusqu’à ce jour de libérer toutes les 200 filles enlevées et prises en otage par ce groupe terroriste djihadiste. On peut également citer le cas de l’armée kényane, puissance régionale de l’Afrique de l’Est. Une ramée classique qui a étalé devant les caméras du monde entier son impuissante et son incapacité de mettre la main sur les assaillants-identifiés comme étant des miliciens Al-Shabaab, liés à Al-Qaïda- d’un grand centre commercial dans un quartier résidentiel de Nairobi. Une attaque qui a fait 62 victimes pendant un siège armé qui a tenu des dizaines de personnes en otage pendant plusieurs jours en septembre 2013. Ils se sont tout bonnement volatilisés dans la nature au point qu’à ce jour, aucune identité précise de ces assaillants n’est connue des services de sécurité kenyans.
Il s’agit là d’une nouvelle conception de l’Etat, en tant qu’idéal diplomatico-militaire, selon Randolph Bourne, qui le met éternellement en guerre. (Randolph Bourne, La santé de l’Etat, c’est la Guerre, 2012, p. 75) et leur permet d’intervenir unilatéralement où (Afghanistan, Pakistan lors de la capture de Ben Laden…) et quand ils veulent, dès lors qu’ils en ont les moyens. Légitimer le droit d’ingérence – humanitaire ou la responsabilité de protéger – (NDLR : Les forces américaines de l’AFRICOM aux confins du Sud-Soudan, Nord-Est Congolais et Ouest ougandais) ou la nécessaire protection des populations revient simplement à fournir aux pratiques existantes une couverture légale ; bref, un alibi. Les seuls à en tirer une quelconque protection et un profit économique sont les Etats-Unis eux-mêmes et ceux (Rwanda, Ouganda . . . jusqu’à quand ?) qu’ils estiment être du bon côté. (Bourne, 2012, 16).
En tant que stratégie indirecte et technique du faible contre le fort, les guerres irrégulières – guérillas et terrorismes – joueront, dans l’avenir, un rôle majeur[7] dont il faille absolument intégrer dans la doctrine d’emploi des forces de l’armée congolaise, plutôt que continuer à faire du copier-coller des plans de réforme conçus dans des bureaux climatisés occidentaux qui ne tiennent pas compte des spécificités du terrain et qui sont souvent réalisés suivant une conception trop approximative de la vision et de l’appropriation (anthropologique) de la notion de défense nationale par les Congolais.
Cette doctrine d’emploi des forces au service d’une armée républicaine doit être avant tout une affaire des Congolais qui doivent s’approprier (ownership) l’outil militaire en profitant notamment des apports de l’expertise et de l’assistance étrangères adaptées aux besoins propres, aux menaces et à la vision stratégique globale de la RDC : Stratégie globale et Doctrine militaire spécifique appropriées aux contextes géopolitique et géostratégique de la RDC.
Clausewitz disait que la « la guerre est un caméléon » en ce sens qu’elle se transforme à chaque époque et s’adapte à chaque contexte, et que chaque guerre concrète présente une singularité totale. En étudiant l’histoire militaire de la France depuis 1815, le colonel Goya a observé que les forces armées changent tous les dix ans de « mode d’emploi dominant », appelé communément la doctrine d’emploi des forces. Qu’en est-il des FARDC en matière de doctrine militaire ? Existe-t-il une vision de la stratégie générale de la défense ne RDC? De quelle manière cela est-il décliner sur le terrain? Avant qu’il n’yait changement dans l’art de la guerre, il faut donc avant-tout qu’il y ait changement dans la façon de penser et de concevoir la guerre (Joseph Henrotin, Techno-guérilla et Guerre Hybride. Le pire des deux mondes, Ed. Nuvis, Paris, 2014, p.19.
Jean-Jacques Wondo Omanyundu / Exclusivité DESC
[1] El Mahoya Kiwonghi, ibid.
[2] El Mahoya Kiwonghi, ibid.
[3] Wondo Omanyundu, Avril 2013, Jean-Jacques, Les Armées au Congo-Kinshasa., 2è Ed., p.440.
[4] Wondo Omanyundu, Jean-Jacques, Avril 2013, Les Armées au Congo-Kinshasa, 2è Ed., p.385.
[5] Commentaire de l’intéressé in http://afridesk.org/ce-quil-faut-savoir-sur-la-guerre-partie-iv-la-guerre-son-historicite-et-son-evolution-dans-le-temps-jj-wondo/.
[6] http://afridesk.org/strategie-les-quatre-puissances-militaires-regionales-dafrique-jean-jacques-wondo/.
[7] Chaliand, Gérard, Les Guerres irrégulières XXè-XXiè siècle, Gallimard, 2008, p.64.
Autres sources:
Joseph Henrotin, Techno-guérilla et Guerre Hybride. Le pire des deux mondes, Ed. Nuvis, Paris, 2014, 360 p.
Christian Malis, Guerre et Stratégie au XXIè siècle, Fayard, Paris, 2014, 340 p.
Bertrand Badie et Dminique Vidal (Sous la direction), Nouvelles Guerres. L’état du monde en 2015, La Découverte, Paris, 255 p.
Jean-Jacques, Les Armées au Congo-Kinshasa., 2è Ed., 2013, 491 p.
Randolph Bourne, La santé de l’Etat, c’est la Guerre, 2012, 90 p.
Chaliand, Gérard, Les Guerres irrégulières XXè-XXiè siècle, Gallimard, 2008, 980p.
Barthémémy Courmont et Darko Ribnikar, Les guerres asymétriques, IRIS, PUF, Paris, 2002, 282 p.
Martin Van Creveld, La Transformation de la Guerre, Ed Rocher, 1991, 318 p.


5 Comments on “Repenser la doctrine d’emploi des forces armées de la RDC – JJ Wondo”
Gommaire Pelgrims-Ngoy
says:Les mouvements insurrectionnels et ses tactiques sont aussi vieux que la guerre elle-même. La doctrine militaire les définit comme un mouvement organisé visant à renverser un gouvernement constitué par l’utilisation de subversion et de conflits armés. Dit d’une autre façon, une insurrection est organisée, par un ou des groupes politico-militaires pour affaiblir le contrôle et la légitimité d’un gouvernement établi. Elle est reprise au sein d’une large catégorie de conflit connu sous le nom de guerre irrégulière ou asymétrique.
L’insurrection semble être une approche commune utilisée par le faible contre le fort. Au début d’un conflit, les insurgés détiennent généralement l’initiative stratégique et lancent généralement le conflit. Les autorités doivent menée une réaction coordonnée, pour cela les dirigeants doivent reconnaître qu’une insurrection existe et déterminer sa composition et ses caractéristiques.
Les autorités doivent empêcher les insurgés de semer le chaos et le désordre partout, ils ont l’obligation de maintenir l’ordre et de protéger la population et les ressources critiques. En terrain complexe, lorsque les forces négatives emploient des tactiques d’insurrection, la situation change rapidement et il est extrêmement difficile de déterminer l’intention, les capacités et la masse critique de l’ennemi.
En raison de ces changements, les méthodes conventionnelles de recherche de l’information par l’observation et la surveillance ne sont plus suffisantes pour informer l’échelon supérieur des changements dans la situation, et pour donner le signal en temps opportun pour l’intervention des éléments de manœuvre et d’assaut.
Le rôle des unités de renseignement doit donc évoluer pour s’adapter à ces situations. Les unités de renseignement doivent être constituées de patrouilles, et de détachements dotés d’un équipement d’observation et de transmission de grande fidélité et doivent recevoir une formation spécialisée, ce qui permettra à ses détachements d’exécuter des patrouilles de reconnaissance en profondeur dans et derrière les lignes ennemies. Afin de permettre aux autorités d’anticiper l’action de l’ennemi, de déployer les unités d’intervention sur toute l’étendue du pays, et d’en assurer la défense et la protection.
G.P.N.
solange
says:@jjpwondo je ne sais pas combien de fois je lu vos publications. ici je suis un soldat bien formé sans arme.jsui formée par vos reflexions et innoventions dans la recherche scientifique de la defense des peuples harcelees par des inciviques#beni#goma kivu. jsuis tres satisfait surtout de votre ingeniosité patriotique reformationiste d lappareil securitaire rdcongolais. je suis tres fier d vous et de vos collegues dont musavuli que je connais bien.
mwabi K
says:@JJ, combien suis content de t lire, car tu nous amène à l’heure juste, tiens bon et continue de ns infomer…….
Barthélémy
says:Cette analyse confirme que le Congo ne manque aucunement de matière grise dans la science militaire !
Merci Mr WONDO pour vos analyses . Permettez moi d’ ajouter modestement cette réflexion que bien entendu il vous est aisé d’ apporter correctif ou complément ! J’ ai moi même été militaire le temps de mon service obligatoire dans l’ armée française ! J’ en suis sorti gradé ! Je peux vous dire que lorsque l’ on sort de cette expérience, on est prêt à défendre son pays sans crainte et avec bravoure ! En plus, ceci renforce le sentiment d’ appartenance à la communauté pour laquelle vous êtes formé à la guerre ! Le Congo a besoin de créer l’ esprit patriotique dans un cadre de discipline comme l’ armée ! La durée de ce service pourrait être évaluée en fonction des moyens financiers disponibles ! Néanmoins, en aucun cas cette durée ne peut être inférieure à 12 mois ! Cette immersion dans les rangs permettrait de corriger ce que l’ on voit aujourd hui dans les comportements des générations actuelles des congolais ! Pour les anciens comme moi, il est perturbant de constater une certaine délinquance intellectuelle chez certains de nos jeunes frères et sœurs ! En plus avec l’ expérience professionnelle comme manager dans un grands groupe multimétier en occident , la déception est encore plus grande ! Encore merci et bravo pour vos analyses que je dévore avec grand appétit !
Bobo
says:Peut-on savoir le nom du livre écrit par El Mahoya Kiwonghi ?