Ce texte, très profond et interpellateur, est une libre réflexion d’un intellectuel (Jean-Bosco Kongolo)
L’homme se dispute et se bat contre son semblable depuis la nuit des temps. Dans le temps comme dans l’espace, en famille comme dans des communautés, c’est partout et à chaque instant que des conflits éclatent pour n’importe quel motif, subjectif ou objectif. Certains de ces conflits sont étouffés ou résolus sans le concours des tiers tandis que d’autres, par leur ampleur, finissent par dégénérer gravement au point de forcer les antagonistes à faire usage des armes. Et dès qu’on est en situation de guerre ouverte, plus personne n’est en mesure d’affirmer quand et comment elle va se terminer.
Des combats singuliers et sans armes entre individus, on en est arrivé à des conflits de plus en plus armés opposant des familles, des communautés entières, des peuples et des nations. Du champ de bataille réduit à un espace géographique accessible aux seuls belligérants directs, la guerre a fini par s’étendre sur tout un continent et/ou impliquer toute la planète.
La création de la Société des Nations (SDN) après la première guerre mondiale avait suscité de l’espoir que plus jamais un conflit d’une telle ampleur universelle ne viendrait perturber la paix et mettre en péril l’humanité. C’était sans compter avec la folie humaine. Car, en effet, juste deux décennies plus tard avaient suffi pour le déclenchement, presqu’avec les mêmes acteurs, d’un conflit beaucoup plus meurtrier et plus destructif (en termes d’infrastructures). En remplaçant la SDN par l’Organisation des Nations Unies (ONU), les vainqueurs de l’époque, ne privilégiant surtout que leurs intérêts et se croyant les seuls à régenter le monde, n’avaient pas du tout songé au fait que plus tard, les règles contenues dans la Charte des Nations Unies deviendraient obsolètes. Taillée sur mesure, cette espèce de « Constitution mondiale » s’est révélée de plus en plus difficile à appliquer, du fait notamment du droit de véto que détiennent les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et qui paralyse toute action coercitive contre des pays « délinquants » faisant partie de leurs zones d’influence. Il convient d’ailleurs de préciser qu’aucune disposition dans cette charte n’avait été prévue pour empêcher un des membres du C.S. de faire usage du droit de véto lorsque lui-même se trouve dans la situation d’être sanctionné pour violation d’une des règles de la charte.
Tel est notamment le cas de la Russie, désignée comme ayant agressé l’Ukraine mais contre laquelle le Conseil de sécurité est impuissant pour infliger la moindre sanction qui soit coercitive. En vertu du principe « Qui veut la paix, prépare la guerre », la science et la technologie sont chaque jour mises au service de la méchanceté humaine pour fabriquer des engins de la mort et de destruction massive, toujours plus sophistiqués et plus coûteux, pendant que plus de la moitié de l’humanité meurt de faim et ne demande qu’à vivre en paix. Selon Jean-Jacques Wondo, « Au total, les dépenses militaires actuelles des États-Unis et des pays européens occidentaux s’élèvent donc à 1066 milliards de dollars, soit 54 % des dépenses militaires mondiales »[1]
A ce jour, la course effrénée à l’armement sophistiqué a pris une telle proportion que pour se faire mieux respecter sur l’échiquier mondial, il faut s’équiper des armes supposées non conventionnelles (armes nucléaires, armes chimiques ou biologiques). Et cela, même au détriment du bien-être de la population. En cette matière, non seulement que la Corée du Sud et l’Iran causent de l’insomnie aux leaders mondiaux, mais les puissances cyniquement « autorisées » à détenir, on ne sait de quel droit, ces engins destructeurs, ne peuvent plus en faire aisément usage sans conséquences pour elles-mêmes et pour l’humanité entière.

Parmi les conflits, certains peuvent entraîner des conséquences irréparables pouvant rendre ennemis, pour toujours, des frères et sœurs d’une même famille biologique, d’autres, malgré des mobiles apparemment fantaisistes, peuvent déboucher sur le divorce des conjoints, la scission d’une communauté ethnique, le schisme d’une religion, l’effondrement de toute une nation et /ou le déclin d’un État.
Selon que le monde « évolue », les gens se sont battus d’abord corps à corps, puis peu à peu ils ont commencé à se fabriquer des outils massifs de combat ainsi que des moyens de déplacement beaucoup plus rapides permettant d’atteindre aussi loin que possible là où l’ennemi se trouve pour le soumettre ou le réduire au silence. On est ainsi passé de l’arc en flèche à l’arbalète pour en arriver aujourd’hui aux lance-roquettes, aux drones, aux missiles de moyenne et de longue portée intercontinentale, capables d’atteindre n’importe quel coin de la planète, aux bombes atomiques, chimiques ou biologiques capables d’anéantir toute forme de vie sur terre.
En effet, en parcourant l’histoire, l’on se rend malheureusement compte que le problème de la guerre est éternel, que l’on s’entretue à coups de lance, ou de bombe atomique ou humaine. Clausewitz disait que « la guerre est un caméléon » en ce sens qu’elle se transforme à chaque époque et s’adapte à chaque contexte, et que chaque guerre concrète présente une singularité totale. En 1968, Will et Ariel Durand calculèrent que, sur les 3421 années précédentes de l’histoire humaine, seules 268 avaient été vierges de toute guerre. Dans son œuvre intemporelle, De la Guerre, Clausewitz met en évidence l’historicité de la guerre comme un fait sociétal : chaque époque lui donne une forme et un caractère particuliers. Son unité tient dans l’idée qu’elle « non seulement un acte, mais l’instrument même de la politique ». Ainsi, à chaque évolution de l’histoire, le contexte politique du moment s’efforcera de donner à la guerre un sens, une finalité, des arguments, fussent-ils fallacieux, répondant au contexte du moment. Le polémologue Gaston Bothoul avait abouti au triste constat selon lequel l’Histoire nous permet difficilement d’envisager un monde sans guerre[2]. Par exemple, les Etats-Unis ont pu trouver dans les attentats du 11 septembre 2011 un alibi pour déclencher la guerre totale contre le terrorisme (GWOT : Global war on Terrorism), jusqu’à la mener aux confins de la RDC dans la traque des LRA[3].
Ainsi, pour parvenir à leurs fins, des États qui en ont les moyens font continuellement pousser et prospérer sur leurs territoires des industries d’armement dont les budgets peuvent nourrir des générations dans des pays pauvres. Parallèlement à ces entreprises de la mort et de la destruction, des écoles de guerre se sont développées pour former des stratèges et des spécialistes en la matière jusqu’aux plus hautes distinctions académiques. À l’intention de l’opinion publique, il convient de relever que le droit international ne fait pas de la guerre un crime, c’est pourquoi il existe une discipline appelée « Droit de la guerre » ou « jus in bello » pour fixer les règles des opérations militaires autorisées en temps de guerre et dont la violation est susceptible de constituer l’infraction de crime de guerre. « Ceci inclut principalement les cas où une des parties en conflit s’en prend volontairement à des objectifs non militaires, aussi bien humains que matériels. Un objectif non militaire comprend les civils, les prisonniers de guerre et les blessés, a fortiori des villes ne comportant pas de troupes ou d’installations militaires. »[4]
En effet, le jus in bello – comprennat toute une série des règles qui énoncent qu’est-il permis ou non de faire pendant la guerre – est devenu, à partir du XIXème siècle, une composante du droit international humanitaire (DIH) et base de travail des organisations humanitaires comme la Croix-Rouge, le Croissant Rouge, l’Amnistie Internationale, etc.[5]
Aujourd’hui, selon les affinités idéologiques et/ou les intérêts politico-économiques, des relations de coopération se sont nouées entre États, ayant pour objet le commerce d’armes et d’équipements militaires. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il est fréquent que des pays partageant un même espace géographique, culturel, linguistique ou encore les mêmes croyances religieuses soient opposés les uns contre les autres et s’approvisionnent en armes auprès des fournisseurs n’ayant avec eux aucun des liens ci-dessus.
En Afrique, par exemple, dans son analyse de la typologie des formes de tensions et de conflits en Afrique, Jean-Jacques Wondo note que la guerre civile est le type de conflit le plus répandu dans le continent. Il s’agit d’un conflit armé (intra-étatique) qui oppose, à l’intérieur d’un État, des concitoyens entre eux ou des groupes importants (classes sociales, ethnies, mouvements politiques ou groupes religieux d’un même pays)[6].
Dans le passé, les conflits se sont limités à des espaces réduits, circonscrits aux territoires des belligérants. Tel n’est plus le cas actuellement. Grâce ou à cause de la mondialisation, et relativement à la taille d’un ou des belligérants, une étincelle allumée dans un coin éloigné peut facilement et très rapidement se propager pour embraser de grandes étendues, voire toute la planète. C’est ce qu’on observe depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie à l’Ukraine, mais dont les retombées sont mondiales, en raison des céréales, du bois, du pétrole, du gaz ou de l’huile de tournesol dont ces deux pays sont de gros producteurs et exportateurs. La guerre qui se déroule actuellement en Ukraine est révélatrice d’une autre face cachée, mieux de la méchanceté humaine et de l’hypocrisie de la communauté internationale en ce qui concerne le traitement discriminatoire, sinon raciste, accordé aux réfugiés et demandeurs d’asile fuyant les hostilités en Ukraine.
Au-delà des divergences qui opposent « inutilement » ces frères ennemis, l’humanité est une et indivisible, et son fonctionnement harmonieux dépend de l’interdépendance paisible de chaque membre par rapport aux autres. Mais dans la réalité, la nature humaine est ainsi faite que dans le temps et dans l’espace, des hommes surgissent et émergent à la tête des nations pour diriger leurs semblables selon leur perception de la paix ou de la guerre. Aussi, l’état de paix comme celui de guerre sont le plus souvent tributaires des humeurs des individus (dirigeants) dont les antécédents familiaux, le parcours psychosocial, le mode de vie mené (échec ou réussite) et la boulimie du pouvoir poussent certains à créer des troubles, à semer l’insécurité, à soumettre leurs voisins ou à vouloir modifier les règles universellement acceptées pour satisfaire leur égo, sous différents prétextes nationalistes, économiques, religieux, etc. En dépit de multiples traités multilatéraux ou bilatéraux (entre les superpuissances militaires), le droit international n’a pas été d’un concours suffisant pour prévenir efficacement les guerres ou permettre à l’ONU d’imposer la paix ni de freiner la course aux armements. Tout moindre conflit quelque part dans le monde est toujours une occasion pour les fabricants d’armes d’écouler leurs stocks, de tester leurs nouvelles armes et d’innover davantage en vue de supplanter de potentiels concurrents.
Dans cet engrenage, les États moins puissants n’ont eu d’autre choix que de se ranger derrière les superpuissances sous forme de blocs, dans un équilibre toujours précaire dépendant sans cesse des humeurs des leaders mondiaux. Faute de pouvoir s’exprimer d’une seule voix comme les Européens, plusieurs pays africains se sont laissés entraîner dans cette voix clivante, devenant régulièrement le champ fertile d’expérimentation des armes et de la méchanceté humaine.
Il est ainsi facile de constater, notamment à travers les réseaux sociaux, que depuis le déclenchement de la guerre Russie-Ukraine, les intellectuels africains sont partagés entre ceux qui soutiennent l’Ukraine en tant que victime de l’agression et ceux qui applaudissent la force de frappe de l’armée russe, considérée comme une alternative de la puissance américaine. Frustrés par des siècles d’esclavage et des dizaines d’années de colonisation, certains intellectuels africains voient dans cette guerre l’occasion de renverser les rapports de forces et d’assister à l’avènement d’un nouvel ordre économique mondial qui déplacerait le centre de gravité décisionnel des Etats-Unis vers la Russie ou la Chine.
Le Mali et la République centrafricaine n’ont d’ailleurs pas attendu le déclenchement de cette guerre pour afficher leurs options. Ils seront certainement suivis par certains autres. Et pourtant ce ne sont pas des atouts qui manquent à l’Afrique pour favoriser l’éclosion d’un nouvel ordre économique multipolaire, plus équilibré et, pourquoi pas, qui lui serait plus favorable. Il suffirait pour cela que les dirigeants africains soient moins égoïstes, moins populistes dans leur conception et leur gestion du pouvoir, plus solidaires, plus conscients de la richesse et de la diversité des ressources naturelles et qu’ils s’appuient sur une démographie croissante et plus jeune (à mieux former), pour que l’Afrique pèse de son poids réel sur l’échiquier mondial.
Conclusion
Depuis que l’homme vit en société, il court sans cesse derrière la paix, mais en même temps il pose chaque jour des actes de nature à éloigner cette paix. En couple, en famille, dans l’entourage professionnel, au sein ou entre les nations les humeurs des individus sont susceptibles d’engendrer à tout moment des conflits de toute nature. Lorsque ces conflits deviennent ingérables à grande échelle, ils débouchent sur l’usage des armes dont le coût et la capacité de destruction, voire de suppression définitive de la vie sur terre, comparativement aux besoins de survie des populations, qui montrent combien l’être humain est méchant.
La guerre qui se déroule présentement en Ukraine nous a offert l’occasion de nous interroger, en tant qu’intellectuel, sur cette capacité et cette facilité qu’a l’être humain d’éliminer son semblable ainsi que sa propension à anéantir irrémédiablement toute forme de vie sur terre. Il suffit pour cela qu’un détenteur d’armes non conventionnelles soit de mauvaise humeur (éducation) et sans éthique pour qu’en quelques secondes le cataclysme se produise. Et pourtant toutes les religions du monde enseignent quotidiennement l’amour du prochain et la protection de la vie humaine comme une des valeurs fondamentales.
C’est pourquoi nous estimons qu’il ne serait nullement naïf de proposer que la notion de paix soit redéfinie et que la charte des nations unies soit réécrite, cette fois par tous les membres, et qu’ils y soient supprimés le statut de membre permanent du Conseil de sécurité ainsi que le droit de véto. Aux pays africains et asiatiques ainsi qu’à tous les membres non permanents de saisir l’occasion pour léguer à la postérité un monde plus juste, plus équilibré et multipolaire. La survie de l’humanité en dépend. La paix ou la guerre dépend de l’humeur des hommes ayant le pouvoir de décider pour et à la place de ceux qu’ils dirigent.
JB. Kongolo Mulangaluend
Juriste et criminologue
Texte relu et augmenté par Jean-Jacques Wondo
Références
[1] Jean-Jacques Wondo, Comprendre la guerre de Poutine en Ukraine. Afridesk, 4 mars 2022, In https://afridesk.org/comprendre-la-guerre-de-poutine-en-ukraine-entre-realites-et-idees-recues-jj-wondo/.
[2] JJ Wondo, Ce qu’il faut savoir sur la guerre – Partie IV La guerre : son historicité et son évolution dans le temps. Afridesk, 16 août 2014. https://afridesk.org/ce-quil-faut-savoir-sur-la-guerre-partie-iv-la-guerre-son-historicite-et-son-evolution-dans-le-temps-jj-wondo/.
[3] JJ Wondo, Ce qu’il faut savoir sur la guerre – Partie III : La guerre sous ses différentes formes. Afridesk, 8 août 2014. https://afridesk.org/ce-quil-faut-savoir-sur-la-guerre-partie-iii-la-guerre-sous-ses-differentes-formes-jj-wondo/.
[4] Wikipedia, In https://fr.wikipedia.org/wiki/Crime_de_guerre.
[5] JJ Wondo, Ce qu’il faut savoir sur la guerre : Partie III : La guerre sous ses différentes formes. Afridesk, 8 août 2014.
[6] Jean-Jacques Wondo, L’essentiel de la sociologie politique miltaire africaine. Des indépendances à nos jours, Amazon, 2019, pp.123-128. https://www.amazon.fr/Lessentiel-sociologie-politique-militaire-africaine/dp/1080881778.

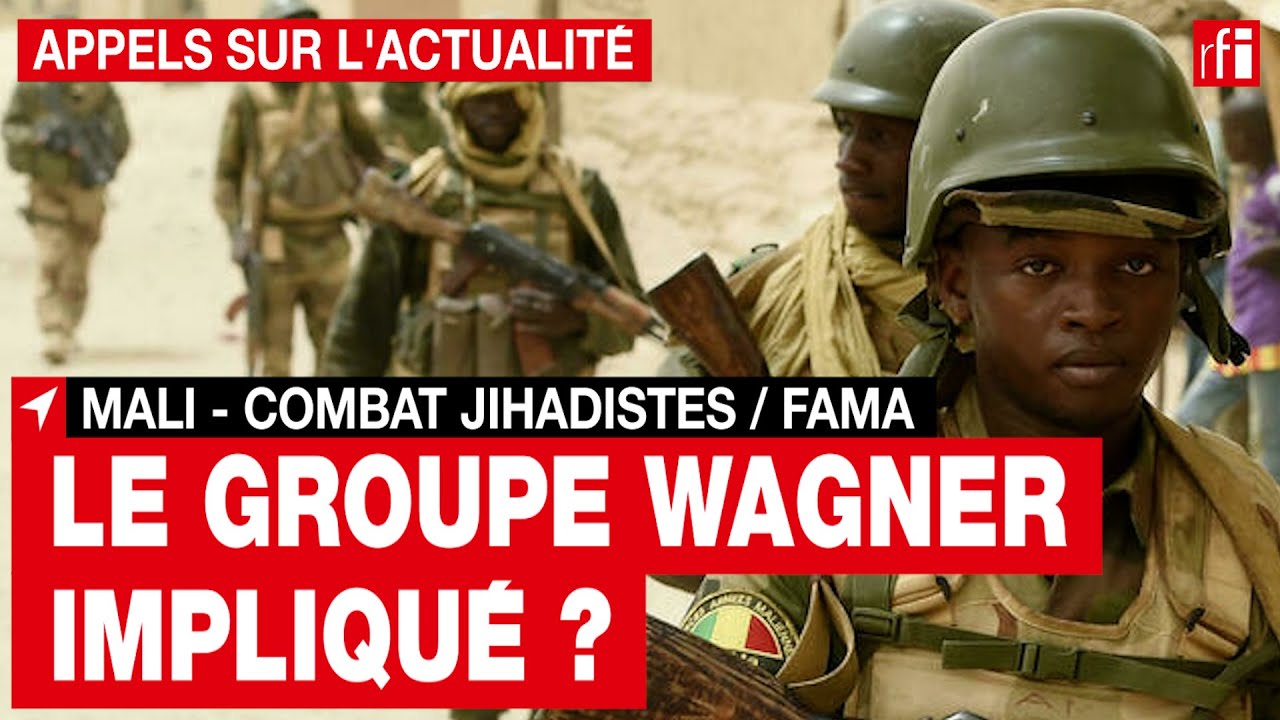

2 Comments on “Réflexion – Guerre Russie – Ukraine : la paix sans armes est-elle possible dans ce monde ? – JB Kongolo”
GHOST
says:« Only the dead have seen end of war » George Santayana
La paix? mais laquelle.. la survie de l´humanité dépend la capacité á faire la guerre. Pour preuve, le président de l Ukraine et son gouvernement ne sont en vie que parce que l´Ukraine fait la guerre et refuse de se coucher en laissant la Russie occuper leur pays.
Nous congolais ne pouvont pas avoir ce luxe de penser á une « définition de la paix » quand notre pays est en guerre depuis 25 ans. La seule source d´inspiration pour les congolais est ce président en Ukraine qui demande de l´aide militaire chaque jour pour combattre la Russie qui bombarde et reduit en décombre son pays.
Tant que le dernier des congolais n´est pas mort, il n´y aura jamais « end of war »..Aucune paix ne peut sécuriser notre peuple tant que nous ne serons pas capables de faire la guerre.
Nsumbu
says:Excellente et nourrissante réflexion sur la guerre et la paix que personnellement je me suis faite dans mon petit coin. Je ne sais si la paix est possible sur cette Terre des hommes, sans armes ou plus exactement sans guerre. L’homme est ainsi fait que son semblable devient un moment son pire ennemi (Homo homini lupus est) et n’hésitera à user des armes pour l’attaquer, se défendre. La guerre comme conflit armé entre des ennemis de toujours ou factuels opposera encore des États ou confédérations d’États et même entre factions dans un même pays, les motifs ne leur manqueront pas…
Ailleurs la Charte de l’Onu nécessite certes de devenir plus démocratique et pourquoi pas avec amendement des droits de véto non plus seulement accordés aux puissants mais empêcher a-t-elle jamais les conflits armés ?A propos de la guerre Russie-Ukraine j’ai commencé par me dire qu’elle n’était pas la nôtre en tant qu’Africains et assimilés mais celle entre puissants et frères mais j’ai vite réalisé que ce n’était pas pour ça qu’elle n’aura pas de conséquences malheureuses sur nos sociétés, nos États. En fait je partage votre vœu d’une paix sans armes et me suis mis dans l’idée d’une planète sans guerre froide ni chaude, érigée davantage sur l’esprit de puissance de deux blocs en concurrence. En ce sens Russes et Américains sont également responsables et coupables de ce qui nous arrive avec cette confrontation.
Comment obtenir une humanité sans guerres, sans prétentions et faits de puissance, comment l’humanité peut-elle se satisfaire d’un multiteralisme intégral qui assure chaque État de ne bénéficier que de ses mérites, que de ses efforts ? Aussi longtemps que Usa, Russie, Chine et autres se prévaudront de leurs titres de puissance géopolitique, économique, militaire, des camps existeront avec leurs risques hélas de collision, pas de possibilité d’un nouvel ordre mondial sans centres de gravité décisionnels et nos bons vœux d’une paix sans armes resteront encore des vœux pieux. Faut-il croire que les pays africains et autres faibles, puissants par leur humanité sauront enfin apporter une éthique humaniste, un monde plus juste et plus équilibré à ce monde miné par la compétition ? A nous de nous en convaincre, de nous unir et d’agir !