Depuis trois décennies, la RDC est le théâtre de l’un des conflits armés les plus meurtriers et les plus longs au monde. Le Sud et le Nord-Kivu, à l’Est du pays, restent des zones de combat où plus de 200 groupes armés nationaux et étrangers opèrent actuellement.
Des années de conflits ont engendré un système d’insécurité auto-entretenue, avec des élites politiques dépendant de cette situation pour survivre, tandis que les citoyens congolais ordinaires aspirent désespérément à un avenir meilleur.
L’impact négatif de ce conflit armé a généré des tensions entre les pays du continent et au niveau international. De nombreuses initiatives ont été entreprises pour instaurer la paix, impliquant divers acteurs nationaux, régionaux et internationaux. Ces conflits ont entraîné l’intervention de consolidation de la paix la plus significative au niveau mondial, ainsi que le déploiement le plus coûteux de missions onusiennes de maintien et de consolidation de la paix : la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO). Pourtant, aucun de ces efforts n’a réussi à mettre fin aux violences ethniques.
Les principaux obstacles aux résultats
Les processus de résolution des conflits se heurtent à plusieurs obstacles aux résultats passés et futurs. Les institutions de gouvernance de la RDC sont instables. Les problèmes du pays sont d’origine interne, alors que les solutions sont souvent importées et ne sont jamais réellement appropriées.
Depuis les années 1960, le pays a bénéficié de la présence de troupes de l’ONU et de nombreuses interventions militaires extérieures. L’euphorie de l’indépendance s’est rapidement transformée en mutineries, rivalités politiques et violences ethniques et politiques internes. Ces problèmes sécuritaires ont conduit à des décennies de déclin politique et économique sous le régime en décomposition de Mobutu Sese Seko.
Il se drapait de peaux de léopard comme symbole de terreur, dissimulant ses échecs derrière un discours nationaliste africain. Il s’est enrichi pendant que la majorité des Congolais voyaient leur pays s’effondrer autour d’eux. Depuis, la classe politique de la RDC a développé un système kleptocratique similaire, avec un style paternaliste et autoritaire, fondé sur un nationalisme ethnique de circonstance.
La corruption est endémique, et le système politique souffre de problèmes chroniques de mauvaise gouvernance. Les intérêts individuels et privés des dirigeants dominent les décisions et entrent souvent en conflit direct avec les institutions de l’Etat et les efforts de stabilisation. La ”politique du ventre”, comme l’explique Jean-François Bayart, est souvent l’objectif dominant des élites politiques. Les espaces politiques qu’ils occupent leur offrent un accès rapide à la richesse, aux privilèges et au pouvoir, dans un système accepté de clientélisme et de prestige personnel et familial. Les luttes entre acteurs politiques découlent de la nécessité de survivre à la précarité, tandis que la culture de la corruption, des conflits d’intérêts et des attentes de faveurs politiques et financières reste omniprésente.
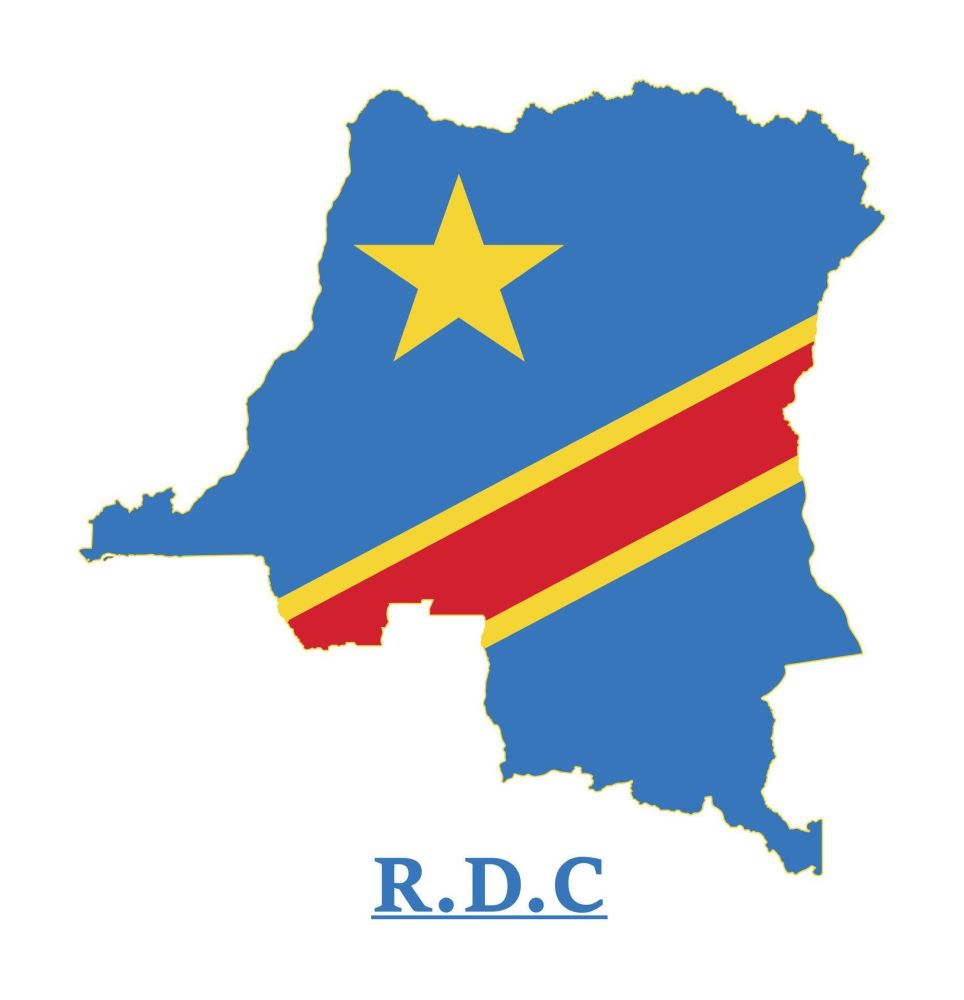
La ”politique du ventre”est souvent l’objectif dominant des élites politiques.
Deux pratiques dominent la gouvernance : (1) le système officiel et formel et (2) le système officieux et informel. Ce dernier est souvent le plus efficace, mais sa nature irrégulière et non supervisée compromet les mesures de lutte contre la fraude et la corruption. Détournements de fonds, surfacturations et rétrocommissions sont monnaie courante, certains les justifiant comme ” parfaitement éthiques et légales”. Cet environnement sophistiqué de corruption entrave les mécanismes d’imposition de la paix.
La rhétorique des élites politiques est généralement non idéologique et clivante. La classe politique n’hésite pas à affaiblir le peuple en appuyant sur le nerf sciatique de la nation, autrement dit en réveillant les sentiments tribaux. Il existe une culture bien ancrée de manipulation de l’opinion publique, tant à l’échelle nationale qu’internationale, par des moyens manipulateurs et trompeurs. Les débats enflammés au parlement national donnent l’impression de simples scènes théâtrales sans fin, où les tribalistes les plus virulents parviennent à séduire l’opinion publique. Les agissements des dirigeants politiques évoquent une foule bruyante dans un marché populaire, avec peu de résultats concrets. Le goût du spectacle et du prestige l’emporte sur la volonté politique de résoudre les problèmes nationaux.
Les élites politiques vont jusqu’à manipuler les tensions interethniques pour renforcer leur pouvoir. Le conflit dans l’Est du pays trouve principalement son origine dans les incohérences et échecs de la gouvernance, ainsi qu’une culture dominante de politiques ethnocentriques exploitant le tribalisme et d’autres formes primitives de racisme au sein des populations noires. Des centaines de groupes armés sont motivés par l’idée de protéger leurs communautés contre des soi-disant ”envahisseurs étrangers”, tandis que les questions identitaires et foncières deviennent des catalyseurs pour mobiliser le soutien populaire ou exprimer des griefs politiques et économiques.
Beaucoup affirment que les dirigeants gouvernementaux sont devenus les principaux générateurs de violences ethniques internes dans l’Est du Congo. Le conflit n’est pas simplement tribal, mais bien le produit d’une politique populiste au niveau du gouvernement central. Ce populisme, conduit par des personnes instruites mais destiné à une population peu éduquée, crée des conditions propices à des crimes odieux : massacres sélectifs, traitements inhumains et dégradants, viols de femmes et d’enfants, violations massives des droits fondamentaux, vols et pillages des biens des civils. Ces crimes sont commis dans un contexte d’acceptation générale de la discrimination ethnique. Les commanditaires et auteurs de ces actes, ainsi que les propagandistes incitant à la haine, agissent sans crainte de rendre des comptes à la justice. Acteurs majeurs du conflit, ils restent incapables de restaurer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire et de réguler les relations sociales entre les groupes ethniques.
Le discours de haine est devenu une forme de norme politique. Le gouvernement congolais, conscient de ses ressources naturelles abondantes, use d’un chantage diplomatique en menaçant de rompre ses relations avec les puissances étrangères qui critiquent son ethnocentrisme et ses discours de haine envers les locuteurs du kinyarwanda ou les Tutsi congolais. Ces missions diplomatiques étrangères sont soumises à une forme de pression visant à les rendre complices des violations des droits humains. Les acteurs internationaux craignent de ”froisser” la RDC, de peur de perdre leurs intérêts économiques, tout en profitant de cette manipulation pour vendre des armes. Mais le peuple congolais ne bénéficie pas de ces accords commerciaux. Au contraire, ces accords paralysent le pays, qui s’enfonce dans l’endettement. Les accords bilatéraux d’intervention militaire n’apportent que peu d’avantages, car l’armée est faible et le gouvernement ne les respecte souvent pas lorsque les partenaires étrangers jugent la RDC peu fiable. Les alliés se désengagent, réalisant que la source du conflit est interne, exacerbée par des discours de haine ethnique et tribale. Le pays est pris dans un cercle vicieux ; les Occidentaux exploitent ce chaos ou évitent de confronter la mauvaise gouvernance, générant ainsi une instabilité permanente.

L’économie politique entretient un climat d’insécurité. Il existe plus de 200 groupes armés, locaux et étrangers, dont les membres sont pour la plupart jeunes. Ces groupes coopèrent, s’affrontent, traversent des crises internes, mais servent aussi d’alternatives sociales, économiques et sécuritaires pour les populations locales. Ces groupes s’appuient sur des liens de parenté avec les communautés locales, qu’ils exploitent également, exerçant une influence sur les élites locales dans leur zone géographique. Ils participent à la vie sociale de la région, assurant ou contrôlant une administration parallèle, parfois au niveau local. De nombreux responsables politiques au niveau central et provincial participent directement à la formation et à la mobilisation de ces groupes armés. Ce phénomène permet de garantir leur visibilité, voire d’obtenir un soutien électoral.
Selon plusieurs rapports, 85 % de ces groupes sont armés avec des munitions financées par des fonds publics ou achetées grâce à la contrebande de minerais exploités dans les mines contrôlées par des leaders politiques. Ces groupes armés tournent leurs armes contre le peuple congolais-la ressource et le capital les plus précieux du pays, qui a déjà perdu l’accès aux fonds publics-mais aussi contre les membres de l’armée nationale. Pourtant, cette armée a été recrutée et formée grâce aux ressources publiques. Paradoxalement, ces groupes sont à la fois alliés et ennemis de tous, formés et entretenus par le système de gouvernance.
L’armée nationale est incapable d’éradiquer ces groupes armés. La taille du pays, combinée aux multiples insurrections, pose un défi énorme aux efforts militaires. A cela s’ajoute une décision gouvernementale prise il y a deux ans, légitimant la collaboration entre l’armée nationale et certaines milices ; une politique introduite alors que les Forces armées de la RDC (FARDC) étaient encore fragiles, manquant de capacité logistique et de discipline pour s’organiser efficacement. Les membres de l’armée, toujours mobilisés selon des lignes locales, ethniques et régionales, sont désorganisés et minés par des conflits de leadership, une logistique défaillante et des salaires impayés. Le mauvais état de l’armée nationale remet en question la volonté de réforme de la RDC et laisse le pays dépendant de ”sauveurs étrangers”.
Une “force de police cosmopolite” coordonnée comme solution
Contrairement aux opinions de nombreux analystes occidentaux, la paix et la stabilité en RDC ne sont pas en échec à cause des tensions ethniques persistantes, de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’implication d’acteurs extérieurs. Ces facteurs sont en réalité des conséquences d’un système gouvernemental central qui produit délibérément un état d’insécurité pour atteindre et maintenir des ambitions personnelles et politiques.
Les processus de paix précédents ont échoué à cause de l’incapacité du gouvernement à faire respecter les accords, du manque de volonté politique et de l’absence de réponse aux causes profondes du conflit. Le gouvernement est un générateur principal de conflits : il crée les conditions idéales pour que des groupes armés non officiels réémergent et opèrent. Il manque aussi une infrastructure permettant de mettre en place une approche inclusive pour réguler les relations sociales, restaurer l’autorité de l’Etat de façon équitable et assurer justice et réconciliation.

En s’inspirant du livre de Mary Kaldor sur les “ nouvelles guerres ”, la solution pour la paix en RDC nécessite une ” force de police cosmopolite” coordonnée : une force régionale, dirigée par des acteurs étatiques, avec le mandat d’appliquer le droit international et de protéger les droits humains, particulièrement lorsque les Etats échouent ou sont incapables de le faire.
Pour les partenaires extérieurs, il est crucial de prioriser la paix et la stabilité en garantissant les droits humains pour tous, comme conditions préalables aux accords sur les minerais avec la RDC. Il existe un argument économique fort en faveur de partenariats avec des pays pacifiques et stables pour l’exploitation des ressources naturelles. Restaurer une paix durable jouera un rôle significatif dans le commerce des ressources naturelles. Créer un environnement stable permettra une exploitation minière responsable, éthique et légale. En retour, cela permettra un développement économique contribuant à une société prospère. Une RDC instable et violente retarde le progrès, déstabilise la région et favorise l’exploitation illégale des mines, la prolifération des groupes armés, le terrorisme, la persécution ethnique et le génocide.
Dr. Alex Mvuka

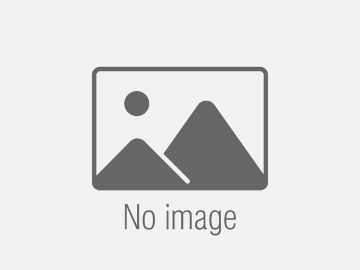
One Comment “RDC-conflits : Pourquoi les accords de paix échouent”
GHOST
says:LE SENS D´UN ACCORD SECURITAIRE AVEC LES USA
L´ère des missions militaires régionale ou internationale est en train de prendre fin en RD Congo. En effet, l´un des objectifs avec la signature sécuritaire entre la RD Congo et les USA vise á obtenir une assistance militaire capable de renforcer les capacités sécuritaires de l´État congolais.
L´ONUC avait été une mission militaire cruciale pour l´existence de RD Congo comme État. Pendant 4 ans, cette mission militaire onusienne avait imposé l´intégrité et l´indépendance du Congo en gagnant la guerre contre la Gendarmerie Katangaise.
https://fr.wikipedia.org/wiki/operation_des_Nations_Unies_au_Congo
La seconde mission militaire onusienne “MONUC” aura presque la même mission dans un contexte de la partition de la RDC avec des invasions des pays voisins de l´Est.
Si la première mission onusienne ONUC était dans le contexte de la Guerre Froide, la seconde mission MONUC/MONUSCO se déroule dans le contexte post Guerre Froide où les pays voisins tentent plusieurs fois d´imposer une partition de la RD Congo en faisant des guerres qui visent les pillages des ressources minérales de l´Est de la RD Congo. Il n´est plus question d´une province qui souhaite obtenir l´indépendance comme le Katanga, mais des armées du Rwanda et l´Ouganda qui occupent le territoire congolais.
Quand la RD Congo est entrain de signer un accord sécuritaire avec les USA, cette option met fin aux interventions militaires de l´ONU et toutes les organisations internationales ou régionales. Les Congolais vont cette fois ici faire ce qu´ils n´ont jamais fait depuis 1960 en trouvant un consensus politique qui définit la politique sécuritaire nationale.
Dès son premier ouvrage “Les Armées du Congo-Kinshasa : Radioscopie de la Force Publique aux FARDC”, le chercheur militaire congolais JJ Wondo attire l´attention des congolais sur les failles des armées sous financées, mal équipées et qui n´ont jamais eu une doctrine militaire moderne.
Le second ouvrage de JJ Wondo “Les Forces Armées de la RD Congo : Une armée irréformable ? : Bilan-Autopsie de la défaite du M-23 – Prospective » apporte des informations stratégiques capables de poser les bases d´une nouvelle armée nationale moderne.
L´accord sécuritaire avec les USA devrait apporter l´expertise nécessaire afin d´apporter des capacités militaires crédibles visant á mettre fin aux interventions militaires internationales ou régionales.
Il existe une vision basée sur les publications de JJ Wondo selon laquelle la RD Congo devrait cesser d´envoyer ses militaires se faire former á l´étranger. Ce concept ne favorise pas l´instauration d´une doctrine militaire unique. Selon cette vision, l´accord sécuritaire avec les USA ne peut pas se limiter á la “sécurisation des mines” á l´Est, au contraire faire bénéficier á l´institution de la défense l´expérience de la Corée du Sud avec la fameuse académie militaire KATUSA https://fr.wikipedia.org/wiki/Korean_Augmentation_To_United_State_Army
Dans le cas de la RD Congo, il est question de s´inspirer du concept KATUSA afin de sélectionner tous les membres de l´armée nationale, de former des académies militaires au Congo, et de construire des infrastructures militaires sur base des menaces extérieures le long des frontières, d´obtenir des équipements et un financement de la défense de la RD Congo. KATUSA: servante de deux maîtres