Ce qu’il faut savoir sur la guerre – 7ème Partie :
Le Leadership militaire et l’art du commandement
Par Jean-Jacques Wondo Omanyundu
Ce texte revu et corrigé a été publié pour la première fois le 5 juillet 2016
Introduction
L’art d’être un bon chef et les méthodes pour y parvenir ont, tout au long de l’histoire, constitué une des préoccupations majeures de nombreux stratèges, tacticiens et philosophes. (. . . ) Le leadership est une qualité indispensable à l’officier. Celui-ci doit assurer constamment le commandement et maintenir l’ordre et la discipline… De plus, l’étude de l’art de commander est un sujet important pour un officier. Pour les officiers belges, durant leurs cinq années d’études à l’Ecole Royale Militaire (ERM), ils apprennent à acquérir une méthode d’expression et à améliorer leur sens de l’autorité. Grâce à cette formation, ils seront plus à même de remplir les tâches futures qui leur seront attribuées tout au long de leur carrière. »[1]
La présente analyse essaye de développer quelques notions de base relatives au leadership militaire et à la stratégie générale d’un Etat.
Quelques définitions
Le leadership militaire peut être compris comme étant une synthèse des qualités d’un bon chef militaire et de l’art du commandement.
Commander, c’est :
- Arrêter nettement dans son esprit ce que l’on veut faire ;
- L’exprimer par des ordres clairs, non équivoques, fixant avec précision les tâches des subordonnés et les moyens dont ils disposent. C’est ce qu’on appelle généralement dans le jargon tactique militaire OSMEALQ[2];
- Veiller à l’exécution des ordres ainsi donnés. Commander, c’est également prévoir et être toujours en mesure de parer à un évènement inopiné[3].
C’est ce qui est connu généralement dans le jargon civil sous l’expression de cycle managérial PDCA (Plan – Do – Check – Act).
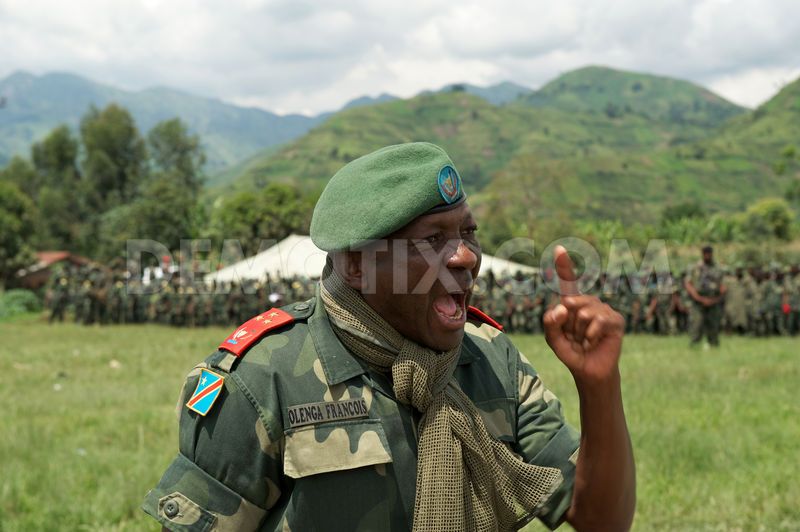
Les qualités d’un bon chef militaire
Pour Platon, « le chef ne doit pas être quelqu’un à qui l’on obéit par le simple fait qu’il appartient à un groupe et que ce groupe lui porte confiance, mais parce que ce chef est l’exemple qu’il faut suivre. »
Machiavel dans L’Art de la guerre quant à lui estime que le leader (le Prince) doit se faire craindre, de telle manière qu’il n’acquière point l’amitié de ses subordonnés, pour le moins il évite leur inimitié. Le prince doit veiller à toujours être en tête, il ne peut jamais se retrouver dans une position basse, dépassé par les autres. Car s’il veut protéger l’Etat et le gouverner, il doit prouver qu’il est le seul l’homme capable de le faire.
Sun Tzu dans L’Art de la Guerre dit : « Généralement, le commandement du grand nombre est le même que le pour le petit nombre, ce n’est qu’une question d’organisation. Contrôler le grand et le petit nombre n’est qu’une seule et même chose, ce n’est qu’une question de formation et de transmission des signaux (= ordres). « Ayez les noms de tous les officiers tant généraux que subalternes ; inscrivez-les dans un catalogue à part, avec la note des talents et de la capacité de chacun d’eux, afin de pouvoir les employer avec avantage lorsque l’occasion en sera venue. Faites en sorte que tous ceux que vous devez commander soient persuadés que votre principale attention est de les préserver de tout dommage »[4].
Machiavel insiste sur le fait que le prince doit défendre son Etat. Il doit tout connaître de l’art de la guerre, car c’est la seule profession que doit connaître quelqu’un qui gouverne un pays : ‘C’est pour avoir négligé les armes et leur avoir préféré les douceurs de la mollesse, qu’on a vu des souverains perdre leur Etat. Mépriser l’art de la guerre, c’est faire le premier pas vers la ruine, la posséder parfaitement, c’est le moyen de s’élever au pouvoir. « Un prince ne devrait avoir autre objet ni autre pensée, ni prendre aucune chose pour son art hormis la guerre et les institutions et science de la guerre ; car c’est le seul art qui importe à celui qui commande »[5]. Et, poursuit-il, un prince qui possède cet art sans posséder d’Etat parviendra la plupart du temps à conquérir un Etat ; tandis que le prince qui possède un Etat sans posséder cet art perdra son Etat. Car pour un Prince, « être armé » ne signifie pas porter une arme ou posséder une armée, mais connaître l’art de la guerre.[6]
Pour devenir un bon guerrier, le Prince devra avoir une formation physique et spirituelle. Au niveau de l’esprit, il devra connaître parfaitement son territoire de façon à le défendre convenablement, il devra étudier les historiens et surtout ceux qui possèdent la science de la guerre. Au niveau physique, il devra s’adonner à la chasse, qui l’endurcira à la fatigue et qui lui apprendra en même temps à mieux connaître son pays ».
Dans sa troisième règle pour acquérir un bon comportement moral, Kant exige ceci du chef : ‘agis comme si tu étais législateur en même temps que sujet dans la réplique des volontés’. Un principe fondamental dans l’attitude professionnelle d’un officier dans la mesure où l’accent y est souvent mis sur l’importance de donner des ordres aux subalternes que l’on est soi-même en mesure de pouvoir les exécuter si on se mettait à leur place. De la sorte, en ayant constamment à l’esprit cette conception du leadership, le risque que l’on puisse donner des ordres qui ne soient pas exécutés ou qui mettent ses subalternes dans l’embarras se réduit considérablement pour tendre vers zéro.
Etre soldat n’est décidément pas un métier ordinaire. Défenseur de la société aux ordres du système politique dans une démocratie le soldat est caractérisé par deux dimensions essentielles. Porteur d’armes, il a le pouvoir de donner la mort au combat, sur ordre. Mis en péril par les armes de l’ennemi, il accepte de donner sa vie pour son pays[7].
La spécificité du soldat est de se préparer à la guerre. Pour cela, il lui faut se former aux armes et aux techniques de combat qui évoluent depuis le 17ème siècle en fonction de la conception et de la nature de la guerre. Le rapport aux armes et à leurs technicités a considérablement évolué depuis deux siècles, obligeant le soldat à préciser ses savoirs, à s’entraîner de manière de plus en plus complexe. En d’autres termes, il lui faut de plus en plus « s’instruire pour combattre » car la guerre reste avant tout une dialectique (ou confrontation) des « intelligences » et non des muscles. N’est-ce pas Sun Tzu préconise-t-il de vaincre son adversaire par la ruse, c’est-à-dire sans le combattre ?
Comme on peut le constater, la formation et l’instruction restent au cœur de l’art du commandement. Le chef doit être instruit et avoir de l’initiative, c’est-à-dire exercer librement son pouvoir discrétionnaire et son activité dans le cadre des ordres reçus de s hiérarchie.
D’où l’importance de l’étude de la « stratégie » dans les écoles de guerre. Le métier des armes s’est diversifié considérablement depuis deux siècles. La césure entre armes combattantes et armes de soutien a été rendue plus opaque. La logistique a pris une importance considérable et aujourd’hui, dans les grandes armées du monde, il y a davantage de logisticiens, d’ingénieurs et de personnels de maintenance, que de combattants portants les armes déployés sur la ligne de front. Nous l’avons expérimenté récemment lorsque nous avons assisté à l’édition 2016 du Salon de la Défense et de sécurité à Paris – Eurosatory – où l’accent était particulièrement mis sur les facilités devant permettre au soldat au front de combattre dans les meilleures conditions.
Dans son ouvrage De la Guerre, destiné non aux philosophes mais bien aux stratèges de terrain et aux praticiens, Clausewitz voulait que son usage serve à la formation intellectuelle et morale du corps des armées, en la personne des officiers instruits par lui. Il devait également constituer un manuel de méditation continue sur le « bon militaire », son ethos (ses règles de vie, ses mœurs). A peine l’ouvrage est ouvert la question du chef de l’armée est adroitement conduite à la frontière de la politique et de la pratique militaire ! Le « bon » général doit rester au fait de la politique conduite par le chef de l’Etat : « il n’est pas nécessaire que le commandant en chef soit un historien érudit ou un écrivain mais il doit être au courant des affaires supérieures de l’Etat ». Si la politique gouverne la guerre, le général, sans faire de la politique, doit s’accorder avec l’expression précise de la politique visée par la guerre. Il lui faut l’intelligence des plus hautes données de l’Etat[8].

Pour Clausewitz, le bon général n’est un général d’opérette. « Ce n’est pas la qualité d’énergie qui le caractérise en premier lieu mais sa capacité d’observer, tant les hommes sous ses ordres que les techniques à utiliser, ainsi que le terrain de manœuvre. Il doit être capable de déceler et recenser les points forts et les points faibles (des hommes, des techniques et des lieux) et d’affûter la stratégie à partir de recensement. En ce sens, le général doit être concentré sur les particularités et les talents de ses hommes. Le maître mot : les impressions relatives à l’empirie (l’expérience), éclairant au besoin des âmes fragiles (la psychologie) et des pays inconnus (la géographie), et la connaissance des découvertes dans les techniques et les sciences. » Le « bon » général pour Clausewitz n’est pas l’homme de plume ou un historien érudit, incapable de pénétrer les circonstances et les traits étranges de la guerre. Toutefois, il a fait des études abstraites, aussi, puisqu’il doit connaître le calcul et les mathématiques : les masses en mouvement, le conflit des forces, l’algèbre de l’action, la mesure des forces, et la résistance. Bien sûr non pas en physicien, ou en mathématicien, mais en chef capable de mobiliser des connaissances techniques (forces, trajectoires, portée d’une arme, déplacements…) dans le cadre de la stratégie[9].
Le général en chef doit disposer de « traces de lumière », d’une intelligence de l’œil, lui permettant de prendre la bonne résolution au bon moment. Chacune de ses décisions doit « toucher juste ». En un mot, le général moderne doit être accoutumé autant à la culture générale, y compris politique, qu’aux événements de la guerre. Il doit être « honnête homme » pour employer une formule bien française, ce qui n’interdit pas de briguer des honneurs, tout en faisant de la guerre son métier, du calcul des moyens sa ressource et de l’effusion particulière aux soldats une certaine passion pour les braves[10].
En bref, le bon général doit se situer à la charnière entre la politique et la capacité d’agir dans la mesure où la politique reste la matrice dans laquelle la guerre se développe en tant que conflit de grands intérêts réglés par le sang. D’autant que la guerre reste fondamentalement une poursuite de la politique par d’autres moyens.
Cela est d’autant plus vrai que le chef de guerre, s’il fait preuve d’assez de prudence, de courage et de talent, peut confondre totalement ses vues avec le chef de l’Etat, dans des moments décisifs où seul compte le renversement de l’adversaire. Mais il rentrera dans son ordre si la guerre évolue vers la stratégie indirecte, quand l’objectif politique l’emporte sur l’opération guerrière. Tout un arsenal de stratégies et de tactiques est alors possible, de la conquête à l’escarmouche en passant par la manœuvre, qui permettra au chef de l’Etat de négocier comme il entend avec son adversaire, si toutefois la guerre est menée comme une guerre limitée[11].
Dans L’art de la Guerre, le stratégiste florentin Machiavel, mettant en lumière les dangers que représentent une armée des mercenaires où les combattants sont indisciplinés, coûteux, imprévisibles et souvent peu efficaces, préconise à la place une armée « nationale » dans laquelle un bon soldat sera donc celui dont le combat pour la cité deviendra un impératif moral beaucoup plus qu’un simple métier. Selon lui, « Tout Etat doit tirer ses troupes de son propre pays. (…) Les étrangers qui s’enrôlent volontairement sous vos drapeaux, loin d’être les meilleurs, sont au contraire, les plus mauvais sujets du pays. » Comme la cité ne peut vivre qu’en canalisant vers le dehors les passions de ses membres, la guerre deviendra la condition de l’Etat, comme l’Etat deviendra celle de la guerre. »[12]
L’art du commandement n’est pas physique mais intellectuel
De Léon le philosophe à Lewal : stratégie = art de commander les armées.
Il y a une différence de nature entre le combat et le commandement. Le combat exige de la force, éventuellement de la ruse, du courage physique, de la discipline.
La tactique est la rationalisation du combat en vue de substituer aux exploits individuels des guerriers l’effort collectif d’une armée soumise à une volonté unique. La tactique est gouvernée par la loi du moindre effort (Carrion – Nisas).
Le commandement est un art qui exige en premier de l’intelligence créatrice (Fuller).
Le stratège n’est plus celui qui combat à la tête de ses hommes, comme le faisait Alexandre, c’est celui qui définit et dirige son armée avec une vue d’ensemble.
Le courage du chef n’est pas d’abord physique, il est surtout intellectuel. Il doit être capable de raisonner et de décider au lieu de se contenter d’exécuter[13]. Beaucoup de combattants héroïques ont été des chefs timorés parce qu’ils étaient incapables d’imaginer (Oudinot).
L’histoire militaire est un cimetière de chefs qui n’ont ni compris, ni agi (généraux français en 1870) ; qui ont compris sans agir (Villeneuve, Gamelin) ; qui ont agi sans comprendre (Joffre, Haig, Falkenhayn, NDLR : Mahele, Mbuza Mabe, Mamadou Ndala, Bahuma). Falkenhayn dans l’après-midi du 2 juillet s’oppose à la décision prise par le commandement de la deuxième armée de modifier la ligne de défense tenue par la 121e division dans le secteur Feuquières-Assevillers, au prix d’un abandon de terrain, en reculant en deçà de l’ancienne deuxième ligne. Il rappelle alors que le premier principe de la guerre de position est de ne pas abandonner un pouce de terrain et, si un pouce de terrain a été perdu, d’engager jusqu’au dernier homme dans une contre-attaque immédiate.

Les grands chefs militaires dont l’histoire a retenu le nom sont rares. Les mêmes erreurs se reproduisent presque mécaniquement à toutes les époques. En RDC, ceci est devenu la règle, ne pas tirer les leçons, ni tenir compte des erreurs du passé.
Cet art du commandement peut être inné, mais les stratèges instinctifs sont rares (Masséna). Il peut s’acquérir par l’expérience, mais celle-ci n’est ni nécessaire (Condé), ni suffisante (le mulet de Frédéric II).
La règle est que cet art du commandement s’acquiert par le travail intellectuel et se perfectionne par l’expérience[14].
Les grands stratèges ont tous subi l’influence d’un maître ou de plusieurs. “Au fond des victoires d’Alexandre, on trouve toujours Aristote” déclarait le général De Gaulle.
Une réflexion juste n’est pas la garantie du succès, mais elle est une précaution contre les erreurs grossières. “La science ne suffit pas à faire de grandes choses mais elle empêche d’en faire de détestables” (Lewal). C’est ainsi que l’improvisation et la légèreté sont bannies en matière de stratégie. La génération spontanée n’existe pas en stratégie ou dans la gestion des affaires de l’Etat.
Il n’est pas de grandes actions suivies qui soient l’œuvre du hasard et de la fortune ; elles dérivent toujours de la combinaison du génie. Rarement, on voit échouer les grands hommes dans leurs entreprises les plus périlleuses… Quand on veut étudier les ressorts de leurs succès, on est étonné de voir qu’ils avaient tout fait pour l’obtenir (Napoléon). Le gain d’une bataille ne dépend pas uniquement du chef, il ne peut y contribuer que d’une partie ; mais faire le plan d’une guerre, le bien suivre, le bien exécuter, l’honneur en est dû sans partage à celui qui commande et qui l’a entrepris (Puységur)
Napoléon : « A la guerre, rien ne s’obtient que par calcul. Tout ce qui n’est pas profondément médité dans les détails ne produit aucun résultat ».
Clausewitz : «Rien ne réussit à la guerre (Ndlr en politique) que ce qui a été mûrement réfléchi et conçu avec une forte volonté ».
En stratégie, la proactivité qui crée l’effet de surprise chez l’adversaire est une des clés de la réussite. Ainsi, dans le domaine de la stratégie militaire, on avance que l’on peut être battu (militairement) mais on ne peut pas être surpris par l’adversaire. La surprise est le fruit de la négligence. C’est ce qui s’est passé avec les services de renseignements civils et militaires de la IIème république sous Mobutu, incapables d’anticiper les menaces à venir. Ainsi, la proactivité – la prospective – permet d’avoir l’initiative des actions et de garder la main. L’enjeu, le défi c’est de PRO-AGIR au lieu de REAGIR. Quand on réagit, on est à la merci de l’adversaire qui dicte les jeux et les règles du jeu et l’adversaire reste toujours un cran de bataille en avance, on court derrière lui souvent de manière inespérée.
La stratégie en tant que science du commandement
L’art du commandement s’acquiert au travers de la formation. C’est le but de l’enseignement militaire supérieur de donner aux officiers une telle formation.
Le général de Lattre a assigné à l’Ecole Supérieure de Guerre, lors de sa réouverture en 1947 une double finalité :
- « d’abord préparer les officiers à l’exercice des fonctions les plus élevées des états-majors supérieurs ;
- ensuite permettre de sélectionner le haut-commandement de l’avenir, en formant des chefs capables de commander ».
Cette double mission se traduit par deux enseignements de nature différente :
- le service d’état-major exige un savoir technique, attentif aux détails, centré sur les moyens, codifié dans des manuels, des instructions et des méthodes ;
- l’exercice du commandement relève d’un savoir spéculatif dirigé vers les ensembles, combinant les moyens et les fins, non codifiable.
Cette science du commandement a un nom, c’est la stratégie
Nous reviendrons en détail dans une analyse ultérieure sur la notion de stratégie et ses dérivés (stratégie politique, stratégie militaire, géostratégie, géopolitique, tactique, etc.).
Déjà à titre d’introduction, il faut comprendre par Stratégie générale pour un Etat, telle que nous l’avons définie dans notre ouvrage Les Armées au Congo Kinshasa (p.374), l’art de concevoir l’utilisation et de mettre en œuvre les éléments de sa puissance pour réaliser les objectifs de sa politique générale. La stratégie générale englobe la stratégie politique, la stratégie économique, la stratégie militaire, etc…
La stratégie générale peut aussi être comprise, selon l’amiral Castex comme « l’art de conduire, en temps de guerre et en temps de paix, l’ensemble des forces et des moyens de lutte d’une nation » ; cette stratégie générale coordonne et discipline les stratégies particulières, celles de divers secteurs de la lutte : politique, terrestre, maritime, aérien, économique, colonial, moral,…[15]
La stratégie est dès lors avant tout et fondamentalement la dialectique des intelligences, dans un milieu conflictuel, fondée sur l’utilisation de la force à des fins politiques. Cela contraste avec l’idée fallacieuse véhiculée en Afrique, celle de la primauté de la pratique sur la théorie. Et l’Afrique noire subit de plein fouet cette propension à agir sans réfléchir au préalable dans un monde où la connaissance devient une ressource incontournable de la puissance.
On peut également définir la stratégie générale comme une combinaison des moyens dans les différents domaines politique, militaire, économique, diplomatique, culturel, environnemental sur lesquels peut agir le pouvoir politique pour atteindre les buts qu’il s’est fixés. Partant de cette définition, les études stratégiques doivent tenir compte des Low Politics autant des High Politics et analyser les aspects sociaux, culturels, écologiques, ou idéologiques, qui contribuent à redéfinir entre autres les problèmes de sécurité[16].
Conclusion
Comme on peut le constater, l’art du commandement ou le leadership militaire ne peut jamais s’improviser, surtout dans un domaine aussi stratégique qu’est celui de la défense d’un Etat.
Le principe du chef est omniprésent dans la culture militaire. Le chef doit être pour ses subalternes un exemple. Il doit savoir commander et trouver le chemin du cœur de ses subordonnées. L’élévation de ses sentiments, l’affection qu’il sait inspirer, sa bonne formation militaire, sa bravoure incontestable, son calme dans les circonstances quotidiennes de la vie, comme dans les périodes de crise, sont des éléments de confiance que le chef inspire à sa troupe[17].
Aujourd’hui, ces principes fondamentaux de leadership ne se limitent pas uniquement à l’art militaire mais s’appliquent également dans les autres domaines des activités civiles. Ce n’est pas pour rien que le management contemporain s’est largement inspiré de la stratégie militaire.
Jean-Jacques Wondo Omanyundu
Sur la même thématique
Ce qu’il faut savoir sur la guerre – Partie VI C’est quoi une doctrine militaire ou une doctrine d’emploi des forces ?- http://afridesk.org/fr/ce-quil-faut-savoir-sur-la-guerre-partie-vi-cest-quoi-une-doctrine-militaire-jj-wondo/.
Ce qu’il faut savoir sur la guerre – Partie 5 : Le terrorisme contemporain est-il une forme de guerre ? – http://afridesk.org/fr/ce-quil-faut-savoir-sur-la-guerre-partie-5-le-terrorisme-contemporain-est-il-une-forme-de-guerre-jj-wondo/#sthash.OxcYJ6Rh.dpuf.
Ce qu’il faut savoir sur la guerre – Partie IV La guerre : son historicité et son évolution dans le temps : http://afridesk.org/fr/ce-quil-faut-savoir-sur-la-guerre-partie-iv-la-guerre-son-historicite-et-son-evolution-dans-le-temps-jj-wondo/.
Ce qu’il faut savoir sur la guerre Partie III : La guerre sous ses différentes formes : http://afridesk.org/fr/ce-quil-faut-savoir-sur-la-guerre-partie-iii-la-guerre-sous-ses-differentes-formes-jj-wondo/.
Ce qu’il faut savoir sur la guerre 2ème Partie : Les causes des guerres : http://afridesk.org/fr/ce-quil-faut-savoir-sur-la-guerre-partie-ii-les-causes-des-guerres-jj-wondo/.
Ce qu’il faut savoir sur la guerre Partie I : Le conflit, la guerre et ses objectifs tactiques et militaires Cas du Rwanda/M23 : http://afridesk.org/fr/strategie-ce-quil-faut-savoir-sur-la-guerre-1ere-partie-rwandam23-jj-wondo/.
Références bibliographiques
[1] BONFANTI, P., NOUICER, M., PAULET, T., VANHAMEE, G., WONDO, O., Le Leadership, Travail pratique de philosophie sociale, Ecole Royale Militaire, 14 novembre 1989.
[2] OSMEALQ : Orientation, Situation, Mission, Exécution, Administration, Logistique et Questions.
[3] François Cochet, Etre soldat, De la Révolution à nos jours, Armand Colin, Paris, 2013, p.61.
[4] L’Art de la guerre, De Sun Tzu à de Gaulle, Vade-mecum des situations conflictuelles, Librio, Paris, 2015, p.24.
[5] Machiavel, Art de la guerre, Traduction par Toussaint Guiraudet, Flammarion, Paris, 1991, p.10.
[6] Ibid., p.10.
[7] François Cochet, Etre soldat, De la Révolution à nos jours, Armand Colin, Paris, 2013, p.9.
[8] Christian Ruby, Clausewitz. De la guerre. Livre I. Sur la nature de la guerre (chapitres 1 à 8), Ellipses, Paris, 2014, p.30.
[9] Christian Ruby, Clausewitz. De la guerre. Livre I. Sur la nature de la guerre (chapitres 1 à 8), Ellipses, Paris, 2014, p.31.
[10] Christian Ruby, Clausewitz. De la guerre. Livre I. Sur la nature de la guerre (chapitres 1 à 8), Ellipses, Paris, 2014, pp.29-30.
[11] Benoît Chantre, Clausewitz. De la guerre. Livre I, Flammarion, Paris, 2014.
[12] Benoît Chantre, Clausewitz. De la guerre. Livre I, Flammarion, Paris, 2014.
[13] Hervé Coutau-Bégarie, Traité de stratégie, Economica, Paris, 2008.
[14] Hervé Coutau-Bégarie, Traité de stratégie, Economica, Paris, 2008.
[15] Amiral Castex, Théories stratégiques, I, p. 251.
[16] Charles-Philippe David, Les Etudes stratégiques, Paris-Montréal, FEDN-Méridien, 1989, p.504.
[17] François Cochet, Etre soldat, De la Révolution à nos jours, Armand Colin, Paris, 2013, p.61.


2 Comments on “Ce qu’il faut savoir sur la guerre – 7è Partie : Le Leadership militaire et l’art du commandement”
GHOST
says:¤ EEBEN BARLOW « FONDATEUR D´EXECUTIVE OUTCOMES »
http://eebenbarlowsmilitaryandsecurityblog.blogspot.se/2017/03/overcoming-the-crisis-in-command.html
Completez cette lecture avec un autre article…afin d´elargir votre vision dans les connaissances du leadership militaire.
http://eebenbarlowsmilitaryandsecurityblog.blogspot.se/2017/03/victims-of-doctrinebecause-book-says-so.html
Partagez votre « comprehension » avec nous.
GHOST
says:Si les liens ne fonctionent pas, daignez consulter le blog d´Eeben Barlow du mois de mars 2017*