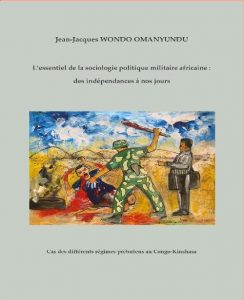 L’essentiel de la sociologie politique militaire africaine
L’essentiel de la sociologie politique militaire africaine
Recension – Préface de Boniface MUSAVULI
Les bouleversements politiques qui se produisent dans les pays africains font apparaître, de façon récurrente, un acteur : l’armée. Qu’il s’agisse de coup d’Etat au Zaïre, des soulèvements populaires en Tunisie ou au Burkina Faso, des guerres civiles au Congo, en Angola, au Rwanda,… l’armée est toujours au rendez-vous et s’affirme comme l’acteur déterminant du maintien de l’ordre politique existant ou du changement des présidents. D’une manière générale, l’image furtive que l’on en garde est celle d’une force organisée de guerre, de répression ou de libération, sans vraiment savoir de quoi sont composées les unités, les effets des dynamiques ethniques internes et les affinités tribales avec les hommes au pouvoir.
Comprendre la physionomie des armées africaines est ainsi l’approche originale que nous propose Jean-Jacques Wondo, afin de décrypter les bouleversements politiques, les instabilités actuelles, les conflits armés et les crises de l’Afrique postcoloniale. Il s’agit aussi d’explorer les défis sécuritaires auxquels les pays africains vont devoir faire face dans un monde confronté aux aléas de la géopolitique et aux agendas des grandes puissances. Des grandes puissances qui font progressivement de l’Afrique le terrain de leurs affrontements pour le contrôle des ressources et des positions stratégiques.
Qui sont les soldats africains et leurs armées dans cet environnement sécuritaire international délicat ? Quel est le poids des antagonismes ethniques et tribaux dans la composition ou les recompositions des forces armées au fil des changements des régimes et des crises politiques internes ? Quels rôles les dirigeants africains donnent aujourd’hui à leurs armées, initialement conçues pour être les outils de défense des acquis des puissances coloniales ?
Au fil des pages, qui se lisent comme une exploration dans le monde des armées, Jean-Jacques Wondo amène le lecteur à répondre à ses propres interrogations en partant des ressources tirées des auteurs qui structurent la pensée classique en matière de sociologie, de géopolitique et de géostratégie. Clausewitz, Weber, Machiavel, Huntington, Fukuyama… sont remarquablement mis en contribution comme des éclairages dans une procession de pionnier sur un terrain faiblement exploré, « la sociologie politique militaire africaine ».
On découvre une Afrique qui s’interroge sur son devenir sécuritaire et même son avenir dans la configuration actuelle de ses armées et la mentalité de ses dirigeants politiques.
Dans cette Afrique, où l’auteur perçoit un vide sécuritaire sur de vastes espaces du territoire national et un faible contrôle des frontières des Etats, tracées par les puissances coloniales, dans l’intérêt des puissances coloniales, les ferments des conflits pré-westphaliens sont bien réels.
« Pré-westphalien », justement, un des nombreux concepts dont l’ouvrage est enrichi au grand bonheur des lecteurs peu habitués au langage militaire. Explorant la typologie des conflits armés sur le continent africain, l’ouvrage rappelle le traité de Westphalie (1648) qui mettait fin à la Guerre des Trente ans et figeait la souveraineté des Etats-nations dans les frontières dessinées par les conquêtes militaires. D’où les concepts de l’ordre « pré-westphalien », dans le cas des nations en quête de contrôle effectif sur leurs territoires, « westphalien » dans le cas des pays ayant acquis la stabilité de leurs frontières. Les Africains dans tout ça ?
Les frontières et les territoires des pays africains n’ayant pas été les acquis des conquêtes militaires, leur remise en question ne saurait être de l’ordre de l’hypothèse. Les conflits entre Etats, directs ou par milices et rébellions interposées, sont une menace à laquelle l’Afrique est exposée. Les Etats africains, malgré l’affirmation du principe d’intangibilité des frontières, ne sont ainsi pas à l’abri des guerres de remise en question des frontières sur l’exemple des conflits ayant précédé les accords de Westphalie et l’utilisation des forces militaires massives dans des batailles décisives entre armées nationales ou l’usure des guerres hybrides des groupes armés instrumentalisés par des puissances étrangères. Un défi d’autant plus réel au vu du déficit de la cohésion nationale et la faillite de l’appropriation, par les nouveaux dirigeants africains, du modèle d’Etat-nation esquissé par les anciennes puissances coloniales.
En effet, les dirigeants africains, n’ayant pas réussi à fondre dans une dynamique de cohésion nationale, les différents groupes ethniques amalgamés dans les frontières héritées de la Conférence de Berlin, l’essentiel des troubles politiques et des conflits militaires se déroule, pour le moment, à l’intérieur des frontières des pays, dans une forme des rivalités hégémonistes des composantes ethniques pour le contrôle de l’appareil d’Etat et la captation des ressources nationales.
D’où la composition des armées dominées pour l’essentiel par les ressortissants d’une même région, d’un même groupe ethnique, voire des natifs du village du président. D’où, également, la création des armées dans l’armée. Au Congo, les différentes armées qui se sont succédé ont été dévoyées de leur mission constitutionnelle pour s’ériger en armées prétoriennes. Sous Mobutu c’était la Division spéciale présidentielle (DSP), sous Laurent-Désiré Kabila, le Groupe spécial de sécurité présidentielle (GSSP) lequel est devenu la Garde républicaine sous Joseph Kabila.
Ces armées dans l’armée, voire dans l’Etat, constituent, d’une manière générale, l’essentiel de l’ossature de défense du pays en termes de capacité militaire. Elles sont composées pour l’essentiel des soldats appartenant au groupe ethnique du président et concentrent parfois plus de moyens militaires que l’ensemble des autres unités de l’armée réunies. La situation de la RDC n’est pas un cas isolé. Au Togo, les effectifs de l’armée proviennent à 77 % du nord du pays et sur ces 77 %, 70 % sont des Kabyens, groupe ethnique du Président, et 42 % sont originaires de Pya, village natal du Président. Au Congo-Brazzaville, on parle de la « Mbochisation » de l’armée, tout comme en RDC, de l’« équatorialisation » des Forces armées zaïroises sous Mobutu et de la « swahilisation » des Forces armées de la RDC (FARDC) successivement sous Laurent-Désiré Kabila et sous Joseph Kabila. De même au Rwanda, l’armée, Rwanda Defence Force (RDF), reste majoritairement monoethnique tutsie.
Protéger le président et les intérêts des hommes au pouvoir apparait ainsi comme étant la principale mission des armées en Afrique, un outil qui permet aux fidèles du régime de s’octroyer un enrichissement, parfois indécent, par une captation prédatrice et égoïste des ressources de l’Etat, entrainant des frustrations dans les communautés exclues des mannes du pouvoir. Ces frustrations constituent un terreau fertile pour des conflits à venir, des renversements violents des régimes et, trop souvent, la reproduction des mêmes logiques patrimonialistes par les nouvelles autorités.
L’accès au pouvoir par la violence est non seulement synonyme de garantie de sécurité mais aussi synonyme d’accès à l’enrichissement facile, ce qui place bien des pays africains dans une situation de stabilité précaire et d’oscillation entre la paix et la guerre, et d’exacerbation des luttes de survie parfois jusqu’à des ruines mutuelles irréparables. Pour protéger leurs privilèges à tout prix, les élites au pouvoir sont souvent tentées par un recours excessif à l’armée jusqu’à la rendre destructrice et contre-productive. C’est le dilemme de l’« Etat faible », un Etat qui, misant sur l’armée pour s’imposer, finit par créer plus de problèmes qu’il n’en espérait régler, à cause d’une utilisation inadéquate de la force brute et le détournement de l’armée de sa mission de défense nationale. Face à ce constat qui tend à se généraliser sur le continent, Jean-Jacques Wondo prône la mise en contribution des acteurs non étatiques pour pallier les limites des Etats et les armées nationales au vu de leurs configurations actuelles.
En effet, ces armées qui apparaissent finalement comme étant des forces de domination tribalo-ethnique, de répression contre leurs propres populations nationales et des outils d’enrichissement des élites au pouvoir, contrastent avec les menaces géopolitiques qui planent sur l’Afrique.
Elles se révèlent inefficaces pour contrer les convoitises des grandes puissances sur « les zones utiles« , rentables économiquement, du continent africain, l’expansion du terrorisme islamiste, mais aussi des menaces sur l’ordre publique internes en raison des frustrations communautaires face à l’échec du modèle d’Etat-nation et l’incapacité des pouvoir publics à répondre aux besoins de la population. L’Etat et son armée ne sont plus en situation de revendiquer le monopole de la mission régalienne de sécurité. Une Gouvernance sécuritaire démocratique devient un impératif impliquant les actions conjointes et coordonnées, dans une approche holistique entre le monde politique, le secteur de la sécurité, la communauté internationale et la société civile. L’implication des différents acteurs vise à créer un environnement sécurisé qui stimule le développement et consolide la démocratie.
L’ouvrage est à la fois une base de recherche originale dans un domaine peu exploré : la sociologie militaire africaine, et le regard d’un militaire – auteur du livre – sur la polémologie[1] allant des stratèges militaires ayant marqué l’histoire, au sort du soldat congolais dans les maquis perdus du Kivu, en passant par le désarroi au Burkina Faso des officiers privilégiés de la garde présidentielle – le Régiment de sécurité présidentielle – qui assistent impuissants à la chute de Blaise Compaoré et la fin de leurs privilèges. Les recherches sur les formes des conflits, la motivation des acteurs des conflits, la périodicité des ruptures de la paix et les actions, parfois inconscientes des acteurs politiques, sont explorées au fil des pages.
L’ouvrage est assorti d’un glossaire enrichissant qui sera particulièrement apprécié par les lecteurs peu habitués aux concepts militaires, sécuritaires et stratégiques. J’ai appris avec amusement la différence entre l’armée et les forces de sécurité, et la subtilité de leurs missions respectives. L’armée assure la défense nationale. Le maintien de l’ordre n’est pas une mission spécifique de l’armée puisqu’elle relève en priorité des forces de sécurité (police, gendarmerie). L’armée n’est mise en contribution que si les forces de sécurité sont dépassées. Un moment d’échange au téléphone avec Jean-Jacques Wondo sur l’utilisation inappropriée des concepts dans bien des écrits. L’occasion aussi de le remercier de m’avoir accordé le privilège de parcourir son manuscrit et de lui proposer cette préface.
C’est un ouvrage très édifiant que l’on finit de lire avec une abondante moisson des connaissances qu’on s’en voudrait de ne pas avoir engrangées si on s’était privé de sa lecture.
Boniface MUSAVULI
Référence
[1] La polémologie, concept inventé par le sociologue français Gaston Bouthoul, qui se résume comme la science de la guerre, présente la guerre, non pas comme une rupture incompréhensible du rythme et de la vie de la société, mais comme la continuation de la politique par d’autres moyens, rappelant Clausewitz.


3 Comments on “Livre : L’essentiel de la sociologie politique militaire africaine de Jean-Jacques Wondo – Recension de B. Musavuli”
GHOST
says:A L´OMBRE DE LA RDC
Bravo á mr JJ qui continue á nous surprendre.. En lisant une recenssion sur l´ouvrage du fondateur d´Executive Outcomes Eeben Barlow ( Composite Warfare: The Conduct of Successful Ground Force Operation in Africa) on tombe sur une question très importante: « How many African military retirees, for example, make an effort to record their experiences of and perspectives on African armed conflict? »
Rares sont les ex militaires africains qui publient leurs réflexions et partagent la lecture qu´ils font de l´évolution des armées quand l´Afrique avance de plus en plus vers la démocratie.
JJ Wondo est une exception parmis ceux des ex militaires congolais qui consacre son temps precieux dans la réflexion et les recherches qui peuvent et vont ameliorer la professionalisation des militaires au Congo.
En attendant de lire l´ouvrage.. Merci d´avance pour cette contribution de plus de sa part and MAKE US PROUD ONCE MORE !
GHOST
says:PARADOXE ?
Pour la première fois depuis 1965, la RDC a un « civil » á la tête de l´État.. Ce que Felix est le second Président civil de la RDC après Kasa-Vubu.
Mobutu ex membre de la Force Publique, LDKabila révolutionaire armé et Kabila junior ex général des FARDC étaient tous des militaires qui avaient besoin d´une « Garde Prétorienne » pour sécuriser leur pouvoir.
Le paradoxe avec Felix est qu´il hérite d´une « Garde Républicaine » dont la mission principale est d´assurer sa protection contre un « coup d´État. Et pourtant le président actuel n´étant un ex militaire et n´ayant pas accedé au pouvoir par la « force » mais par le Canal d´une élection.. même si la victoire est contestée. Oui, Felix apporte plusieures ouvertures pour l´institution de la Défense en RDC.
EBOLA ET GROUPES ARMES
Ceux qui reprochent á Felix d´avoir gardé les généraux de Kabila vont se rendre compte des avantages de cette option. Ce que depuis 6 mois, ces généraux á qui on a laissé les mains libres doivent démontrer de quoi ils sont capables face á l´insécurite á l´Est.
La performance des FARDC (y compris la GR) sera remise en cause d´ici decembre et sur base de ce bilan, Felix aura enfin la possibilité de faire le menage dans l´armée.
Quand les groupes armés attaquent les actions sanitaires qui doivent aider dans la lutte contre Ebola, Felix le commandant suprême « civil » se retrouve en position de force pour « définir » la politique de la Défense qu´il juge necessaire. L´opinion congolaise le rend responsable. Cette pression sur lui va l´obliger á agir tôt ou tard.
La guerre contre les groupes armés va influencer l´avenir de la « sociologie de l´armée » au Congo. Wait and see
GHOST
says:DEFI POUR UN PRESIDENT ?
Le président Felix n´a pas encore atteint le niveau d´IOC (Initial operational capability) pour mieux cerner son travail de « Commandant Suprême » des forces de sécurité au Congo.
Avec le temps, Felix est entrain d´avoir une image réelle de la situation sécuritaire á l´Est. S´il depasse le système de renseignement « bureaucratique » classique, qui diffuse ses informations bien après le moment où elles auraient pu être utiles…Felix devrait « investir » dans un système de renseignement « á jour », « exhaustif » afin de comprendre, de véritablement comprendre les groupes armés et l´environement social dans lequel il faut les combattre.
Le « renseignement » est le premier défi pour Felix. C´est au niveau de la « présidence » où se trouve le commandement suprême des forces de sécurité qu´il doit innover en mettant en place un système de renseignement opérationnels et tactiques á jour. C´est de la présidence que l´impulsion qui doit instaurer une collecte, une exploitation et une distribution efficaces des renseignements et surtout un nouveau cycle information-renseignement-action executé au niveau d´unité le plus bas possible doit se mettre en Place.
FOC (Full operational capabilty)
Felix a certainement besoin du temps pour atteindre le niveau « FOC ».. C´est l´admnistration de la présidence qui doit travailler afin de lui offrir le niveau IOC
COMBATTRE LES GROUPES ARMES
Contrairement aux « militaires » qui ont été des presidents au Congo depuis 1965, la mission primordiale de Felix sera la guerre contre les groupes armés.
Dans une réflexion á publier dans un futur proche, nous allons expliquer pourquoi Felix doit imperativement « optimiser » les FARDC.