Le nationalisme affirme la prédominance de l’intérêt national par rapport aux intérêts des classes et des groupes qui constituent la nation ou par rapport aux autres nations de la communauté internationale. Historiquement, il a pris deux orientations différentes, voire opposées : celle d’un processus de libération visant l’indépendance d’un pays sous domination étrangère (coloniale) ; dans ce cas, il est la prise de conscience d’une communauté de former une nation en raison des liens historiques, sociaux, culturels qui unissent les membres de cette communauté et qui revendiquent le droit de former une nation autonome. Il s’appuie alors sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Mais il peut être également une idéologie dominatrice, xénophobe et raciste, subordonnant tous les problèmes de politique intérieure et extérieure au développement et à la domination hégémonique de la nation, comme ce fut le cas pour le fascisme et le nazisme[1].
Qu’est-ce que le tribalisme ?[2]
Le tribalisme, comme sentiment d’appartenance à une tribu, c’est à dire à un groupement humain ayant en partage une même culture fondée essentiellement sur la langue, est un phénomène culturel ancien, tout à fait normal. Il traduit en chaque homme la conscience de l’identité qu’il porte et des devoirs culturels et moraux liés à cette identité. Du strict point de vue où il concourt à l’affirmation d’une identité culturelle, le tribalisme n’est en rien un vice ni une tare.
Le suffixe « isme » du mot indique la primauté, la première place accordée à quelque chose. En explorant donc la définition de ce mot d’un autre angle, on dirait que le tribalisme est la priorité accordée à une tribu au détriment d’une ou de plus d’une autre. Ainsi en Afrique, on peut définir le tribalisme comme étant lié aux inégalités sociales et politiques ; une source de conflit interethnique basé sur le fait que l’on valorise son identité propre, sa tribu ou son ethnie au détriment de celles des autres.
Son origine
Tout un ensemble d’études révèle que le tribalisme devint un danger en Afrique depuis l’époque de la balkanisation du continent sous l’ordre de colonisation – se créa ainsi des territoires artificiels. Ces nouveaux territoires étaient sous l’influence de leurs pays colonisateurs qui, eux, possèdent différentes vertus, valeurs culturelles et morales… Chacun de ces nouveaux territoires créés valorisait plus sa culture (héritée de sa puissance coloniale) – et c’était au détriment de l’autre.
C’est une réalité aujourd’hui, cette question de tribalisme et de régionalisme en Afrique. Ils se lisent très souvent dans les mentalités et politiques des dirigeants et une faction des citoyens qui se croient supérieurs aux autres : un autre fléau qui freine largement le développement de l’Afrique. Les conséquences directes et indirectes du tribalisme et du régionalisme en Afrique sont énormes et très dévastatrices. Dans des pays où cette pratique est fortement prédominante, il y a un grand lien entre le tribalisme ou le régionalisme et l’inégalité sociale et économique…et donc la pauvreté.
C’est une nouvelle vague de phénomènes qui menace de défaire la démocratie naissante en Afrique, de détruire le développement économique. Le phénomène donne libre cours à des violences interethniques destructrices. La situation actuelle au Katanga entre les partisans de l’UDPS de Tshisekedi et du FCC de Kabila, pourtant partenaires dans une alliance politique postélectorale frauduleuse, illustre cette menace. A cela s’ajoute également la guerre numérique très virulente sur les réseaux sociaux et même dans la capitale congolaise entre les « Talibans », les militants « estrémistes » de l’UDPS, à majorité de la tribu Luba, le parti de Félix Thsisekedi contre les « Mpangistans », les militants des différentes composantes de la coalition de l’opposition Lamuka[3] dont une majorité est d’origine de l’ex-Bandundu et du Kongo-Central. Ce fléau semble être alimenté par plusieurs facteurs. Le leadership politique à la tête des pays africains est lamentable. Le sentiment s’est installé que pour réussir dans beaucoup de pays africains, que ce soit pour un emploi ou un appel d’offres dans le secteur public ou privé, l’élément déterminant est qui l’on connaît, souvent basé sur l’ethnie ou la région plus que ses propres compétences et potentiels.
Un fléau africain ?
Selon Placide Tempels, l’auteur de La Philosophie bantoue : « Pour les Bantous, l’homme n’apparaît en effet jamais comme un individu isolé, comme une substance indépendante. Tout homme, tout individu constitue un chaînon dans la chaîne des forces vitales, un chaînon vivant, actif et passif rattaché par le haut à l’enchaînement de sa lignée ascendante et soutenant sous lui la lignée de sa descendance. On pourrait dire que chez les Bantous, l’individu est nécessairement clanique. Ceci ne vise pas simplement une relation de dépendance juridique, ni celles de la parenté, ceci doit être entendu dans le sens d’une réelle interdépendance ontologique »[4].
Dans le tribalisme se développent des rapports communautaristes en opposition aux rapports sociétaires définis par le philosophe et sociologue allemand Ferdinand Tönnies (1855-1936), un contemporain de Max Weber et d’Émile Durkheim. D’une manière générale, le tribalisme est le plus souvent opposé aux notions d’unité et de cohésion nationales[5].
Le particularisme ethnique peut se transformer en régionalisme qui empêche l’intégration des populations et qui favorise l’éclosion des mouvements sécessionnistes identitaires.
En Afrique, la période transitoire de la dépendance à l’indépendance avait été trop courte et il en résulta une absence de leaders et de partis nationaux, une multitude de partis politiques à assise tribale qui favorisèrent et même renforcèrent les conflits de groupes. Lorsque des partis se sont créés et lorsque des leaders ont cherché à réunir sous leur nom le maximum de partisans, ils ont d’abord fait appel à leur ethnie ou, plus exactement, lorsqu’elles existaient, aux associations tribales. Le rôle des associations tribales dans le développement du nationalisme (tribal) a été essentiel[6].
James S. Coleman en donne les raisons suivantes : « c’est le résultat de la gravitation des éléments évolués, conscients politiquement, autour de leur tribu d’origine, non seulement à cause de la persistance de loyautés et d’obligations tribales ou à la suite de leur réévaluation de la culture africaine, mais aussi parce que la tribu leur procure une base politique relativement sûre, des masses fidèles dont ils connaissent les aspirations, le système de croyances, les griefs et les tensions, donc des groupes auxquels ils peuvent faire appel plus facilement et plus légitimement et qui demeurent facilement manipulables »[7].
Cette situation s’explique aisément : la solidarité ethnique se caractérisant par le fait que le monde auquel s’identifie le commun des citoyens communautaires se limite à sa collectivité immédiate, celle-ci le conduit à considérer que les intérêts de chacun se confondent avec ceux de toute l’ethnie. Sur le plan politique, cette psychologie sociale a pour conséquence d’amener les membres à considérer l’expression politique de chacun d’eux comme étant celle de son groupe et vice versa. Ainsi, l’individu est politiquement militant non par esprit de doctrine, mais parce qu’il appartient à un groupement quelconque qui suit la personne désignée par la communauté. Il en est de même dans l’armée. L’expression politique demeure, de ce fait, de caractère collectif. Ce sont des groupes (ethniques) bien plus que des individus qui s’expriment[8].
L’individu compte peu en Afrique, du moins en tant que tel. Il est absorbé par la communauté. Il n’existe que pour elle et par elle. Les exigences de la famille, les impératifs de la coutume sont supérieurs aux besoins ou aux intérêts de l’individu. Celui-ci n’a qu’à se laisser porter par la communauté, et l’on sait la force du sentiment familial, comme moteur d’activité. Si bien que la volonté individuelle s’estompe : elle est négligée ou sous-estimée[9]. Or le même individu se retrouvant à un niveau de responsabilité politique nationale, censée transcender les appartenances claniques, tribales, ethniques ou régionales, se voit rapidement rattrapé, parfois absorbé, par l’instinct communautariste qui guide désormais ses faits, gestes et son action politique.
Pour le professeur Fweley Diangitukwa : « Les Africains doivent avoir le courage de regarder le tribalisme et d’interroger ses méfaits. Un homme tribaliste reste cloisonné à l’intérieur de sa tribu. Ce qui se passe en dehors de sa sphère ne l’intéresse peu sinon pas du tout. Dans sa vie publique ou privée, un homme tribaliste se préoccupe exclusivement du développement de sa famille, de sa tribu, de sa région d’origine et de sa province ou de son département. La modernisation des autres régions ou du pays dans son ensemble ne l’intéresse pas sinon très peu. Le tribalisme a défavorisé l’éclosion du sentiment national »[10]. Il a ouvert la voie aux cloisonnements ethniques et favorisé le développement de la conscience tribale au détriment de la conscience nationale. Dans ce sens, le tribalisme constitue un frein au développement car « l’Africain reste très attaché à son clan et à son milieu social. Il vit dans une dépendance totale aveugle. Il ne peut rien entreprendre sans l’intervention des siens. Il est très soumis, très dépendant des autres sur qui il compte plus que lui-même[11].
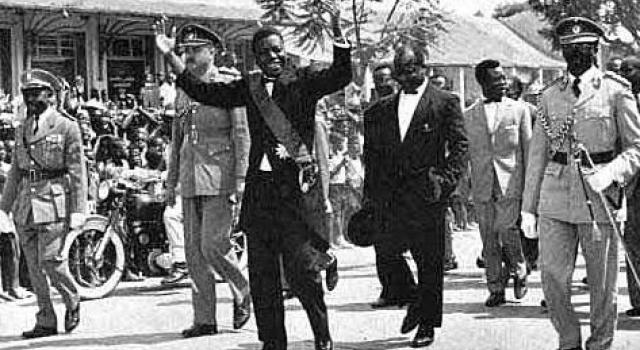
L’Afrique semble être devenue une société basée sur le patronage, ce qui alimente le tribalisme plutôt qu’une société basée sur le mérite. Les cadres des partis politiques au pouvoir pour l’emploi ont été utilisés à des fins opportunistes, tribales ou de factions. Les dirigeants emploient parfois pour des positions clés au niveau gouvernemental, dans leurs cabinets présidentiel et ministériels et dans les grandes entreprises, des amis et des alliés provenant de leur propre région ou communauté ethnique, plutôt que des personnes selon leurs talents et compétences[12]. C’est le cas actuellement en RDC à la présidence de la république, dans les entreprises d’Etat, dans le gouvernement et dans certaines entreprises de l’Etat et dans l’armée.
Le régionalisme et le tribalisme, une bombe à retardement en RDC : gare aux apprentis sorciers
Lorsque le Congo a accédé à l’indépendance, les Congolais ont poussé un grand ouf de soulagement. Mais ce n’était que de courte durée avec les conflits à base régionaliste qui ont mis ce pays multiethnique sens dessus dessous. Certains d’entre nous ont encore en mémoire les conséquences de la thèse du « nationalisme tribal »[13], développée par le professeur Célestin Lumuna Kabuya Sando durant les années Mobutu. Une thèse aux accents haineux et séparatistes, tristement expérimentée par certains leaders katangais véreux de l’époque lors des épurations ethniques des populations Luba du Kasaï qui se déroulèrent au Katanga entre 1991 et 1995. Ce courant idéologique, qui prône l’apologie d’une doctrine apocalyptique xénophobe d’hostilité systématique des katangais à l’égard des Luba du Kasaï, déjà présent lors de la sécession du Katanga dès le 11 juillet 1960, refait subtilement surface au Katanga pendant qu’à Kinshasa on assiste à une instrumentalisation politique des militants des partis sur fond de la fausse victimisation tribaliste.
Pourtant, les vrais tribalistes/régionalistes sont plutôt ceux qui prétendent en être victimes. Ils recourent à une subtile stratégie de fuite en avant pour dissimuler leurs pulsions pathologiques tribalistes et régionalistes viscérales. Les victimes d’hier de ce fléau deviennent les fervents adeptes et apologistes laudateurs de cette pratique éhontée. Nous ciblons particulièrement certains « intellectuels » devenus des leaders d’opinion aux relents tribalo/régionalistes, dont l’analyse de leurs déclarations publiques révèle que l’esprit critique laisse place à un fanatisme primaire et abrutissant aux effets dévastateurs dans un proche avenir si rien n’est fait pour stopper cette escalade dangereuse.
Le Congo court un danger imminent avec une élite dirigeante et intellectuelle inconsciente, irresponsable et obnubilée dans une sorte de tribalisme dogmatique dont on perçoit les premiers signes néfastes dans les récentes rhétoriques politiques.
Il est temps que le président Félix Tshisekedi se revête du costume d’homme d’Etat dont les actes politiques doivent transcender des postures ethniques manifestées jusqu’à présent dans ses décisions, ses nominations et dans le fonctionnement de son cabinet présidentiel et dans les agissements de ses proches collaborateurs et parents. Ces derniers ont souvent tendance à scander publiquement que c’est leur tour de manger et de profiter du pouvoir en disant de manière ostentatoire « bukalenga mbwetu ». C’est de cette manière qu’il pourra honorer le testament de son père : « Le Peule d’Abord » et non sa tribu car une maladresse politique de sa part risque malheureusement de réveiller les démons du passé.
Jean-Jacques Wondo Omanyundu
Références
[1] https://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/nationalisme.
[2] https://www.contrepoints.org/2014/03/02/158290-afrique-tribalisme-regionalisme-et-developpement.
[3] https://www.jeuneafrique.com/1034821/politique/rdc-sur-les-reseaux-sociaux-la-guerilla-des-militants-ultras/.
[4] Placide Tempels, La Philosophie bantoue, traduit du néerlandais par A. Rubbens, Présence africaine, Paris, 1949, p.74.
[5] JJ Wondo Omanyundu, L’essentiel de la sociologie politique militaire africaine. Amazon, 2019. Disponible sur : https://www.amazon.fr/Lessentiel-sociologie-politique-militaire-africaine/dp/1080881778.
[6] Suzanne Bonzon, Modernisation et conflits tribaux en Afrique noire, Revue française de science politique, Année 1967, Vol. 17, Numéro 5 p. 866.
[7] James S. Coleman, « Current Political Movements in Africa ». The Annals 298, mars 1955, p.102.
[8] Paul Mulemeri Kanamby, in De La décolonisation mentale. Mabika Kalanda et le XXIème Siècle congolais, Sous la Dir de José Tshishungu Wa Tshisungu, Editions Glopro, Toronto, janvier 2016, p.31.
[9] Louis-Paul Aujoulat, Aujourd’hui l’Afrique, Casterman, Parsi, 1958, p.14.
[10] Fweley Diangitukwa, Quand les Africains se réveilleront, le monde changera, Ed. Monde Nouveau/Afrique Nouvelle, Saint-Legier, Suisse, 2016, p.50.
[11] JJ Wondo, L’urgence d’une décolonisation mentale des Congolais : relire Mabika Kalanda – DESC, 24 mai 2017. http://afridesk.org/lurgence-dune-decolonisation-mentale-des-congolais-relire-mabika-kalanda-jj-wondo/.
[12] https://www.contrepoints.org/2014/03/02/158290-afrique-tribalisme-regionalisme-et-developpement.
[13] Kabuya Lumuna Sando, Nationalisme? Tribalisme? La question tribale au Congo (Zaïre), Africa, 1978, 75p.



One Comment “Le tribalisme et le régionalisme en RDC : ne réveillons pas les démons du passé – JJ Wondo”