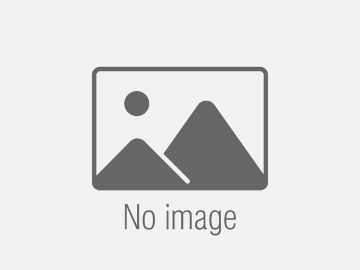Le droit à la santé face au paiement préalable en RDC » : retour sur le drame de Mme Divine K. et l’Arrêté du 17/09/2025, entre avancée normative et appel à réforme anticipative.
Introduction
Dans la nuit du 7 au 8 septembre 2025, à Kinshasa, Madame Divine K., une femme d’une quarantaine d’années, est conduite d’urgence dans un état critique vers deux établissements hospitaliers de référence de la capitale : le Centre Médical Diamant et le HJ Hospital. Son état nécessitait une intervention immédiate, mais l’accès aux soins lui a été conditionné au versement préalable d’une caution de 5 000 USD, somme exorbitante et manifestement disproportionnée au regard de la situation d’urgence. Malgré un acompte déjà versé par sa famille, les établissements ont refusé de procéder à la prise en charge tant que la totalité de la somme n’était pas réglée. Les minutes se sont transformées en heures, et l’urgence médicale s’est muée en drame, privée de soins vitaux, Mme Divine K. a succombé, non pas à sa pathologie, mais à un système qui subordonne la vie humaine à la solvabilité immédiate.
Ce cas a révélé avec une brutalité insoutenable une pratique profondément enracinée dans le système sanitaire congolais : la conditionnalité financière préalable à l’accès aux soins d’urgence. Cette pratique, est devenue une règle tacite « pas d’or, pas de soins ». Elle transforme les services d’urgence en caisses de recouvrement et les médecins en comptables malgré eux. Cette citoyenne est morte non pas de sa pathologie, mais d’un système qui transforme l’urgence médicale en marchandise et la vie humaine en privilège réservé aux solvables. Ce drame, loin d’être un cas isolé, a provoqué une onde de choc nationale et internationale, mettant en lumière l’écart abyssal entre le droit proclamé à la santé et son effectivité.
Les réseaux sociaux, la presse et la société civile se sont emparés du dossier, dénonçant une « mort par refus de soins » et une violation flagrante du droit à la santé. Sous la pression de l’opinion publique, les autorités ont annoncé d’abord, la suspension temporaire des services d’urgence des deux établissements incriminés, mesure symbolique qui traduisait davantage une volonté d’apaisement qu’une véritable réforme structurelle. Puis, par l’adoption de l’Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/SPHPS/SEM/ARR/CJG/OWE/49/2025 du 17 septembre 2025, interdisant désormais tout refus de soins urgents pour des raisons financières. La question centrale est alors de savoir si cette réforme permet de combler le fossé entre la norme et la pratique, ou si elle illustre une fois de plus une gouvernance réactive, incapable d’anticiper les violations.
I. La violation du droit à la santé par la pratique du paiement préalable
La mort de Mme Divine K. illustre un système de santé où l’urgence médicale se mesure au solde du compte bancaire. Les services d’urgence, censés être des lieux de sauvetage immédiat, se transforment en caisses de recouvrement, et les médecins, garants de la vie, deviennent malgré eux des comptables chargés de vérifier la solvabilité des patients avant d’intervenir.
Pourtant, l’article 47 de la Constitution de la RDC consacre le droit à la santé et impose à l’État l’obligation de garantir l’accès aux soins. Ce principe est renforcé par les engagements internationaux de la RDC, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 12) et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 16), qui consacrent le droit de chacun de jouir du meilleur état de santé possible.
En conditionnant l’accès aux soins vitaux à la solvabilité immédiate, les établissements incriminés ont transformé un droit fondamental en privilège marchand. En droit interne, cette pratique engage la responsabilité civile et pénale des structures concernées, le Code pénal congolais (art. 59 et suivants) sanctionnant la non-assistance à personne en danger. De plus, dans le cadre des partenariats public-privé liés à la Couverture Santé Universelle (CSU), les établissements avaient l’obligation contractuelle de garantir la prise en charge des urgences vitales, indépendamment de la capacité de paiement immédiat.
II. L’Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/SPHPS/SEM/ARR/CJG/OWE/49/2025 du 17 septembre 2025 : une avancée normative mais réactive
L’adoption de l’Arrêté ministériel du 17 septembre 2025 marque un tournant dans la régulation du système de santé congolais. Ce texte interdit explicitement à tout établissement de soins, public ou privé, ainsi qu’à tout prestataire de santé, de refuser la prise en charge d’un malade en situation d’urgence médicale vitale, quelle qu’en soit la cause (art. 1).
Il précise que toute urgence médicale vitale doit être immédiatement prise en charge, sans condition préalable de paiement ou de garantie financière (art. 2). L’arrêté définit l’urgence médicale vitale comme une situation où la vie d’une personne est immédiatement menacée si elle ne reçoit pas des soins rapides et appropriés, et la prise en charge immédiate comme l’ensemble des soins nécessaires à la stabilisation du patient et à la préservation de sa vie (art. 3).
Afin d’assurer l’effectivité de cette interdiction, le texte prévoit un régime de sanctions graduées, disciplinaires, administratives (allant jusqu’à la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement fautif) et pénales, notamment pour non-assistance à personne en danger (art. 4). L’Inspection Générale de la Santé est chargée du suivi, du contrôle et de la mise en œuvre effective de ces mesures (art. 5).
Cette avancée normative est indéniable : pour la première fois, un texte réglementaire de portée générale érige en obligation contraignante la gratuité absolue des soins d’urgence vitale, en cohérence avec l’article 47 de la Constitution et les engagements internationaux de la RDC. Il trace une ligne rouge juridique, plus aucun établissement ne peut conditionner la survie d’un patient à sa solvabilité immédiate.
Cependant, cette réforme révèle aussi ses limites. Elle est née d’un drame et d’une indignation collective, non d’une planification anticipative. Elle illustre une gouvernance réactive où la norme est produite après les morts, au lieu d’être conçue pour prévenir les violations. De plus, l’arrêté, en tant qu’acte réglementaire, reste fragile : il dépend de la volonté politique du moment et peut être modifié ou ignoré faute de mécanismes coercitifs robustes.
III. Vers une justice sanitaire anticipative et effective
Pour que l’Arrêté du 17 septembre 2025 ne reste pas un texte de circonstance, il doit être consolidé par des mesures structurelles. Trois propositions peuvent être avancées.
Premièrement, la création d’un fonds national d’urgence sanitaire, financé par une taxe de solidarité ou une dotation budgétaire spécifique, permettrait aux hôpitaux de couvrir immédiatement les coûts des soins vitaux sans attendre le paiement des familles. Ce mécanisme donnerait une assise financière concrète à l’interdiction posée par l’arrêté.
Deuxièmement, le renforcement de l’Inspection Générale de la Santé est indispensable. Dotée de moyens humains, financiers et technologiques, elle pourrait effectuer des inspections inopinées, publier des rapports réguliers et recommander des sanctions exécutoires. Un mécanisme de plainte citoyenne, accessible via une ligne verte ou une plateforme numérique, renforcerait encore son efficacité.
Troisièmement, l’adoption d’une loi organique sur la CSU viendrait consolider l’arrêté en norme législative durable. Cette loi fixerait clairement les obligations des prestataires publics et privés, les droits opposables des patients, ainsi que les sanctions en cas de manquement. Elle permettrait de passer d’une régulation ponctuelle à un cadre juridique stable et contraignant.
Ces propositions visent à transformer l’arrêté du 17 septembre 2025 en un véritable levier de réforme structurelle. L’objectif n’est pas seulement de réagir après les drames, mais de bâtir un système où la protection du droit à la santé est garantie en amont, par des mécanismes financiers, institutionnels et normatifs robustes.
Conclusion
La mort de Mme Divine K. ne doit pas rester un fait divers, mais devenir un catalyseur de réforme durable. L’arrêté du 17 septembre 2025 trace une ligne rouge : plus jamais un Congolais ne doit mourir faute de paiement préalable aux urgences. Mais pour que cette promesse devienne réalité, il faut dépasser la logique réactive et instaurer une véritable justice sanitaire anticipative. Le droit à la santé n’est pas un privilège réservé aux solvables ; il est un droit fondamental, opposable à l’État comme aux prestataires, publics et privés. Chaque minute compte, et chaque refus injustifié est une condamnation à mort prononcée hors de tout tribunal. La RDC doit cesser d’être une République où l’on réagit après les morts, pour devenir une République où l’on protège avant qu’il ne soit trop tard.
Me Joseph YAV KATSHUNG