La mise en liberté provisoire des collaborateurs de Bemba :
Qu’est-ce à dire en droit pénal ?
Par Jean-Jacques Wondo Omanyundu
Dans les colonnes de l’Agence Belga du 22 octobre 2014, on pouvait lire :
« La Cour considère que (…) leur libération était nécessaire pour éviter que la durée de leur détention préventive ne devienne disproportionnée », a déclaré le tribunal de La Haye. (…)
Détenu depuis le 3 juillet 2008 à La Haye, M. Bemba, un ex-chef rebelle devenu vice-président durant la transition en RDC (2003-2006) (…) est actuellement jugé à la CPI pour des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre qu’aurait commis sa milice en 2002 et 2003 en Centrafrique.
L’avocat bruxellois mais d’origine congolaise Aimé Kilolo défend M. Bemba et M. Magenda Kombo est membre de son équipe de défense. Le député et secrétaire général adjoint du MLC, Babala Wandu, a été directeur de cabinet de Jean-Pierre Bemba lorsque ce dernier était vice-président de la RDC, de 2003 à 2006. Ils ont tous trois été arrêtés en décembre 2013. Narcisse Arido, un des témoins cités par la défense, a été transféré devant la CPI en mars.
La CPI avait déclaré lors de leur arrestation qu’elle avait des « motifs raisonnables de croire » que les quatre suspects auraient « constitué un réseau aux fins de produire des documents faux ou falsifiés et de corrompre certaines personnes afin qu’elles fassent de faux témoignages dans l’affaire concernant M. Bemba ».
La remise en liberté des quatre hommes ne signifie pas leur innocence, a précisé la CPI. « En cas de culpabilité, la Cour pourrait décider d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou d’une amende, ou des deux à la fois », a averti la CPI, ajoutant que les suspects « devront comparaître quand cela sera requis ».
C’est quoi une libération provisoire en droit belge (proche du droit français) ?
La libération provisoire est appelée en droit pénal belge, l’alternative à la détention préventive et en droit pénal français, la libération provisoire. Cette libération intervient éventuellement moyennant le respect de certaines conditions imposées à l’inculpé. C’est une décision judiciaire qui intervient au stade présentencielle (avant le jugement) durant l’instruction judiciaire par un juge d’instruction ou une juridiction d’instruction (Chambre du conseil ou chambre des mises en accusation au niveau d’appel pour le cas belge).
Cette mesure concerne une personne placée en détention préventive ou provisoire qui, en droit belge par exemple, remplit un certain nombre de conditions qui ne justifient plus sa détention.
En Belgique , la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, publiée au Moniteur Belge du 14 août 1990 est la base légale relative à la détention préventive (provisoire) et à la mise en liberté sous conditions.
L’article 16 §1 de la loi prévoit : « Le mandat d’arrêt ne peut être décerné que pour autant « qu’il existe de sérieuses raisons de craindre que l’inculpé, s’il était laissé en liberté, commette de nouveaux faits ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers ».
De cette loi découle que, lorsque le détenu inculpé présente suffisamment des motifs sérieux qui prouvent qu’il ne va pas :
- commettre de nouveaux faits ou délits,
- se soustraire à l’action de la justice,
- tenter de faire disparaître des preuves ou
- entrer en collusion avec des tiers ».
Alors le juge ou la juridiction en charge d’instruction peut décider de sa remise en liberté provisoire. Mais la personne reste inculpée (pas libérée définitivement) tout en bénéficiant de la présomption d’innocence.
L’Article 36 § 1 précise :
« Au cours de l’instruction judiciaire, le juge d’instruction peut, d’office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées. La décision de prolongation des conditions est prise avant l’expiration du temps déterminé par le juge d’instruction conformément à l’article 35, § 1er. A défaut, les conditions sont caduques. Ces conditions peuvent être prolongées pour le délai qu’il détermine et pour un maximum de trois mois. »
Par extrapolation aux cas sous question dans cette analyse, notamment dans le cas du Maître Aimé Kilolo, si le juge unique estime que les inculpés mis en liberté préventive ne respectent pas une ou plusieurs conditions ou restrictions qui leur ont été imposées dans le cadre de leur mesure, le juge unique peut, d’initiative ou sur réquisition de la procureur auprès de la CPI, soit révoquer la mesure de liberté provisoire et c’est la case retour à la prison ou en modifier les conditions.
L’Article 38 § 1 stipule :
« Pour l’aide et la vérification relatives au respect des conditions, il peut être fait appel au Service des maisons de Justice du SPF Justice, le respect des conditions d’interdiction étant contrôlés par les services de police. Dans le cadre de la surveillance du respect des conditions, l’assistant de justice du Service des maisons de Justice du SPF Justice, désigné dans ce cadre, rédigera un rapport au maximum 15 jours avant la fin du délai de la mesure de mise en liberté sous conditions. Un rapport intermédiaire pourra être rédigé à tout moment, en cas de non-respect des conditions ou si une difficulté par rapport au respect des conditions apparaît.
Toute personne qui intervient dans la surveillance de l’observation des conditions est liée par le secret professionnel. (…) »
Donc, pour le cas concernant le Maître Aimé Kilolo, c’est un assistant de justice d’une maison de justice de l’arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence qui sera chargé d’assurer sa guidance socio-judiciaire. C’est probablement au sein de la maison de Justice de Bruxelles, où il y a huit ans nous étions assistant de justice en charge de personnes placées en liberté provisoire, sous surveillance électronique (avec un bracelet électronique pour suivre ses mouvements) ou sous libération conditionnelle (pour certaines personnes déjà condamnées et ayant purgé une certaine partie de leur peine en prison).
D’une manière générale, en Belgique, on distingue actuellement :
1°) la détention préventive classique en laissant sous détention l’inculpé qui ne remplit pas les quatre conditions énumérées ci-haut.
2°) Une alternative à la détention préventive, c’est-à-dire une mise en libérté préventive (ou libération provisoire) comme c’est le cas sous analyse ici, assortie souvent de conditions de résider à une adresse fixe, des obligations de suivre soit une formation qualifiante, poursuivre un travail, suivre une thérapie psychologique ou médicale dans le cadre de la consommation des stupéfiants ou d’interdictions d’entrer en contact avec des personnes déterminées (auteurs, co-auteurs, complices dans le dossier sous instruction, ou de fréquenter certains lieux, etc.) et d’autres restrictions ou un certain droit de réserve (notamment dans ses communications en public)
3°) Une détention préventive sous forme de surveillance électronique par le port d’un bracelet électronique mobile (contrôlé par GPS).
L’humanisation de la justice
La philosophie pénale en Europe évolue de plus en plus vers l’humanisation de la justice pénale, notamment la prison, jugée criminogène[1], en faisant de sorte que la prison ou la privation de liberté devienne une solution de dernier recours (« ultima ratio »).
Ces dernières années, le Conseil de l’Europe encourage les États membres à développer les mesures et sanctions appliquées dans la communauté en créant de meilleures conditions de soutien et d’aide au délinquant ainsi que de supervision de celui-ci. La terminologie adoptée par le Conseil de l’Europe appelée : « sanctions et mesures appliquées dans la communauté » signifie des « sanctions et mesures qui maintiennent le délinquant dans la communauté[2] (société) et qui impliquent une certaine restriction de sa liberté par l’imposition de conditions et/ou d’obligations». Elles peuvent intervenir avant la condamnation, à sa place, ou comme modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement, mais doivent comporter une prise en charge et/ou un contrôle par un organisme spécialisé. La privation de liberté se mue progressivement en une solution de dernier recours (« ultima ratio ») alors que les sanctions et mesures appliquées dans la communauté sont de plus en plus privilégiées. Le Conseil de l’Europe considère que le but de la probation est de contribuer à l’équité de la justice pénale ainsi qu’à la sécurité publique en prévenant et en réduisant la commission d’infractions. Il considère en outre que les services chargés de la probation font partie des services essentiels de la justice et que leur travail a un impact positif sur la lutte contre la récidive ainsi que sur la réduction de la population carcérale.
Une pionnière en matière de la promotion des droits des détenus est la professeure belge, Sonja Snacken (VUB : Université Libre de Bruxelles flamande). Pour cette juriste et criminologue de renommée internationale :« Les droits des détenus résultent du fait que le détenu demeure :
- « une personne humaine » (détenteur des droits fondamentaux)
- « un citoyen » (pas de mise à l’écart du reste de la société)
- « un justiciable » (respect de ses droits procéduraux)
- « un usager » (devant bénéficier des services administratifs et sociaux de base offerts à tout citoyen) »
Le recours aux peines et mesures alternatives à la détention répond à une triple finalité :
a) Economique : La prise en charge d’un détenu en prison coûte cher à l’Etat.
b) Pénologique : Lutter contre la surpopulation carcérale et les effets néfastes de l’incarcération. (Nous y reviendrons dans une prochaine analyse s’appuyant sur les critiques de Michel Foucault tirées de son célébrissime ouvrage : « Surveiller et punir » ).
c) Social et humanitaire : permettre à la personne poursuivie de ne pas être déconnectée de la société (maintenir les liens sociaux et familiaux) et de poursuivre ses activités journalières utiles (Travail, formation, etc) moyennant quelques restrictions.
Jean-Jacques Wondo Omanyundu, Criminologue
NB : Certaines analystes estiment que, sur le plan politique, cette libération provisoire (et non définitive) des collaborateurs du Sénateur Jean-Pierre Bemba augure une issue plutôt favorable à l’ancien Vice-président congolais dans le procès où il est jugé à La Haye pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre qu’auraient commis ses hommes (les troupes du MLC) en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Un procès dont l’essentiel de l’enjeu se situe au niveau du Bureau de la Procureure, Fatou Bensouda, et surtout de la la défense du sénateur Jean-Pierre Bemba d’apporter des preuves irréfutables tendant à démontrer clairement que les soldats du MLC n’étaient plus sous la responsabilité militaire et opérationnelle de Bemba, mais bien sous celle du commandement militaire et opérationnelle des forces armées centrafricaines. C’est ce qu’estime en demi-mots le sénateur Jacques Djoli, l’un des avocats de Fidèle Baba, qui s’est félicite de la «conscience» que prend finalement la justice Internationale en ces termes dans une déclaration à la Radio Okapi :«Nous nous rendons compte que la justice Internationale commence à comprendre qu’elle peut être l’objet d’instrumentalisation, et à sortir de cette justice qui était extrêmement politique et peut être, nous espérons que les espoirs placés dans la justice internationale finalement ne seront pas déçus».
Cette impression est confortée par le fait qu’en juin 2014, les instances de la Cour de la CPI ont introduit des requêtes auprès des autorités compétentes de la RDC, de la France, de l’Irlande du Nord, de la Hollande et de la Grande Bretagne de se prononcer sur la requête des collaborateurs de Jean Pierre Bemba du choix de ces pays comme pays comme lieu d’accueil où ils souhaitaient élire leur résidence durant la période de leur éventuelle libération provisoire. Malheureusement, les autorités de Kinshasa ont refusé d’accueillir le député Babala sous prétexte que son retour en RDC allait nuire à la paix sociale et à la tranquillité publique. Le Procureur général de la République Flory Kabange, l’avait signifié au ministre de la justice, Wivine Mumba Matipa via une correspondance alors que cette dernière, dans sa lettre adressée au Procureur général de la République, ne trouvait pas d’inconvénient à que Babala regagne son pays d’origine, la RDC. Finalement la CPI n’a pas suivi l’avis de la RDC et a décidé de libérer provisoirement le député Babala en lui imposant la RDC comme pays de résidence. Il s’agit là d’un signal fort qui pousse plus d’un analyste à penser à une issue favorable du procès Bemba dont la phase des déclarations finales va débuter le 10 novembre pour l’audition des derniers arguments oraux du procureur et de la défense avec la possibilité avec la possibilité que le verdict final tombe à la mi 2015, si aucun retard n’intervient entretemps.
POST-SCRIPTUM : Le Cas Babala : tension juridique entre le Statut de Rome et la Constitution de la RDC
Rappelons que dans une analyse juridique intitulé « Le cas Babala est une opportunité pour explorer la CPI et la Constitution » (http://afridesk.org/maitre-yabili-le-cas-babala-est-une-opportunite-pour-explorer-la-cpi-et-la-constitution/) de Maître Marcel Yabili, juriste spécialisé en droit constitutionnel et en droit judiciaire, avait évoqué la tension juridique entre le Statut de Rome et la Constitution qui a émergé à la suite du transfert rapide du député Babala à la CPI par les autorités congolaises.
Maître Yabili estimait qu’un député frappé d’un mandat d’arrêt de la CPI ne bénéficie pas d’une immunité de poursuites par la CPI. Il a invoqué l’ article 27.2 du Statut de Rome qui stipule : « les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne ».
Toutefois, l’éminent juriste congolais a précisé ceci : « Mais, en matière d’’atteintes à l’administration de la justice’ (Art 70, 4), les procédures nationales valent en matière de coopération, c’ est à dire, d’ arrestation et de transfèrement à la Haye. Pour preuve, dans le dossier de subornation des témoins, où il y a 5 prévenus, la CPI a reconnu aux Pays Bas et à la France de ne livrer les intéressés qu’après accomplissement de leurs procédures nationales »
« Pour le cas Babala, le conflit entre le statut de Rome et la Constitution est apparent. La Constitution n’accorde pas d’immunité autre que temporaire et ne place pas le député à l’ abri des poursuites. En réalité, on a vu que l’assemblée nationale a pu se réunir dans les 24 heures, et on aurait pu lui laisser l’opportunité de voter. Même s’il y avait eu un vote contre le mandat d’arrêt, cela aurait tout juste amené la CPI à demander des poursuites devant les juridictions locales ( Art 70, 4 du Statut de Rome). »
A l’ avenir, conclut Maître Yabili, « s’il surgissait un véritable conflit entre un traité et la Constitution, il existe des mécanismes de contrôle de constitutionnalité des traités par la Cour Constitutionnelle. Le conflit se résout finalement par une révision de la Constitution. Autrement dit, la Constitution prime tant qu’elle n’ a pas été modifiée… »


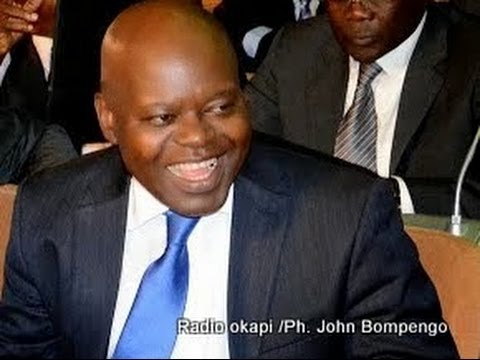

One Comment “La libération provisoire des collaborateurs de Bemba : Qu’est-ce à dire en droit? – JJ Wondo”
Nsumbu
says:Des questions anciennes et nouvelles transparaissent davantage à l’issue de cette libération provisoire des collaborateurs de « l’inculpé » Bemba, je me les pose et surtout les pose aux juristes !
1° Comment la fumeuse « subornation des témoins » a été imputée à une équipe de la défense qui est censée jouir du « secret professionnel » dans le respect des procédures habituelles qui donnent latitude à la défense de constituer ses preuves pour défendre son client à l’abri de l’accusation, étant donné que CPI ou pas, elle constitue bien la partie d’un binôme aux droits équivalents ? Autrement dit le fait par exemple pour la CPI d’avoir écouté « clandestinement » la défense de Bemba est-il légal ? Ne valait-t-il pas une plainte en bonne et due forme de cette dernière devant le Juge ? Si les soupçons de subornation de témoins imputés par « l’accusation » à l’endroit de « la défense » comptaient et devaient se maintenir, n’avaient-ils pas à faire l’objet, à figurer dans le « procès principal » lui-même plutôt que de faire l’objet d’une « infraction annexe » particulière ?
2° A l’issue de cette décision de libération provisoire, Me Kilolo et son équipe peuvent-il continuer à exercer en Conseil de Bemba étant entendu que leur inculpation de subornation des témoins n’ayant pas été cassée des conditions qui ont trait par exemple à « ne pas tenter de faire disparaître des preuves ou à entrer en collusion avec des tiers » peuvent leur être assignées dans le cadre de la « surveillance judiciaire »; à moins que « la présomption d’innocence » leur permette encore d’agir en toute liberté ? Dans le cas contraire ne serait-ce pas là un déséquilibre procédural créé d’autorité au désavantage de la défense de Bemba qui aurait nécessité plutôt que la seule mise en liberté provisoire de statuer une fois pour toutes sur ce délit présumé ?
3° Ne parlons pas du conflit CPI vs Constitution du Congo évoqué ci-haut qui a complètement été laissé de côté alors qu’il nécessitait au niveau des institutions du Congo d’être tranché à moins qu’il ait été à l’avantage exclusif de la CPI et dans ce cas qu’en penser ?
4° Dans l’Affaire Bemba elle-même des questions nouvelles et anciennes surgissent :
Le dépassement du délai « raisonnable » de détention (qui soit dit en passant doit rester une exception et non la règle) que le Juge unique a convoqué pour libérer les collaborateurs de Bemba ne s’applique-t-il pas aussi à son cas après six longues années de détention sans jugement ?
Le cas Kenyatta nous offre une autre récente incongruité des entraves illégales infligées à Bemba : comment la CPI a-t-elle accordé le privilège de se présenter en « homme libre » au Président Kenyatta et l’avoir refusé à plusieurs reprises à Bemba ?
Et cette négation manifeste de recherche de la vérité dans ce qui s’est réellement passé en Centrafrique qui pourtant est le principal fond de ce qu’on reproche à Bemba où aucun protagoniste Centrafricain (déjà le défunt Patassé, président constitutionnel auquel Bemba est venu légalement à la rescousse et ses collaborateurs civils et militaires sans parler du camp rebelle alors en face) n’a été appelé à la barre !
Autant de questions qui s’imposent et qui nous révèlent au delà que la Gambienne Bensouda (la Gambie, un pays aux mœurs de gouvernance archaïques et dictatoriales) a privatisé politiquement cette Cour sur les directives des puissants de la CI, « une justice des vainqueurs » dont les intérêts ne sont pas toujours compatibles avec ceux des dominés Africains : l’UA n’avait pas que des torts à dénoncer une justice pas toujours juste ne sanctionnant que les pauvres Africains !
Alors que nous révèle la CPI à travers cette décision inédite de son Juge Unique : veut-elle nous dire que ce dernier cesse désormais de couvrir systématiquement sa Procureure ? Et que nous dit-elle de son attitude dans le procès de Bemba : ira-t-elle jusqu’à reconnaître qu’elle s’est « acharnée » dans une procédure plus politique que judiciaire et à décider de le juger enfin sur des faits et non sur des opinions ?