La famille est ce cadre naturel qui permet à tout être humain d’évoluer en y apprenant les rudiments de la vie tout court et de la vie en société en particulier. Le sens et la signification que les humains donnent à la famille diffèrent et évoluent dans le temps et dans l’espace. Au Congo, et comme d’ailleurs dans la plupart des pays africains, la famille est la base de la société. Cette conception a même été consacrée en ces termes dans l’exposé des motifs de la Loi nº 010 du 1eraoût 1987 portant code la famille : « En effet d’après la Constitution, la famille constitue la base naturelle de la communauté humaine, elle est placée sous la protection du Mouvement Populaire de la Révolution et doit être organisée de manière à assurer son unité et sa stabilité.
Mais, la protection efficace de la famille appelle nécessairement l’abandon de la diversité des règles juridiques auxquelles elle est actuellement soumise du fait de l’existence d’un droit écrit colonial d’un côté et de la multiplicité des coutumes de l’autre. C’est pourquoi le législateur a tenu à mettre sur pied des règles qui régissent la famille, en conformité non seulement avec l’authenticité zaïroise mais aussi avec les exigences d’une société moderne. » Au cours de cette analyse, il sera question de survoler la raison d’être (ratio legis) de cette option, d’expliquer le soubassement culturel de la notion « famille », cellule de base de la société et d’examiner les principaux écueils qui mettent en péril la famille et, par conséquent, la nation congolaise.
La déstructuration de la famille congolaise sous l’époque coloniale
Sur le plan juridique, l’administration du Congo belge avait été rendue possible grâce un arsenal de textes légaux votés par le Parlement belge à l’insu et sans le consentement du peuple congolais, appelé d’ailleurs indigène. Il y eut d’abord la Charte coloniale du 18 octobre 1908, considérée comme la Constitution de la Colonie et de laquelle découlaient tous les textes législatifs et règlementaires applicables même aux « justiciables » analphabètes qui ignoraient tout de leur promulgation et de leur mise en vigueur. Pour faciliter l’application de tous ces textes juridiques, il fut créé des catégories de citoyens entre les Belges (colons), les étrangers d’origine européenne et autres vivant sur le territoire colonial ainsi que les indigènes. L’article 4 de la Charte coloniale disposait que « Les Belges, les Congolais immatriculés dans la colonie et les étrangers jouissent de tous les droits civils reconnus par la législation du Congo belge. Leur statut personnel est régi par leurs lois nationales en tant qu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public.
Les indigènes non immatriculés du Congo belge jouissent des droits civils qui leur sont reconnus par la législation de la colonie et par leurs coutumes en tant que celles-ci ne sont contraires ni à la législation ni à l’ordre public. Les indigènes non immatriculés des contrées voisines leur sont assimilés. »[1] Par Congolais immatriculés il faut entendre tous ceux qui, ayant un certain niveau d’études et capables de s’exprimer en français, étaient en mesure de mener leur vie à l’occidentale. Il fallait pour cela être admis au statut d’évolué après être attesté par une autorité coloniale. Grâce au décret du 17 mai 1952, le Gouverneur général de la Colonie renforça les conditions d’admission à ce statut par des mesures encore plus humiliantes pour nos parents ou nos grands-parents : « Après la publication de ce décret, les indigènes ont vu les conditions d’obtention d’immatriculation se durcir puisqu’en plus de la demande d’immatriculation, ils devaient prouver qu’à la suite de leur formation et genre de vie ils avaient acquis la forme occidentale de civilisation afin de se défaire du statut coutumier et accéder à cet autre statut civil8.
Pour acquérir ce statut après cette réforme, il fallait remplir la condition de maîtrise de la langue française et répondre positivement à une série de tests, épreuves, inspections à domicile, etc.9. Lors des visites domiciliaires, l’agent qui menait l’inspection devait prendre en considération plusieurs éléments : la possession de lits propres à chaque enfant, l’utilisation de couverts lors des repas, la possession d’assiettes assorties entre elles, la réunion de la famille à table lors des repas, etc.6»[2] Ceux qui avaient suivi les travaux de la Conférence Nationale Souveraine (CNS) peuvent se souvenir des propos de feu Kitenge Yesu se vantant d’avoir mangé la tomate crue avant l’indépendance, pour montrer que sa famille était déjà évoluée à l’époque. Étant donné que le but avoué de la colonisation était de transmettre aux « indigènes » ce qui leur manquait (les valeurs de la civilisation), ces mesures eurent pour effet de créer deux catégories de citoyens congolais, ceux dont les litiges d’ordre familial devaient se résoudre selon leurs coutumes respectives et les évolués dont l’assimilation aux Européens pouvait leur permettre de s’adresser aux cours et tribunaux. L’ancien code civil, Livrer 1er, relatif aux personnes, perpétua cette dualité et ce déséquilibre socioculturel jusqu’à son remplacement par le code de la famille du 1er août 1987. Mais pourquoi le législateur met l’accent sur la famille comme la base de la société ?
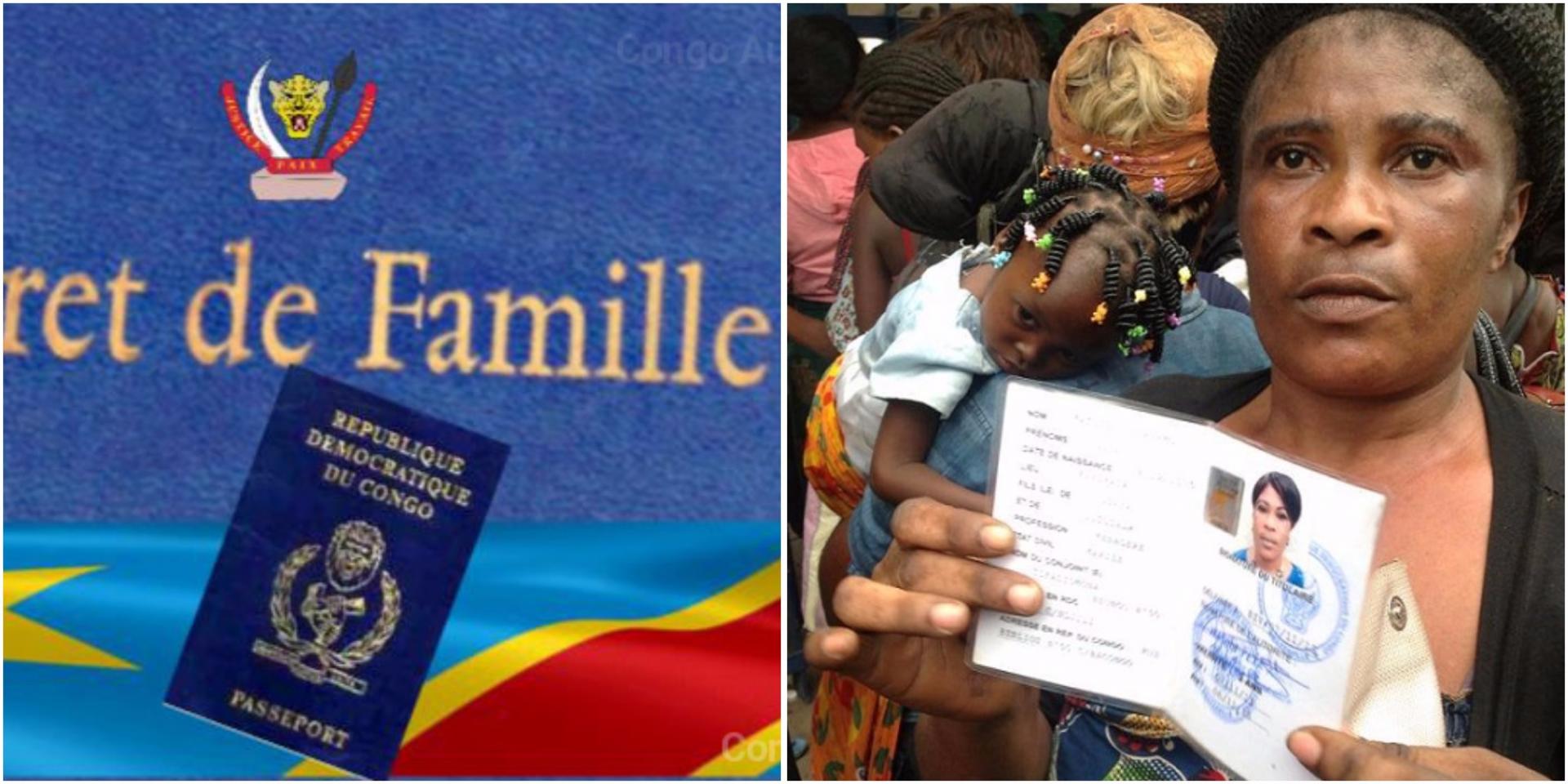
La famille, une entité sociale aux multiples facettes
Au sens africain et congolais du terme, la famille déborde le cadre et la définition que nous donne le dictionnaire et que, malheureusement on continue d’enseigner à l’école. Selon le taux de natalité, la famille africaine grandit et se ramifie en s’étalant sur plusieurs générations sans perdre sa matrice constituée des ancêtres fondateurs. Grâce aux liens de mariage, la famille englobe, jusqu’à un degré identifiable, tous ceux qui se réclament d’une filiation maternelle ou paternelle incontestable. Ainsi considérée, la famille congolaise est un foyer propice à l’identification des individus. En effet, du fait de vivre plus rapprochés les uns des autres, dans les milieux ruraux, les membres de plusieurs familles forment une localité où tout le monde connaît tout le monde au point d’être capable de décliner l’arbre généalogique d’une autre famille du même village. C’est surtout au tour des aînés et par voie orale que les plus jeunes apprennent, de génération en génération, l’histoire de leur famille, les faits épiques ou des événements peu flatteurs ayant jeté l’opprobre sur tel membre du groupe familial ou clanique. La famille africaine et congolaise est surtout un lieu par excellence de transmission des valeurs, que la colonisation a tenté d’effacer au nom de « la mission civilisatrice ». Dans la diversité culturelle, quelques-unes de ces valeurs subsistent et font la fierté du peuple congolais :
– La solidarité
Au pays, comme dans la diaspora, les Congolais se distinguent par leur solidarité des uns à l’égard des autres. Encore vivante de nos jours, cette solidarité se constate aussi bien dans le malheur que dans le bonheur, en commençant par les voisins, premiers confidents avec qui l’on partage le vécu quotidien. Dans certains cas urgents et préoccupants, le voisin peut plus efficacement intervenir qu’un frère ou une sœur de sang. Lors des funérailles d’un Congolais de la diaspora, la sympathie et la solidarité se manifestent notamment par la présence massive et les contributions financières et matérielles pour des funérailles dignes à offrir au défunt.
– Le respect dû des aînés
L’équilibre et la stabilité de nos sociétés traditionnelles ont toujours été fonction du respect intergénérationnel. Au sein d’une même famille et même en dehors, les aînés bénéficient d’une très grande considération leur permettant d’être écoutés en priorité pour tout problème d’intérêt communautaire. En l’absence des parents, tout aîné a le pouvoir de blâmer, voir de punir un enfant qui contrevient aux règles sociales. Dans la croyance populaire, ne pas respecter un aîné est non seulement considéré comme un signe de mauvaise éducation mais peut attirer à son auteur des malédictions. C’est ce qui fait que le chef, qui incarne le pouvoir, ne doit pas faire l’objet d’offense. En cas de faute de la part des aînés à l’égard des plus jeunes, il existe des mécanismes de règlement moins humiliants pour les protagonistes.
– Le mariage
En Afrique et au Congo, le mariage est une institution tellement sacrée que le célibat est considéré comme un mode de vie contre nature. C’est, dans les croyances, le cadre par excellence où et dans lequel se transmettent la procréation et la continuité de l’espèce. La distinction entre la forme monogamique ou polygamique a peu d’importance dans la mesure où cela relève du choix personnel. Et les enfants qui en sont issus jouissent du même degré de filiation et des mêmes droits. C’est ce qui avait inspiré le législateur du code de la famille pour prévoir l’article 593, qui dispose : « Toute discrimination entre congolais, basée sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a été établie, est interdite.
Les droits prévus par la présente loi doivent être reconnus à tous les enfants congolais, sans exception aucune. » Dans beaucoup de familles, certains n’ont eu leur ascension politique ou sociale que grâce à leurs frères ou sœurs du « deuxième lit ». C’est notamment cette conception du mariage et de la famille qui a permis à nos sociétés traditionnelles de résister, pendant des siècles, à la forme avilissante et déshumanisante de la prostitution telle qu’importée du monde dit civilisé, avec son lot des maladies sexuellement transmissibles. Ce sont toutes ces valeurs, et tant d’autres non exploitées à travers ces lignes, qui ont constitué depuis des millénaires le socle et l’identité de nos sociétés africaines. Rien ne garantit cependant qu’elles résisteront toujours à l’usure du temps, si rien n’est fait pour sauver les meubles
Facteurs de déstabilisation de la famille
Facteurs exogènes
En plus de la prétendue mission civilisatrice de la colonisation que nous avons survolée ci-dessus, il y a lieu de relever les effets dévastateurs de la mondialisation des technologies de l’information et de la communication. A cause des médias sociaux, il n’est pas facile pour les familles comme pour les pouvoirs publics de censurer la circulation des pratiques et des images qui heurtent la pudeur africaine et nos valeurs collectives. La cible la plus fragile, la plus exposée et, malheureusement, la plus nombreuse c’est la jeunesse, qui n’est pas protégée. Elle y apprend tout ce que leurs parents, d’une certaine époque, tentent désespérément de leur déconseiller. Non seulement les jeunes d’aujourd’hui considèrent que leurs parents et aînés sont arriérés, ils sont enclins à imiter plus facilement tout ce qui est susceptible de détruire le socle de la société africaine et partant, de mettre en péril la retransmission de l’espèce humaine. C’est le cas de la redéfinition du mariage, que certains leaders mondiaux tentent d’imposer en Afrique.
Facteurs endogènes
La pauvreté, le développement humain, l’exode rural, l’absence de politique d’aménagement du territoire, le faible degré d’enseignement et le défaut de vulgarisation du code de la famille sont autant de facteurs endogènes, parmi plusieurs autres, qui érodent chaque jour le rôle de la famille en tant que base de la société. Dans la majorité des cas, la pauvreté, résultant elle-même du chômage, est responsable du relâchement des liens familiaux et de la destruction du tissu social. En effet, à cause de la pauvreté beaucoup de parents ont perdu leur autorité parentale, tolérant même la prostitution de leurs filles et le banditisme de leurs fils pour prendre en charge les besoins de la famille. A cause de la pauvreté, beaucoup de couples ne parviennent plus à tenir longtemps dans le mariage tandis que les enfants des familles recomposées perdent les repères d’une bonne éducation. Parmi ceux qui ont pu aller à l’école, nombreux sont des jeunes qui désertent la campagne ou qui accusent de sorcellerie les aînés de la famille, qu’ils n’hésitent pas à exposer à la vindicte populaire. Lorsqu’elle devient insupportable, la pauvreté pousse plusieurs jeunes à se jeter dans l’inconnu vers les villes ou l’extérieur du pays rompant tout contact avec leurs familles et essayant de mener une vie individualiste contraire aux traditions africaines. Il convient de signaler la crainte, à tort ou à raison, de ceux qui préfèrent vivre isolés de leurs proches afin d’éviter le parasitisme et la jalousie pouvant conduire jusqu’à l’élimination physique par empoisonnement ou autre.
Pour sa part, l’État a presque démissionné de ses prérogatives sociales de base et de ses responsabilités d’aménager le territoire et de créer les conditions favorables à la création d’emplois et à la fixation des populations dans les milieux ruraux. Le programme de l’enseignement, quant à lui, n’a pas connu des innovations significatives tendant à intégrer la transmission des valeurs constructives contenues dans la Loi portant code de la famille. Depuis la promulgation de cette loi, aucun effort n’a été fourni pour sa vulgarisation dans toutes les langues nationales. D’où la cacophonie et les interminables conflits fonciers de succession devant les cours et tribunaux.
Conclusion
Il est bien beau de faire la politique et de vouloir diriger le pays, mais cela n’a de sens que si les actions à mener peuvent profiter à la société. Un bon dirigeant est par conséquent celui qui connaît les valeurs fondamentales de cette société, parmi lesquelles la famille qui en constitue le socle. Au regard des points survolés dans cette analyse, nous sommes d’avis que la recherche de la cohésion nationale et du patriotisme ne sont possibles que si, à la base, il y a la cohésion familiale. Nous avons consacré cette analyse à identifier, depuis l’époque coloniale, les facteurs socio-politiques et culturels qui menacent constamment la famille, qualifiée à juste titre de base de la société. Les sociologues peuvent nous compléter avec beaucoup plus de détails, mais il revient surtout au gouvernement de faire sa part pour favoriser les conditions de vie en famille et en société. Sinon à servent le code de la famille et tout un ministère du genre et de la famille ?
Jean-Bosco Kongolo Mulangaluend
Références
[1] Par contrées voisines il faut entendre le Rwanda et le Burundi.
[2] Wikipédia, consulté en ligne, le 23/08/2023, In https://fr.wikipedia.org/wiki/Immatriculation_des_Congolais.

