La diplomatie appliquée : Vers un remake de l’isolement diplomatique de la RDC des années 1990 ?
Jean-Jacques Wondo Omanyundu
L’opinion se rappelle qu’à la suite des événements qualifiés à tort ou à raison de « Massacre du Campus de l’Université de Lubumbashi », en 1990, les pays occidentaux, au premier rang desquels la Belgique, ont intensifié des pressions diplomatiques sur le régime zaïrois. Cela avait conduit à la rupture de la coopération technique de la plupart des pays occidentaux au Zaïre (aujourd’hui la RDC. Ces actions se sont déroulées durant la période dite de « transition démocratique » instaurée à la suite du discours pathétique du président Mobutu, le 24 avril 1990, lfin au monopartisme dominé par le MPR[1] et libéralisant l’espace politique congolais vers plus de multipartisme.
Cette décision intervient dans un double contexte sociopolitique interne et géopolitique international particulier. Des stratèges autour de Mobutu, qualifiés de « colombes[2] », partisans d’un pouvoir ouvert et conciliant, s’y étaient affairés des années auparavant pour amorcer une certaine ouverture vers les opposants au régime Mobutu. A leur opposé, des faucons du régime zaïrois optaient pour un pouvoir pur, dur et sans aucune concession ni ouverture à l’opposition.
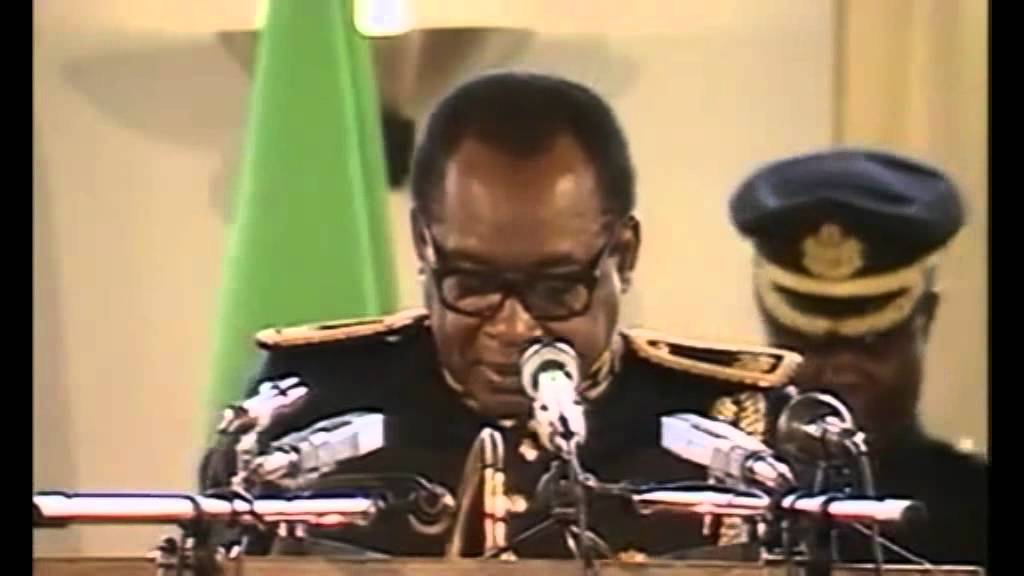
En effet, le discours du 24 avril 1990 est compris comme une résultante de la conjonction d’une part, de la mission de consultations populaires menées avec dextérité par deux cadres du régime de l’époque, qualifiées de colombes, l’ambassadeur Roger Nkema Liloo, ancien conseiller spécial de Mobutu chargé de la sécurité (surnommé père de la perestroïka) et l’actuel sénateur Edouard Mokolo wa Mpombo. D’autre part, des bouleversements politiques survenus en Europe de l’Est, le Perestroïka soviétique initié par le Secrétaire général et Présidente de l’Union soviétique (URSS) Mikhaïl Gorbatchev et la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989 ont considérablement impacté la politique occidentale en Afrique. Le maréchal Mobutu, soumis aux intenses pressions diplomatiques occidentales pilotées par Washington, initie les « consultations populaires ». Il sillonne toutes les provinces du Zaïre pour sonder lea population sur les changements sociopolitiques attendus du régime issu du coup d’état du 24 novembre 1965. Ces consultations avaient été clôturées dans la capitale où, toutes les couches de la population étaient représentées le 24 mars 1990, à la Cité du parti à N’Sele[3]. Il faut aussi rappeler que la genèse de ce processus démocratique remonte au début des années 1980, à la suite de la lettre des « Treize parlementaires » qui a abouti à la création du parti UDPS (Union pour la Démocratie et la paix sociale), dont Etienne Tshisekedi, Frédéric Kibassa Maliba, Mbwankien et Gabriel Kyungu étaient des figures les plus populaires.
Ce discours enclencha une période de transition politique chahutée et chaotique marquée par une bipolarisation de la vie politique entre Mobutu et son camp politique, la « Mouvance présidentielle » d’un côté (l’équivalant de la Majorité présidentielle aujourd’hui) et Etienne Tshisekedi autour duquel s’est constituée l’ « Union sacrée de l’opposition » et alliés (l’équivalent du Rassemblement aujourd’hui), quelques leaders de la société civile de l’époque dont Pierre Lumbi Okongo, Modeste Bahati, Modeste Mutinga, etc. ainsi que la puissante église catholique. L’épreuve de force entre Mobutu et Tshisekedi tourna plutôt au début, en faveur de l’opposition et des forces du changement incarnées par Etienne Tshisekedi, ancien haut cadre du MPR considéré lui-même comme un des pères du « Manifeste de la N’sele », le livre de la doctrine du parti.
C’est dans ce rapport de forces favorable à l’opposition que Mobutu, après plusieurs tentatives de récupération du jeu politique, fut contraint à convoquer la Conférence nationale souveraine (CNS) qui élit de manière triomphale Etienne Tshisekedi au poste de Premier ministre de la première transition. Mais les faucons du régime ne s’étaient pas avouer vaincus. Par un subtil jeu d’achat et de débauchage d’opposants, à l’instar de ce que Kabila parvient d’opérer actuellement, de multiplication des faux partis alimentaires d’opposition dont l’UDI (Union des démocrates indépendants) de Léon Kengo wa Dondo et de durcissement de la répression – via le terrorisme d’Etat – contre l’opposition et les contestataires du régime, mené particulièrement par le trio Nzimbi, Baramoto et Ngbanda, Mobutu parvint bon an mal an à récupérer la situation en sa faveur et à bloquer le processus démocratique, en neutralisant Etienne Tshisekedi, considéré par la majorité des Congolais comme étant le père du processus démocratique du pays. Ce blocage ou le rétrécissement de l’espace politique va durer six ans.
Une transition démocratique bloquée par Mobutu, sur conseil de ses conseillers radicaux dans un régime failli
Selon Erik Kennes, « la situation sociopolitique du Zaïre en 1996 s’achemina vers un blocage. Le parlement de transition du pays (HCR-PT), qui aurait dû préparer et approuver l’échafaudage juridique pour la tenue des élections permettant de sortir de l’époque Mobutu, était enlisé dans des querelles politiciennes. La Commission nationale des élections, organe technique et extraparlementaire, ne bénéficiait que de peu de confiance et d’attention de la part de toute la classe politique. Les politiciens de Kinshasa n’éprouvaient pas réellement la volonté affichée d’aller aux élections. La désillusion née de l’échec probable du processus de «démocratisation» avait déjà amené, depuis 1993, des activistes politiques à prendre des contacts avec les chefs d’état des pays limitrophes, sans aboutir à quelque résultat concret. Ils ont pu établir des relations avec des groupuscules de tendance « lumumbiste » résidant en Tanzanie et en Ouganda, héritiers des différents maquis du Kivu des années 1970 et 1980, ainsi que du soutien accordé par la Libye de Kadhafi pendant les années 1980. Des contacts ont eu lieu également avec les « tigres » ou « ex-gendarmes katangais », force militaire relativement importante, opposée à Mobutu et proprement dites[4].
En effet, durant les années échaudées -1990 – de la Conférence Nationale et Souveraine, avec son lot de journées ville morte et de contestations politiques à Kinshasa – une capitale acquise à la cause du « Sphinx de Limete », Etienne Tshisekedi – le maréchal Mobutu, faussement et insidieusement conseillé par les généraux Nzimbi et Baramoto, ainsi que par M. Honoré Ngbanda, sera éloigné de Kinshasa pour être reclus à Gbadolite, son fief natal dans la région de l’Equateur où il se surnommera à son tour « L’Aigle de Kawele[5] ». Malheureusement, cet aigle tropical, même en volant très haut, sa vue de la réalité politique du terrain à Kinshasa était masquée par l’épaisse forêt dense équatoriale. Ces conseillers ethniques l’ont convaincu qu’ils assureraient sans faille la garde de la maison Zaïre pour son compte, à partir de la Capitale. Ainsi, dans son exil tropical folklorique doré, verdoyant et insolite à Gbadolite, le Chef de l’Etat ne percevait plus les événements de Kinshasa qu’à travers le prisme – ô combien désinformant et déformé – des rapports falsifiés de Nzimbi, Baramoto (Actuellement conseiller privé de Kabila à la sécurité intérieure), Ngbanda ainsi qu’une pléthore d’autres bouffons de sa cour auxquels il vouait une totale confiance aveugle. Les cadres militaires et civils qui étaient nommés à des postes ou à des grades élevés savaient qu’ils étaient redevables et comptables en premier lieu aux nouveaux maîtres du jeu et du pré-carré présidentiel dans le pays qu’à Mobutu lui-même[6], suscitant même la guerre des généraux et des sécurocrates et des divisions au sein de l’appareil sécuritaire qui se feront sentir lors de l’agression du Zaïre par l’AFDL.
En conséquence, le blocage politique des années 1990, la fin de la coopération technique militaire avec la Belgique et la France, et de la réduction de l’enveloppe budgétaire de l’aide extérieure, la crise économique, l’effondrement de la monnaie nationale et sa dévaluation entraînant la pénurie des devises, l’inflation galopante, la problématique sécuritaire et humanitaire à l’Est de la RDC avaient conduit le pays à une situation de crise sans précédent. Au cours des années 1990, alors que l’État se désagrégeait progressivement, la situation et la capacité militaire des FAZ continuaient elles aussi à se détériorer[7]. Tous les paramètres étaient donc réunis pour décrire le Zaïre des années 1990 comme un Etat en faillite : Un état en dégénérescence qui n’avait plus de puissance légitime sur son territoire. Le zaïre des années 1990, du fait de l’irresponsabilité criante des autorités politiques de l’époque (qui ne se sont jamais remises en question jusqu’à ce jour), était devenu un État déliquescent ou effondré, qui « était confronté à de sérieux problèmes qui compromettaient sa cohérence et sa continuité » [8].
Pour information, la thématique de « l’Etat effondré » (collapsed state) ou « échoué » (failed state)[9] désigne en général l’incapacité des Etats à assurer un minimum de fonctions étatiques classiques (et d’abord la sécurité). Il n’y aurait plus de monopole de la violence parce que l’usure du concept d’Etat-nation ferait que les éléments de structuration clanique/tribale prendraient le dessus. Les Etats sont des entités mortelles. Dans l’histoire, le mode le plus classique de disparition est assurément la défaite militaire. Ecrasés, occupés, les vaincus sont phagocytés avec plus ou moins de succès par l’Etat victorieux qui, dans le meilleur des cas, peut progressivement obtenir le soutien des populations qu’il a vaincues. Mais un Etat peut aussi disparaître pour des motifs sociopolitiques internes, ce qui renvoie finalement à son incapacité à contrôler sa population ou à satisfaire à ses attentes de base, notamment dans le domaine de la sécurité. Dans un tel cas de figure, la population refuse à la fois des symboles, son existence même, voire son droit. Les Etats connaissent ainsi des cycles de développement et de régression[10] (naissance, croissance, développement, apogée, déclin, effondrement).
Avec le blocage politique, la CNS a fini par laisser la place à un parlement de transition taillé sur mesure du « maréchal », le Haut conseil de la République-Parlement de transition (HCR-PT), dirigé par l’actuel Cardinal Laurent Monsengwo, dont les animateurs étaient issus de la CNS mais dont la composition octroyait une majorité mécanique à la Mouvance présidentielle.
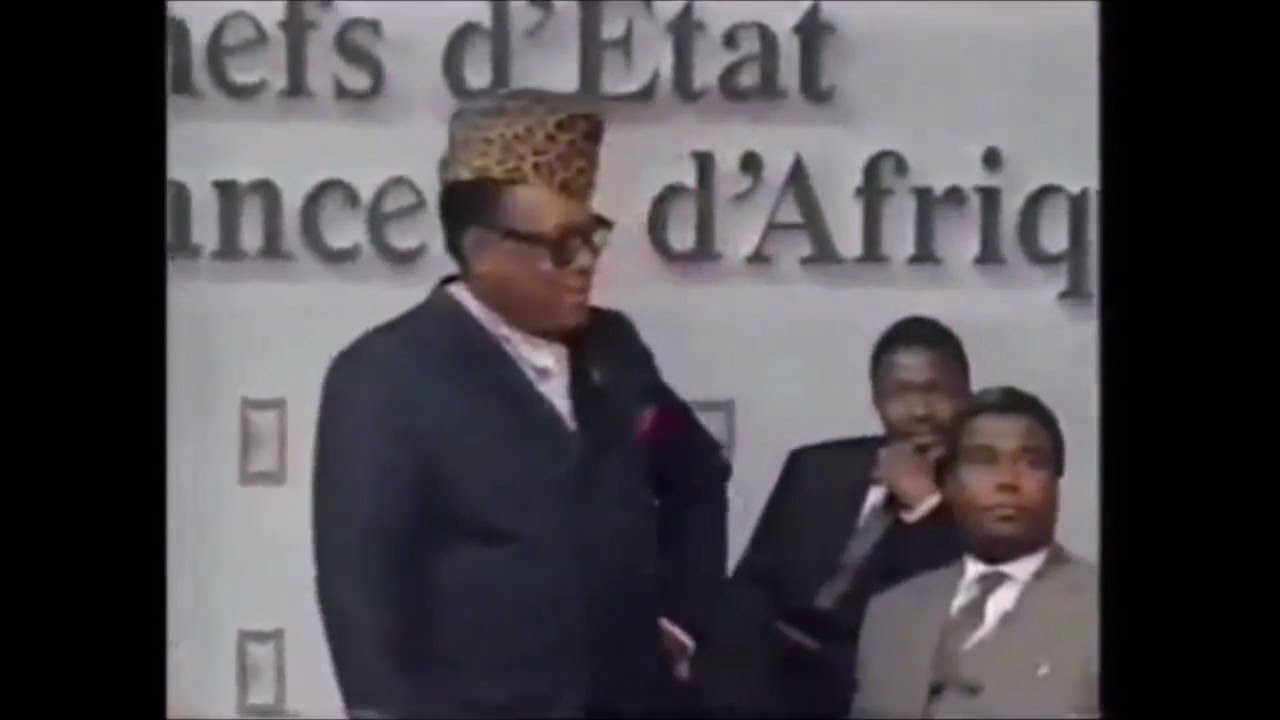
Des mesures de rétorsion diplomatiques qui reviennent comme un boomerang contre le régime zaïrois – Itinérance similaire avec le régime de Kabila ?
Sur le plan diplomatique, Mobutu prit une série de mesures très dures de rétorsion économiques contre la « petite » Belgique. Il s’agissait notamment du transfert dans une ville européenne autre que belge des bureaux des entreprises publiques zaïroises, de la réduction drastique du nombre de vols de la Sabena entre Bruxelles et Kinshasa, du rapatriement de l’argent zaïrois logé dans les banques belges, de la menace de rupture du contrat de raffinage du cuivre zaïrois à Hoboken près de Anvers, du départ de Belgique des étudiants boursiers et stagiaires militaires zaïrois. Nous (JJW) étions personnellement concerné à l’époque car encore en formation à l’ERM. Une mesure jugée insensée par la Belgique qui ne l’appliqua pas…
Sans en mesurer l’impact géopolitique à moyen et à long termes, quatre ans plus tard, nous sommes en 1994, Mobutu finit par devenir un paria aux yeux de l’Occident. C’est lors du dix-huitième sommet franco-africain, le dernier auquel assistait François Mitterrand, que Mobutu expérimentera sa longue traversée du désert diplomatique qui conduira à sa chute. Comme par hasard, la thématique de ce sommait s’articulait autour de trois sujets « démocratie, développement, sécurité « . Ces mêmes thèmes reviennent encore constamment comme des griefs de la « communauté internationale contre le régime de Joseph Kabila. Nous connaissons tous la triste fin du Léopard, lui qui disait que de son vivant il n’y aura pas d’autre président au Zaïre, une sorte de « wumela raïs, à la Mobutu.
Par ailleurs, cet épisode nous foutnit une poignante leçon de la solidarité occidentale qu’illustre parfaitement ce remarquable reportage, lorsqu’aujourd’hui en Afrique ou en RDC, la solidarité ne dépasse plus l’espace d’un clan[11].
30 ans plus tard, l’histoire en RDC semble hélas se répéter, à analyser le comportement sociopolitique et diplomatique actuel du régime de Joseph Kabila. Ce, d’autant que la majorité des acteurs occultes du mobutisme, inhibés de toute faculté de réflexion prospective d’anticiper les événements, ont élu domicile à Kingakati-Buene. Les récentes mesures de la communauté internationale et le mécontentement des voisins de la RDC contre le régime de Kabila laissent transparaître des similitudes évidentes avec la situation qui a prévalu dans les années 1990. Les mêmes causes risquent de provoquer les mêmes effets en RDC. Malheureusement, avec des Congolais pris pour des dindons de la farce internationale, car toujours majoritairement spectateurs des changements imposés à leur pays.
Cette vidéo exceptionnelle et très instructive dans le cadre des pratiques en relations internationales, vaut mille fois plus que des séances de travaux pratiques des cours des relations internationales.
[su_youtube url= »https://youtu.be/17A7x14V6CU[/su_youtube]
Un peuple qui oublie son histoire est condamné à la subir !
Jean-Jacques Wondo Omanyundu
Références
[1] Mouvement populaire de la révolution-Parti-Etat.
[2] Parmi les colombes du régime de l’époque, on peut citer notamment Maître Nimy Mayidika Ngimbi, le sénateur Mokonda Bonza (ancien directeur de cabinet de Mobutu, Maître le feu Gérard Kamanda wa Kamanda, Atende ou encore les feux généraux Mahele et Mukobo. Les faucons quant à eux, partisans d’un pouvoir pur et dur et sans partage ni ouverture avec l’opposition, se recrutaient essentiellement dans l’armée, la police et la garde civile (le feu général Nzimbi, le général Philémon Baramoto actuellement conseiller privé de Kabila chargé du maintien de l’ordre public et de la sécurité intérieur), les généraux Likulia, Eluki, Bolozi) et les services de sûreté comme M. Honoré Ngbanda.Atundu. http://afridesk.org/fr/opinion-si-etienne-tshisekedi-rectifiait-le-tir-ce-24-avril-2016-jj-wondo/.
[3] Le Forum des As. http://www.congoforum.be/fr/congodetail.asp?subitem=21&id=8158&Congofiche=selected.
[4] Erik KENNES, «La Guerre au Congo», Mars 1998 ou http://www.ua.ac.be/objs/00110992.pdf.
[5] Kawele est le nom de la résidence qu’occupait Mobutu dans un village situé à Gbadolite, au cœur de la forêt équatoriale.
[6] http://afridesk.org/fr/17-mai-1997-le-tigre-mahele-est-abattu-vive-la-jungle-demon-cratique-du-congo-partie-finale-jean-jacques-wondo/.
[7] NGBANDA NZAMBO-Ko-Atumba, Honoré, Ainsi sonne le glas ! Les derniers jours du maréchal Mobutu ; Gideppe, Paris, 1998, 447p.
[8] JJ Wondo O., Les armées au Congo-Kinshasa. Radioscopie de la Force publique aux FARDC, 2è Ed. avril 2013, p.197.
[9] Ce concept est largement expliqué par J.L MARRET et A. Didier, Etats « échoués » et Mégapoles anarchiques, Paris, PUF, novembre 2001.
[10] MARRET, Jean-Luc, Crises d’Etat et organisations non étatiques violentes : Etats « effondrés » ou « échoués», in Annuaire Stratégique 2003, Fondation pour la recherche Stratégique, Ed. Odile Jacob, Paris, Juin 2003, p.146.
[11] JJ Wondo Omanyundu, L’urgence d’une décolonisation mentale des Congolais : relire Mabika Kalanda – DESC, 24 mai 2017 – http://afridesk.org/fr/lurgence-dune-decolonisation-mentale-des-congolais-relire-mabika-kalanda-jj-wondo/.


One Comment “La diplomatie appliquée : Vers un remake de l’isolement diplomatique de la RDC des années 1990 ? – JJ Wondo”
Laurent
says:Belle analyse. Au final c’est le peuple congolais et la RD Congo qui stagnent. Esperons que la fin du regime de Kabila sera totalement different de celle de Mobutu pour le bien des RD congolais