« Cet article de la RFI rencontre les articles développés par l’expert militaire Jean-Jacques sur les typologies de guerre dans les liens ci-dessous :
Guerre conventionnelle et non conventionnelle
La guerre conventionnelle – ou guerre régulière – est un conflit armé entre les forces régulières (infanterie, blindés, aviation, marine) de deux ou plusieurs États qui s’opposent selon des règles établies (droit de la guerre) en utilisant des armes classiques (non nucléaires, cyber, de destruction massive, biologiques ou chimiques). Ses objectifs sont d’affaiblir, de neutraliser ou de vaincre l’ennemi pour obtenir un gain territorial, politique ou stratégique.
La guerre non conventionnelle – ou guerre irrégulière – désigne un large champ d’opérations menées par d’autres méthodes d’affrontements que celles d’une guerre classique : guérillas, cyberguerres, terrorisme, actions clandestines ou soutien à des groupes armés. Ses objectifs sont de déstabiliser ou de contrôler l’ennemi sans forcément recourir au conflit direct.
Guerre totale / guerre de haute intensité
La guerre totale est un conflit armé dans lequel toutes les ressources militaires, économiques et humaines d’une nation sont mobilisées. Il n’y a plus de distinction entre les combattants et les civils, transformant l’ensemble de la population en cible. La propagande peut être utilisée pour s’en assurer le soutien.
Son objectif est de vaincre l’ennemi et d’obtenir sa capitulation par la destruction de tous ses leviers de résistance : ses ressources militaires, mais aussi son économie et ses infrastructures. La Premiere et la Seconde Guerre mondiale en sont des exemples.
Dans le contexte actuel de tensions géopolitiques et de menaces armées, on parle de plus en plus de guerre de haute intensité. Elle se définit par le déploiement massif d’armes conventionnelles à forte intensité, en s’appuyant sur la sophistication technologique des équipements dans le but d’atteindre une létalité maximale dans un espace et une durée limités. La France, par exemple, a intégré cette typologie de guerre dans la nouvelle loi de programmation militaire 2024-2030.
Guerre préventive / guerre préemptive
La guerre préventive désigne une action militaire menée par un État pour neutraliser une menace à moyen ou long terme avant qu’elle ne se concrétise. Elle se distingue de la guerre préemptive qui répond à une menace imminente et certaine.
Son objectif est de garder une position de supériorité et d’empêcher l’adversaire d’acquérir la puissance d’action ou des capacités militaires susceptibles de modifier les rapports de force. Contrairement à la légitime défense, cette forme d’anticipation stratégique est controversée sur le plan juridique, parce qu’elle est considérée comme spéculative.
L’invasion de l’Irak en 2003, ordonnée par l’administration Bush pour « débarrasser l’Irak d’armes de destruction massive », sous couvert des résolutions 678 et 687 de l’ONU, en est un exemple.
Guerre asymétrique
La guerre asymétrique désigne un conflit opposant des belligérants de forces inégales : d’un côté l’armée régulière d’un État, de l’autre un adversaire souvent plus faible usant de tactiques non conventionnelles comme la guérilla ou le terrorisme. L’objectif du plus faible est de vaincre par l’usure, la déstabilisation politique et psychologique de l’adversaire. Parmi les exemples, on trouve les tactiques du Viet Cong contre l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam (1955-1975), l’insurrection des talibans en Afghanistan (2001-2021) ou encore la lutte contre Daech.
Guerre hybride
La guerre hybride désigne une stratégie militaire et politique combinant des moyens militaires conventionnels (armées régulières) à d’autres non conventionnels (cyberattaques, espionnage, emploi de mercenaires, désinformation, pressions économiques ou diplomatiques).
Son caractère multiforme, flexible et sophistiqué, permet à l’agresseur de fournir une réponse adaptée aux objectifs du moment tout en maintenant l’ambiguïté quant à sa responsabilité directe et ainsi d’échapper aux représailles internationales.
En semant la confusion dans le processus décisionnel de l’adversaire, la guerre hybride permet d’acquérir des avantages géopolitiques importants tout en limitant les dépenses. L’annexion de la Crimée par la Russie, en 2014, ainsi que ses interventions dans le Donbass en sont des exemples.
Cyberguerre
La cyberguerre désigne les actions défensives et offensives menées par un État ou un acteur non étatique dans l’espace numérique (internet, systèmes informatiques et dispositifs électroniques). Elle vise à espionner, à manipuler, à voler ou à pirater les données sensibles d’un adversaire pour affaiblir ou paralyser ses infrastructures essentielles (énergie, transport, finance, santé, communication).
Parmi les exemples, on peut citer Stuxnet, le virus informatique qui a mis hors service les centrifugeuses du programme nucléaire iranien en 2010, ou encore les attaques russes contre le réseau américain Starlink qui permet aux Ukrainiens d’accéder à internet. La cyberguerre peut tuer aussi, comme ce fut le cas d’une patiente après la cyberattaque d’un hôpital en Allemagne, en 2020.
Guerre par procuration (« Proxy War »)
La guerre par procuration désigne un conflit dans lequel au moins deux États ou puissances extérieures s’opposent de manière indirecte, sans engager leurs propres forces militaires, en apportant leur soutien aux belligérants engagés sur le terrain (financement, armement, renseignement, assistance, formation).
Ce faisant, ces puissances cherchent à préserver leurs intérêts stratégiques, à étendre leur influence géopolitique, à affaiblir l’adversaire et à éviter le risque de conflit direct.
C’est le cas de la guerre civile en Syrie (2011-) dans laquelle la Russie, les États-Unis, l’Iran et d’autres pays sont engagés, et la guerre au Yémen (2014-), qui oppose le gouvernement en place, soutenu par l’Arabie saoudite et ses alliés, aux rebelles houthis, soutenus par l’Iran.
Guérilla et guerre contre-insurrectionnelle
La guérilla, aussi appelée « petite guerre », fait référence à l’insurrection populaire espagnole contre les forces d’occupation napoléoniennes, de 1808 à 1812. C’est une forme de guerre asymétrique, essentiellement politique, menée par des groupes armés irréguliers et mobiles – rebelles, partisans ou civils armés – contre une armée régulière plus puissante. Pour compenser leur infériorité matérielle, ses combattants utilisent des tactiques de déstabilisation, d’attaques surprises, d’embuscades, de sabotage et d’usure, tout en s’appuyant sur une connaissance approfondie du terrain et le soutien d’une partie de la population.
Si les guérillas ont pris diverses formes au cours de l’histoire (révolutionnaires avec Mao en Chine ou Castro à Cuba, indépendantistes avec le Viet Cong vietnamien ou le FLN algérien, ethniques avec les Kurdes au Moyen-Orient ou les Tamouls au Sri Lanka), elles ont aujourd’hui considérablement évolué en s’adaptant à la mondialisation et aux nouvelles technologies.
La guerre contre-insurrectionnelle désigne, quant à elle, les actions militaires, politiques, économiques et psychologiques menées par un État contre des mouvements insurrectionnels armés pour défendre ou préserver son autorité.
Guerre technologique
La guerre technologique se mène aussi bien dans le domaine militaire que civil. Elle désigne la compétition entre des États ou acteurs non étatiques pour acquérir ou maintenir leur supériorité et leur autonomie dans le domaine des technologies ayant un fort impact stratégique pour les secteurs économique et géopolitique : IA, cybersécurité, semi-conducteurs, télécommunications, infrastructures numériques, gestion des données, etc. Elle implique des investissements massifs en recherche et développement, des politiques de protectionnisme économique ou encore l’espionnage industriel.
Les évolutions rapides de ces technologies de pointe entraînent des conséquences directes sur les méthodes et moyens de guerre, comme l’usage de systèmes automatisés (drones autonomes, cyberattaques, robots) permettant de réduire l’exposition des combattants, de lancer des frappes chirurgicales ou encore de contrôler de l’espace électronique et des infrastructures numériques.
Si les guerres technologiques redéfinissent les rapports de force mondiaux, elles posent surtout de nouveaux défis d’ordre éthique, humanitaire et juridique.
« Zone grise »
En géopolitique, la « zone grise » désigne un espace dans lequel le contrôle de l’État souverain est affaibli ou absent, laissant place à des micro-pouvoirs alternatifs, une dérégulation sociale et une ambiguïté juridique. Les actions hostiles qui y sont menées relèvent de la guerre hybride (cyberattaques, désinformation, pressions économiques, présence militaire déguisée) et visent à affaiblir l’adversaire tout en évitant le conflit ouvert.
Le Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo, où des groupes armés s’affrontent pour le contrôle des ressources minières, en est un exemple. Ou encore le Nord-Kosovo, où l’autorité kosovare est contestée par la minorité serbe, générant une situation de concurrence d’autorité et une dérégulation sociale.
Guerre de l’information
La guerre de l’information désigne l’utilisation stratégique de l’information et des technologies de communication pour infliger un dommage ou obtenir un avantage sur un adversaire. Dans le contexte géopolitique, elle est déployée essentiellement sur internet et les réseaux sociaux et vise à influencer ou à manipuler l’opinion publique pour semer le doute et la discorde (désinformation, propagande), à déstabiliser les institutions ou à détruire des systèmes d’information (piratage informatique).
On peut citer l’exemple des Américains qui ont diffusé de fausses informations quant à la présence d’armes chimiques en Irak pour convaincre l’opinion mondiale de la légitimité de la seconde guerre du Golfe, en 2003. Ou encore le cas de la Russie, accusée d’ingérence dans l’élection présidentielle américaine, en 2016, par le biais de campagnes sur Facebook et Twitter.
Guerre commerciale
La guerre commerciale désigne l’affrontement économique entre des pays qui imposent mutuellement des mesures restrictives sur leurs échanges commerciaux dans le but de protéger leurs intérêts respectifs et de dominer le marché global. Ces mesures, qui relèvent d’une politique protectionniste, concernent principalement les taxes douanières et les quotas d’exportation.
La guerre commerciale qui opposait les États-Unis à la Chine entre 2018 et 2020 lors du premier mandat de Donald Trump, connaît une surenchère débridée en avril 2025 lorsque le républicain, de retour à la Maison Blanche, impose une taxe douanière de 145% aux produits chinois importés aux États-Unis, ce à quoi Pékin réplique par une taxe de 125% sur les produits américains importés en Chine. Les conséquences sont multiples : perturbation du commerce mondial, pénalisation des entreprises, hausse des prix pour les consommateurs.
Si ces conflits économiques visent à maintenir ou à acquérir une prédominance économique, ils servent également les desseins géopolitiques des parties engagées.

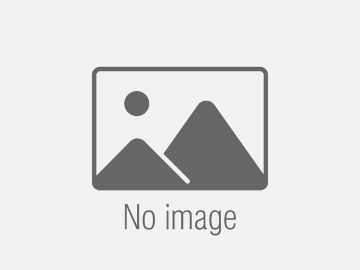
2 Comments on “Guerre conventionnelle, totale, asymétrique, hybride ou informationnelle: de quoi parle-t-on?”
Gabriel Romy
says:Bonjour à vous,
Je tiens à vous dire combien j’admire votre blog. Votre travail apporte une grande richesse et inspiration à vos lecteurs.
Par la même occasion, je me permets de proposer une collaboration. Cela vous plairait-il d’accueillir un article invité de ma part ? Si cela vous convient, pourriez-vous m’indiquer les modalités et consignes éventuelles ?
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles, et bravo pour votre travail !
Mes salutations les plus sincères,
Jean-Jacques Wondo Omanyundu
says:Bonjour,
Nous sommes flattés par votre admiration à l’égard de l’AFRIDESK.
Oui, nous pourrions accepter votre projet d’article à condition de répondre aux critères d’exigence de nos publications (article à caractère scientifique) et d’être accepté par notre comité de rédaction.
Vous pouvez soumettre votre projet d’article sur jjwondo@yahoo.fr.
Cordialement,
Jean-Jacques Wondo