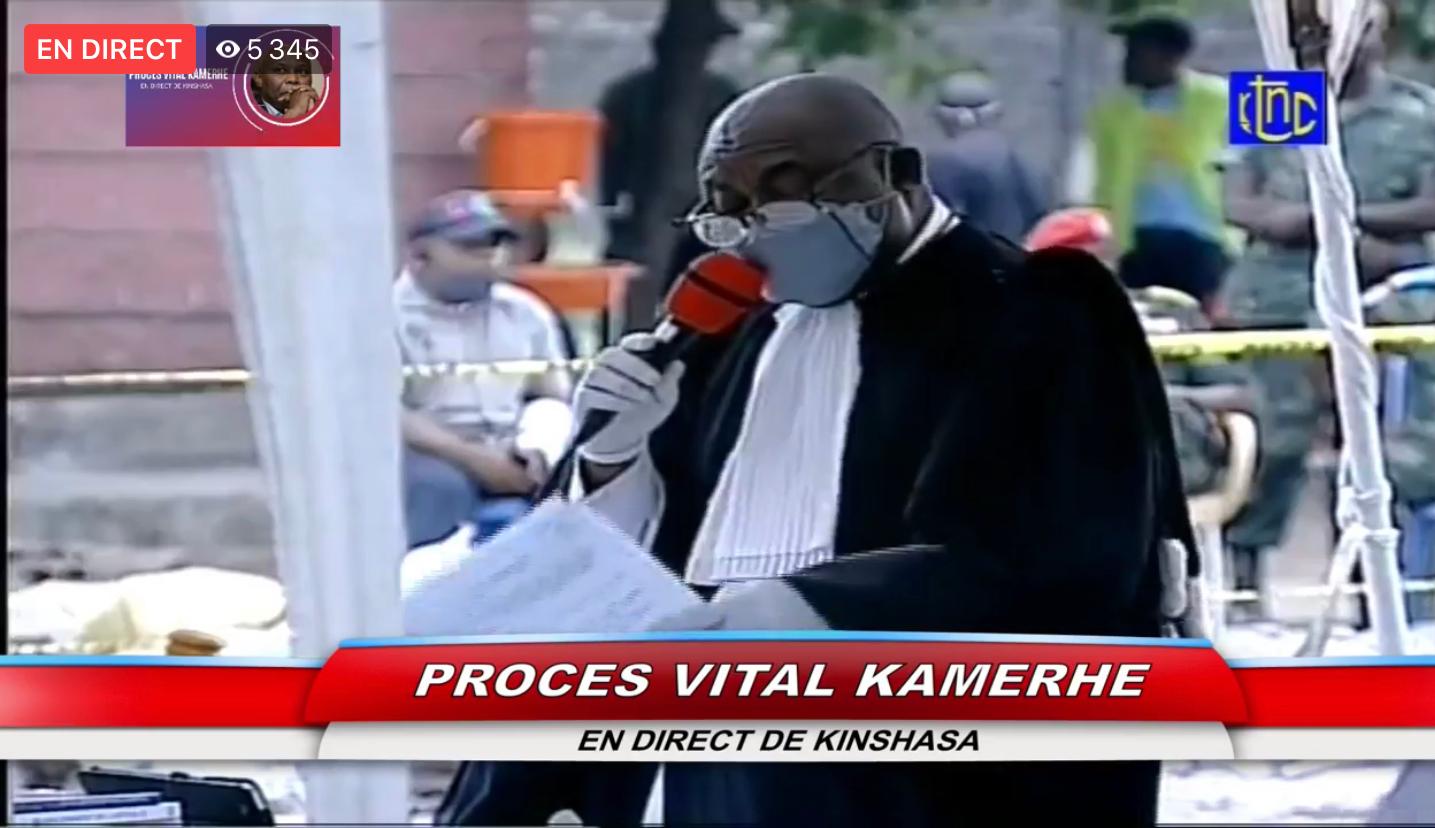Qu’il soit compris et retenu de prime abord que la Constitution garantit la publicité des audiences des cours et tribunaux. De ce fait, ce n’est ni par faveur ni par exigence d’une des parties que des citoyens soient autorisés à accéder à un palais de justice ou à n’importe quel lieu pour y suivre le déroulement d’un procès. L’article 20 de la Constitution dispose que « Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos. » Il en résulte que la retransmission en direct à la télévision d’un procès n’est qu’une modalité logistique de renforcement du caractère public de ces audiences.
A la faveur du confinement consécutif à la crise sanitaire du coronavirus, les regards des Congolais du pays et de la diaspora sont restés fixés sur leurs petits écrans pour suivre en direct le procès qui se déroulait à la prison centrale de Makala mettant en cause Vital Kamehre et Sammih Jamal. En effet, pour la première fois depuis des dizaines d’années, le Pouvoir judiciaire a volé la vedette à toutes les activités habituellement retransmises à la télévision mais généralement abrutissantes. En lieu et place de la politique politicienne, de la musique avilissante et des théâtres abrutissants et non instructifs ou du spiritualisme commercial, le peuple congolais a pris goût à une saine activité présentée par une institution jusque-là négligée, en tout cas laissée pour compte. L’activité, c’est celle de juger et l’institution, c’est le Pouvoir judiciaire.
A travers des questions que des amis ne cessent de nous poser, nous avons perçu la soif d’un peuple congolais tenant à découvrir le rôle et la différence entre les magistrats du parquet (qui composent le ministère public) et ceux du siège (appelés juges) mais aussi les différentes étapes d’un procès pénal. Durant les quatre jours d’audiences qu’a duré l’instruction du dossier, beaucoup de détails importants ont échappé à l’opinion publique, quotidiennement désinformée et désorientée par des chroniqueurs judiciaires non qualifiés qui ignorent tout de la technicité et des méandres judiciaires mais qui se font considérer comme des connaisseurs. En attendant que peu à peu l’opinion publique se familiarise avec ce genre de procédure, ce procès nous offre l’occasion d’apporter des précisions sur certaines notions techniques et de revenir sur certaines autres pouvant permettre à la population de mieux découvrir l’institution judiciaire et les activités de ses animateurs que sont les magistrats. Il s’agit pour ce procès de la composition du tribunal et du remplacement d’un juge décédé ou empêché, de l’unicité du ministère public, du traitement des dépositions des témoins, des plaidoiries, du délibéré et de l’indépendance du pouvoir judiciaire ainsi que des voies de recours.
Les Congolais à la découverte du Pouvoir judiciaire et des juges
Hormis les « abonnés » ou les habitués des palais de justice, il est rare que le Congolais moyen, instruit ou pas, s’intéresse au rôle du pouvoir judiciaire dans notre pays ni cherche à savoir en quoi consistent les activités réelles des magistrats. Jusqu’il y a quelques semaines, le Pouvoir judiciaire n’était pour bon nombre de citoyens qu’un instrument de répression entre les mains des tenants du pouvoir ou de règlements des comptes en faveur des plus forts, financièrement parlant. D’où il n’y avait aucun intérêt à faire cette distinction entre les magistrats du parquet et ceux du siège(les juges), tous considérés comme des corrompus faisant le même job.
Grâce au procès Kamehre, l’opinion publique découvre presque subitement qu’il existe une autre institution qui incarne aussi la puissance publique, un pouvoir redoutable animé par des professionnels agissant souvent dans l’ombre sans possibilité de faire parler d’eux à la télévision ni dans les autres médias. Pourtant des procès se tiennent tous les jours sur tout le territoire de la République sans que cela suscite autant d’attention et d’intérêt. Tout simplement parce que cette fois, un supposé « intouchable », parmi ceux qui font la vedette en politique, à la télévision et dans les médias est tenu à la gorge par de « petits juges » envers qui personne ne pouvait avoir égard il y a quelques mois. C’est alors que les Congolais découvrent non seulement que le Pouvoir judiciaire est un maillon incontournable de la démocratie et de l’état de droit, mais qu’il incarne les attributs de la puissance publique et que devant ses représentants que sont les magistrats, toutes ces vedettes politiques sont aussi vulnérables que le commun des mortels. L’égalité de tous devant la loi (article 12 de la Constitution), considérée jusque-là comme une fiction juridique, commence à revêtir les apparences d’une réalité. Désormais, des plaintes contre des autorités sont déposées, certaines plus audacieuses que d’autres[1], sur les bureaux des procureurs. Lors de ce procès, tous les congolais ont surtout constaté que peu importe leur rang dans la société et dans les autres institutions, tous les prévenus et les témoins, qui se font habituellement appeler « Excellences et Honorables » s’adressaient au juge président avec beaucoup de respect sous la formule « Votre honneur ». Au Canada, ce sont d’ailleurs les juges qu’on appelle Honorables.
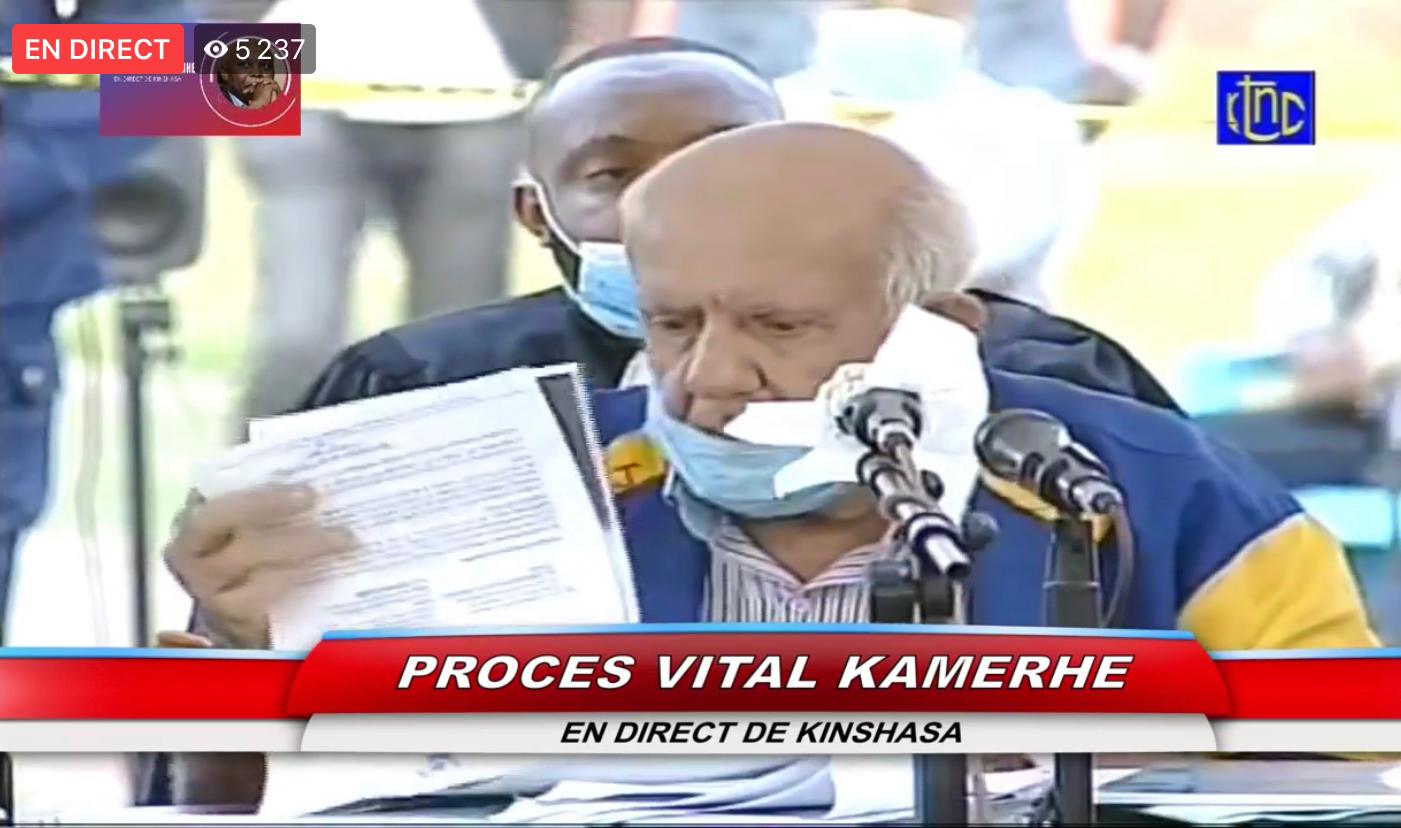
Combien de juges faut-il pour une composition régulière ?
Dans tout procès, le terme composition se confond souvent avec le tribunal mais désigne le nombre de juges choisis par le président de la juridiction (tribunal ou cour) pour siéger dans une affaire donnée. On parle ainsi de chambres. Selon l’importance du ressort et le volume des affaires qui y sont traités, un tribunal peut compter jusqu’à trente juges ou plus et donc plusieurs chambres. La composition régulière du tribunal de grande instance, comme celui qui juge Vital Kamerhe et consorts, ne peut pas être inférieure ni supérieure à trois juges, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire.
Article 15
Le Tribunal de grande instance est composé d’un président et des juges.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien, d’après la date et l’ordre de nominations.
Article 16
Le Tribunal de grande instance siège au nombre de trois juges. Dans le cas où l’effectif des juges du tribunal de grande instance présents au lieu où le Tribunal tient une audience ne permet pas de composer le siège, le Président du Tribunal peut assumer, au titre de juge, sur réquisition motivée du Procureur de la République, un magistrat du Parquet près le tribunal de grande instance, un avocat ou un défenseur judiciaire résidant en ce lieu ou un magistrat militaire du tribunal militaire de garnison ou du parquet militaire près cette juridiction.
A l’intention de l’opinion publique, le juge Yanyi, décédé dans les circonstances à élucider et le juge Bakenge qui l’a remplacé, étaient tous deux des juges du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe. Contrairement à ce que des apprentis sorciers ont fait circuler sur les réseaux sociaux, le remplacement du juge Yanyi s’est fait au sein du même tribunal. Autant le juge décédé a été découvert et adopté par le peuple congolais à l’issue de deux jours seulement d’audiences, autant le juge Bakenge a su démontrer, comme nous n’avons cessé de l’affirmer, qu’il existe encore au Congo un noyau de magistrats sur lequel on peut compter pour rebâtir le Pouvoir judiciaire qui est réellement au fond de l’abîme, techniquement et déontologiquement. L’un et l’autre ont étonné le public aussi bien par leurs connaissances de la matière et de la procédure que par leur expérience et leur autorité dans la façon d’assurer la police les débats. Bravo à eux et paix à l’âme du juge Yanyi !
L’unicité et l’indivisibilité du ministère public
Bien que ce procès se déroule au tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, le magistrat du parquet qui représente le ministère public vient du Parquet général près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, un avocat général, grade immédiatement inférieur à celui de Procureur général près la Cour d’appel. Si, pour remplacer le juge décédé on ne pouvait désigner qu’un de ses collègues du même tribunal, il n’en est pas ainsi du ministère public qui est un et indivisible. Cela signifie que pour un procès pénal se déroulant au tribunal de grande instance, un magistrat du parquet général près la Cour de cassation peut valablement siéger et y remplir tous les devoirs d’instruction et de réquisition, conformément Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire
Article 72
« Le Procureur général près la Cour de cassation exerce les fonctions du Ministère Public près cette juridiction, en ce compris l’action publique.
Il peut cependant, sur injonction du Ministre de la justice :
– initier ou continuer toute instruction préparatoire portant sur des faits infractionnels qui ne ressortent pas de la compétence de la Cour de cassation.
– requérir et soutenir l’action publique devant tous les Cours et Tribunaux à tous les niveaux.
Il peut également, sur injonction du Ministre de la justice, ou d’office et pour l’exécution des mêmes devoirs faire injonction aux Procureurs généraux près la Cour d’appel. »
Les téléspectateurs et les internautes attentifs ont sans doute pu remarquer que lorsque les avocats de la défense demandaient la parole pour le contredire ou pour toute autre observation, ils l’appelaient avocat général alors qu’en principe c’est un Substitut ou un Premier substitut du Procureur de la République qui aurait pu siéger.
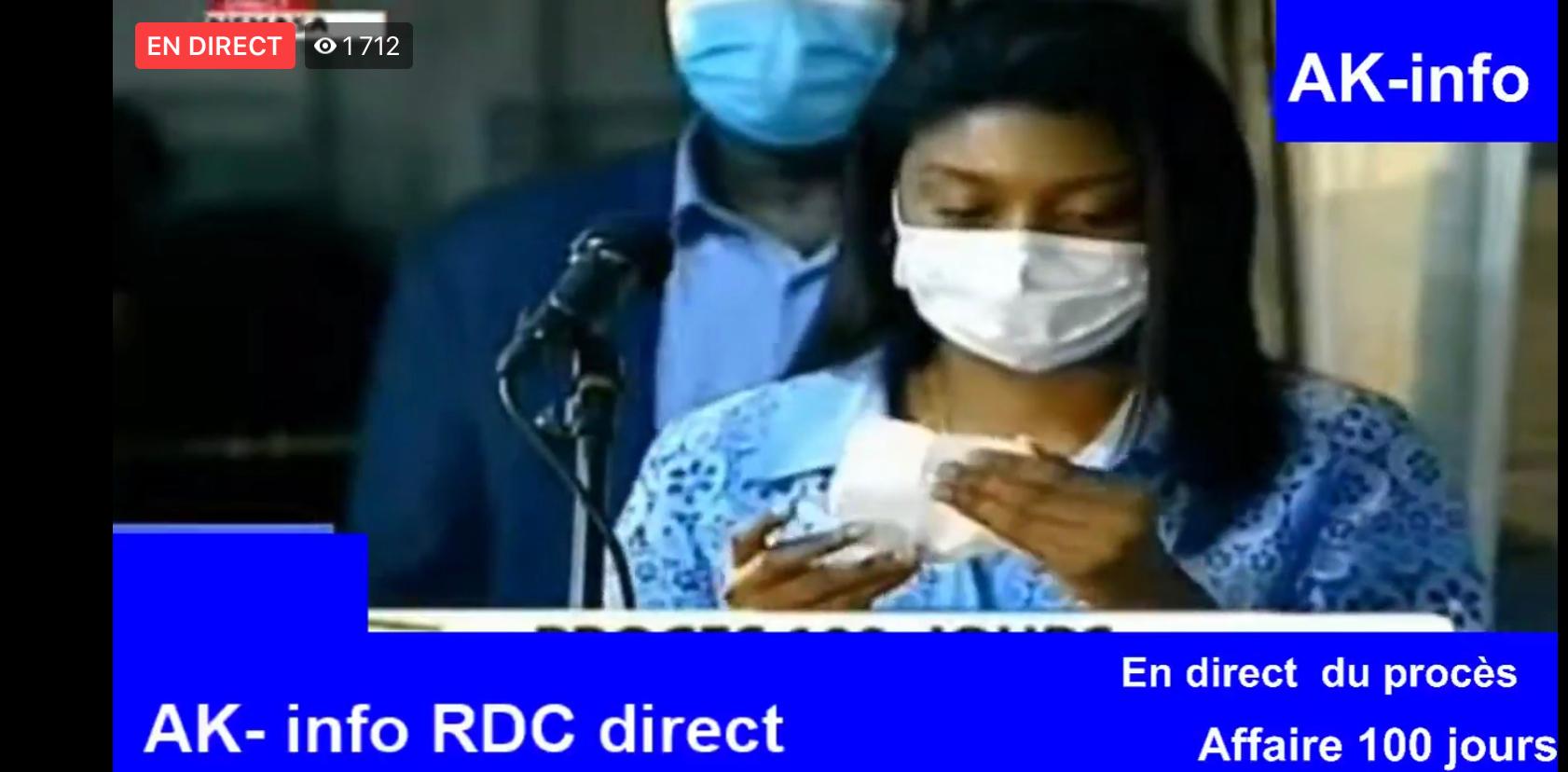
La comparution et les dépositions des témoins
La journée du 4 juin 2020 a été la plus attendue par les téléspectateurs et les internautes en raison du fait que le calendrier de ce jour-là prévoyait d’écouter ce qu’allaient dire les témoins invités à la barre, en faveur ou en défaveur des prévenus. Certains témoins, à charge ou à décharge, ont cru que le caractère public et la retransmission en direct de cette audience leur donnait l’opportunité de théâtraliser leurs dépositions ou de se mettre en vedette ne sachant pas pourquoi ils étaient cités ni encore qu’est ce que le tribunal et le ministère public recherchaient réellement à travers des questions apparemment banales mais qui devaient éclairer la religion du tribunal. Ainsi, des témoins[2] venus juste pour réciter machinalement ce qui avait été déjà conçu et concerté hors du prétoire, ont imprudemment et inconsciemment étalé leurs fortunes, facilitant la tâche au ministère public de vérifier la licéité et l’origine de ces fortunes en rapport avec la complicité mise à charge des prévenus. Pas surprenant pour les juges, habitués à déceler chez des témoins motivés la fragilité et l’inconsistance de leurs dépositions et que d’autres témoins pourraient les contredire et les embarrasser. Mais ce procès et cette audience, spécialement, ont surtout permis à l’opinion publique et même au Président de la République de se rendre compte des dysfonctionnements des certains services et des institutions jusqu’au sommet de l’État. De mémoire de juriste et de juge, c’est la première fois de voir un conservateur des titres immobiliers témoigner sans scrupules qu’il avait délivré un certificat d’enregistrement portant sur un terrain nu (non encore mis en valeur), donc ne se rapportant pas à un contrat de concession perpétuelle comme l’exige la loi et ce, en faveur d’une personne non représentée valablement. De même c’était gênant d’entendre un témoin, conseiller à la présidence de la République, vanter ses relations privilégiés avec le Chef de l’État de sorte que pour faire parvenir ses rapports à ce dernier, il n’est pas tenu de suivre la voie administrative.

C’est en fait aussi un procès qui révèle des pratiques qui ne concourent pas à la bonne marche de l’État. En effet, il n’est pas normal qu’au sein de l’institution suprême du pays, puissent se dresser des camps ou clans hostiles les uns aux autres feignant de travailler pour l’intérêt public alors qu’en coulisse, ils ont des agendas cachés et plutôt partisans, ethniques, familiaux ou personnels. Grâce à la médiatisation de ce procès et quelle qu’en puisse être son issue, l’opinion publique a compris comme nous pourquoi on déplore aujourd’hui ce qui est arrivé et pourquoi aussi il est légitime que dans l’intérêt supérieur de la nation, l’on exige au Chef de l’État de remanier urgemment son cabinet non seulement en le réduisant mais surtout en s’entourant des personnes très crédibles, techniquement et moralement. Dans la gestion moderne des ressources humaines, le diplôme seul ne suffit plus, il faut en plus faire preuve d’un sens élevé de discrétion pour certaines fonctions ou pour certains services. La compétence au sens moderne du terme englobe le savoir, le savoir-faire et le savoir-être.
Le réquisitoire du ministère public et les plaidoiries de la défense
Des commentaires en sens divers circulent déjà sur les réseaux sociaux ou dans les différents organes de presse, à travers lesquels et selon les penchants d’appartenance, qui indiquent l’empressement pour l’opinion publique de connaître déjà la tendance du procès : acquittement ou condamnation des prévenus. Lors des procès répressifs, comme celui-ci, l’on attend même des gens considérer le réquisitoire du ministère comme déjà la condamnation. Il est l’aboutissement même de l’action publique, un exercice hautement intellectuel par lequel le parquet doit démontrer que les faits mis à charge des prévenus ont été effectivement commis par eux, à telle date, dans telle intention et suivant tel mode opératoire et si tous les éléments sont réunis, conformément à la loi, pour dire établies les infractions retenues. L’audience sera tellement intéressante pour les téléspectateurs et les internautes qui la suivront car ils assisteront, même sans beaucoup comprendre la plupart des termes techniques qui seront utilisés, à un combat « des gladiateurs » juridique entre le ministère public et les avocats de la défense. Dans ce genre de joute oratoire, il faut convaincre le tribunal non pas en parlant avec beaucoup ou impressionnant les profanes par son éloquence mais plutôt par des arguments de droit se rapportant aux faits de la cause. Tout ce qui sera dit et tout ce qui consigné par écrit (réquisitoire ou plaidoirie) devra démontrer en faits et en droit que les infractions sont établies ou ne le sont. Viendra alors la clôture des débats suivie par un temps mort dont la durée sera annoncée par le tribunal, suivant le volume du dossier, pour revenir prononcer publiquement le jugement. Ce temps mort sera consacré au délibéré des juges.
Le secret du délibéré et la problématique de l’indépendance de la magistrature
Le temps mort que constateront ceux qui s’intéressent à ce procès est celui que les juges consacreront chacun à la relecture du dossier et à l’examen minutieux non seulement de toutes les pièces, mais surtout des moyens de droit soulevés par chacune des parties afin de rendre un jugement solidement motivé, hors de tout doute raisonnable.
Dans le contexte congolais, c’est malheureusement le mauvais temps que traversent les juges, abondamment sollicités et harcelés de toutes parts aussi bien dans l’intérêt que contre les prévenus. Ce mauvais temps peut être caractérisé par :
– des visites indésirables des collègues, amis, membres de la même origine qu’une partie au procès, venus plaider l’acquittement ou la réduction de la peine moyennant une cagnotte, il peut s’agir aussi de ceux qui viennent solliciter la condamnation du prévenu – des messages courtois et discrets de la hiérarchie cherchant à rendre l’ascenseur au prévenu pour une promotion obtenue en son temps grâce à sa recommandation[3] ;
– un ordre d’une autre hiérarchie poliment transmis sous forme d’une assistance technique avec quelques moyens de droit ou une jurisprudence pas toujours adaptée ;
– un ordre dissimulant une menace ou un chantage d’une autorité politique ou des services de renseignements ;
– une visite ou un appel d’un avocat du prévenu demandant ou proposant aux juges des espèces sonnantes et trébuchantes ou, actuellement un cadeau mobilier ou immobilier de grande valeur. Dans certains cas, lorsque ces intervenants indésirables constatent qu’un la résistance d’un membre de la composition, ils s’emploient à l’isoler en le rendant minoritaire par la motivation de ses collègues.
Article 41
Les délibérés sont secrets.
Le juge le moins ancien du rang le moins élevé donne son avis le premier ; le président le dernier.
Article 42
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, en matière répressive, s’il se forme plus de deux opinions dans le délibéré le juge qui a émis l’opinion la moins favorable au prévenu est tenu de se rallier à l’une des deux autres opinions.
En matière de droit privé, s’il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien, du rang le moins élevé est tenu de se rallier à l’une des deux autres opinions
Pour toutes ces démarches, l’on se renseigne toujours, déjà par l’entremise des greffiers du tribunal, pour connaître les forces et les faiblesses de chaque membre de la composition en commençant par le juge président afin d’orienter le délibéré. Rien n’étant laissé au hasard, l’on va chercher même à recenser et à identifier toutes les relations utiles des juges afin de les mettre à contribution moyennant une rétribution en leur faveur si elles arrivent à établir le contact. L’opinion publique doit le savoir, c’est là que le juge congolais est mis devant ses responsabilités face à sa vocation, à l’avenir de sa carrière, à sa conscience, à son éducation, à son honneur, à son intégrité physique et aux attentes de tout un peuple dans un dossier hypermédiatisé comme celui de Vital Kamerhe et consorts. Plutôt que de surprendre, ces pratiques devraient attirer l’attention du peuple congolais sur l’environnement sociopolitique dans lequel vivent ses fils et ses filles qui ont reçu mission de dire le droit. Nous avions aussi été soumis à ce genre de pression, de stress et de torture morale à une époque où l’on ne pouvait pas retransmettre en direct des procès impliquant des acteurs politiques. Mais nous y avions survécu physiquement et déontologiquement forçant l’admiration et le respect de ceux-là même qui croyaient nous intimider ou nous influencer.
C’est surtout durant cette période cruciale qu’il faudrait veiller à renforcer la sécurité et la protection des juges.
Il convient ici de rappeler que dans l’affaire M. Katumbi, un dossier véritablement politique aux allures pénales, deux juges de Lubumbashi vivent aujourd’hui en exil. « Quand le juge de République démocratique du Congo Jacques Mbuyi a pris cinq balles dans l’abdomen, sa collègue Chantal Ramazani, réfugiée en France, n’a pas été surprise. Tous les deux avaient hérité du dossier de l’opposant Moïse Katumbi. Après l’attentat qui l’a visé en juillet 2017 à Lubumbashi (sud-est), le magistrat est resté longtemps entre la vie et la mort. Il vient enfin de sortir d’un hôpital sud-africain. Un « miracle » et une « résurrection », confie à l’AFP Jacques Mbuyi. Lui et sa collègue partagent désormais, l’un à Paris l’autre à Johannesburg, un même destin. Exilés, ils accusent le régime du président congolais Joseph Kabila d’instrumentaliser la justice pour faire taire ses adversaires politiques. »[4]
Aujourd’hui les choses ont radicalement changé. De la violence physique ou des menaces que les services de sécurité utilisaient parfois pour intimider, de nouvelles méthodes ont vu le jour consistant à imposer à un juge récalcitrant, entendez inabordable ou incorruptible, un silence éternel. Le décès inattendu du Juge Raphaël Yanyi continuera d’intriguer jusqu’à ce que toute la lumière soit faite.
De possibles voies de recours
Tout le monde garde son souffle et attend avec empressement le sort qui sera réservé aux prévenus Kamerhe et Jamal. Cependant, l’opinion publique doit être préparée à ce que le jugement qui sera prononcé ne mettra pas nécessairement fin à cette affaire. Il suffit de voir avec quelle ténacité le prévenu Kamerhe a multiplié les demandes de mise en liberté provisoire pour comprendre qu’en cas de condamnation, il ne manquera pas d’exercer ses voies de recours, en commençant par l’appel, jusqu’en cassation. En effet, non seulement qu’il n’a pas abandonné ses ambitions présidentialistes pour 2023, avec son épouse Shatur il n’en était encore presqu’au début de la consommation de leur idylle. S’il est acquitté, le ministère public est également en droit d’exercer les mêmes voies de recours. Ce ne sera qu’après toutes ces procédures, si elles ont lieu, qu’on parlera du jugement définitif ou coulé en force de chose jugée.
Conclusion
A l’actif du nouveau régime, mieux du nouveau Président de la République, le peuple congolais est entrain de suivre un procès impliquant un gros poisson, le directeur de Cabinet du Chef de l’État. Du coup, il découvre que non seulement n’importe qui peut être poursuivi en justice mais que surtout, comme une nouvelle étoile, l’institution Pouvoir judiciaire est celle qui a le pouvoir de réguler les comportements de tous les citoyens et de moraliser la vie publique. Les téléspectateurs et les internautes congolais éparpillés sur toute la planète se rendent également compte qu’en dépit de tous les maux qu’on est en droit de reprocher aux magistrats, il en existe encore qui sortent du lot par leurs connaissances de la matière et par leur autorité face à des vedettes de la politique et du monde des affaires. Tous les meilleurs magistrats devraient se manifester ou suivre l’exemple des juges Raphaël Yanyi et Pierrot Bakenge pour entretenir cette ambiance de confiance qui est entrain de renaître. Au peuple congolais, au nom duquel la justice est rendue, le moment est venu d’encourager et de soutenir le Pouvoir judiciaire contre les démons de l’impunité qui se cachent dans d’autres institutions et qui voient dans l’indépendance de la magistrature une sérieuse menace à leurs intérêts. Quant au Chef de l’État, il ne doit pas se laisser piéger par le Ministre de la justice et les députés nationaux qui proposent qu’il soit membre du Conseil supérieur de la magistrature. L’alinéa 2 de l’article 7 de la Loi organique n° 08/013 du 05 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature lui attribue déjà un droit de regard sur les résolutions de l’Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature et ça lui suffit : « L’Assemblée générale examine les dossiers des magistrats en vue de leur nomination, promotion, démission, mise à la retraite, révocation et, le cas échéant, de leur réhabilitation.
Les propositions y relatives sont transmises au Président de la République qui, endéans les trente jours de leur réception, peut formuler des observations au Conseil supérieur de la magistrature.
Elle adopte l’avant projet du budget du pouvoir judiciaire. »
Jean-Bosco Kongolo Mulangaluend
Juriste & Criminologue / Administrateur adjoint de DESC
 Monsieur Jean-Bosco Kongolo Mulangaluend est licencié (master) en droit de l’Université de Kinshasa. Il est détenteur d’un diplôme de criminologie à l’université de Montréal et d’un diplôme des Relations industrielles et gestion des ressources humaines à l’université du Québec en Outaouais, au Canada. Jean-Bosco Kongolo a assumé les fonctions de chef de bureau des aiffaires sociales à l’Institut National de Statistiques (INS) en RDC. Il a ensuite entamé une riche carrière professionnelle dans la magistrature congolaise. Il a été successivement substitut du Procureur de la République, juge de grande instance, Président du tribunal de paix et Conseiller de Cour d’appel. Il a fini par démissionner volontairement de la magistrature pour éviter de se mêler aux antivaleurs et à la corruption qui gangrènent la justice congolaise.
Monsieur Jean-Bosco Kongolo Mulangaluend est licencié (master) en droit de l’Université de Kinshasa. Il est détenteur d’un diplôme de criminologie à l’université de Montréal et d’un diplôme des Relations industrielles et gestion des ressources humaines à l’université du Québec en Outaouais, au Canada. Jean-Bosco Kongolo a assumé les fonctions de chef de bureau des aiffaires sociales à l’Institut National de Statistiques (INS) en RDC. Il a ensuite entamé une riche carrière professionnelle dans la magistrature congolaise. Il a été successivement substitut du Procureur de la République, juge de grande instance, Président du tribunal de paix et Conseiller de Cour d’appel. Il a fini par démissionner volontairement de la magistrature pour éviter de se mêler aux antivaleurs et à la corruption qui gangrènent la justice congolaise.
Texte discuté (avec) et relu par Jean-Jacques Wondo / Criminologue
Références
[1] Cas de la plainte du Pasteur Mukuna contre l’ancien Chef de l’État Joseph Kabila ou encore celle de la Sénatrice Bijoux Goya contre le Président du Sénat Alexis Thambwe Mwamba.
[2] Amida Shatur et Shangalume Massaro.
[3] Au Congo, la plupart des promotions et des nominations des autorités judiciaires sont négociées hors du Conseil supérieur de la magistrature, dans des cercles politiques ou ethniques.
[4] Voaafrique.com, In https://www.voaafrique.com/a/en-exil-des-juges-congolais-d%C3%A9noncent-le-syst%C3%A8me-kabila-contre-l-opposant-katumbi/4453264.html.