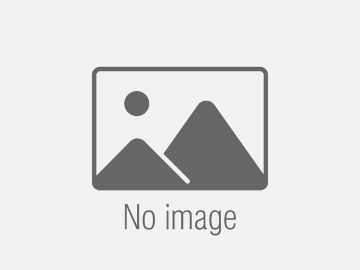Auteure d’un ouvrage sans concession mais tout en rigueur sur la nature réelle du régime de Paul Kagamé-le satrape de facto à la tête du Rwanda depuis 1994-après tant d’autres, la journaliste britannique Michela Wrong est devenue la cible des calomnies de Kigali. Elle dénonce ici les méthodes d’intimidation et de menaces qu’utilisent les sbires et admirateurs du dictateur, en Belgique comme en France où il dispose par ailleurs de nombreux relais dans la presse.
Après des semaines de voyage – d’abord Paris, puis Kinshasa et Bruxelles –, j’attendais avec impatience cette soirée à L’Horloge du Sud. Ce restaurant, réputé pour son liboké (du poisson cuit dans une feuille de bananier) et d’autres spécialités, est très apprécié de la diaspora africaine locale en Belgique. J’avais été invitée par un think tank panafricain, afin de présenter mon dernier ouvrage sur le Rwanda. Les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu. La veille, le journaliste béninois qui devait animer la rencontre m’a contactée par téléphone. Il semblait ébranlé. Le propriétaire du restaurant, m’a-t-il expliqué, avait reçu des plaintes de la part de groupes rwandais pro-gouvernement basés à Bruxelles, des courriels de menace et des appels anonymes en provenance du Rwanda. La structure qu’il représentait encourageait le propriétaire à tenir bon, mais jamais, malgré tous les événements polémiques organisés, ils n’avaient connu un tel degré d’intimidation. « Expliquez-lui que c’est comme ça que les dictatures empêchent le débat, ai-je répondu. Beaucoup de gouvernements africains agissent de la sorte ». « Vous ne comprenez pas ! s’est emporté mon potentiel hôte. Ils vous accusent d’être une négationniste notoire. Ils menacent de poursuivre le propriétaire en justice et se disent prêts à tout casser ».
Ah oui, le « négationnisme ». En théorie, c’est un crime au regard de la loi belge. Ayant couvert le Rwanda en 1994, j’ai parcouru des églises et des salles de classe, dans lesquelles des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants avaient été massacrés à coups de machette. L’idée de nier l’existence du génocide ne m’a donc jamais traversé l’esprit. J’ai vu les corps. Les mauvais jours, je sens encore l’odeur de putréfaction. Pourquoi diable irais-je remettre en question un événement sur lequel j’ai autrefois écrit ? Mais là n’est pas le problème : « négationniste » est devenu un terme de prédilection au Front patriotique rwandais (FPR), le parti au pouvoir, pour désigner toute personne qui ose critiquer le président Paul Kagame. Je ne suis pas la seule à être calomniée de façon aussi surréaliste. C’est également le sort de respectables universitaires ou journalistes et, plus grotesque encore, de membres de la minorité tutsi, dont les familles ont été prises pour cible et éliminées par les miliciens hutus et les soldats de l’armée rwandaise, à l’époque. J’ose à peine imaginer ce que doit ressentir un Tutsi ayant perdu des proches en 1994, en s’entendant être ainsi diffamé pour avoir exprimé ses inquiétudes face à l’autoritarisme grandissant de Kagame.
Pas de débat contradictoire
La situation ne manquait pas d’ironie. Mon livre – qui vient d’être traduit en français – se concentre sur le palmarès de Paul Kagame en matière de « répression transnationale » après le génocide : le ciblage systématique des dissidents, journalistes et militants des droits de l’homme rwandais qui ont fui le pays. Une croisade qui va du simple harcèlement sur les réseaux sociaux à l’assassinat commandité. À chaque appel anonyme et chaque tweet me dénonçant comme une « nazie tropicale », le régime de Kigali ne fait pourtant que confirmer la thèse centrale de mon livre. Plus étrange encore, il tente de réduire au silence une reporter britannique, au moment même où, au Royaume-Uni, l’accord du ministère de l’Intérieur visant à expédier les demandeurs d’asile indésirables au Rwanda est contesté devant la cour d’appel : le timing est pour le moins maladroit.
À vrai dire, la subtilité n’a jamais été le fort de Paul Kagame ni du FPR. Et lorsqu’il s’agit d’empêcher la tenue d’événements, ils n’ont pas froid aux yeux. En avril, le lancement de mon livre prévu par mon éditeur français à Paris a d’abord été annulé, après que la direction de l’hôtel censé accueillir la réception a soudain décrété qu’elle n’était pas en mesure de garantir la sécurité. En mai 2022, l’Institute for Security Studies (ISS) avait décommandé un séminaire en Afrique du Sud, huit heures seulement avant le début, à la suite de plaintes déposées par des officiels rwandais. L’ISS est l’un des rares groupes de réflexion indépendants du continent africain et son directeur général – un homme dont on peut penser qu’il est très attaché à la liberté d’expression – m’avait alors promis que l’événement serait reprogrammé, dès que les Rwandais auraient identifié quelqu’un disposé à me rejoindre à la tribune. Surprise, surprise, aucun nom n’a jamais été suggéré depuis.
Et c’est bien là le problème. Les dictatures ont beau afficher une assurance intellectuelle – et il est difficile de surpasser Kagame et ses ministres en matière de confiance et d’arrogance –, elles sont allergiques à toute forme de défiance. Comme s’en est émerveillé le professeur Filip Reyntjens (un expert du Rwanda, lui aussi « négationniste », bien sûr) sur Twitter : « C’est bizarre qu’aucun partisan inkotanyi du FPR, rwandais ou autre, n’ose s’engager dans un débat contradictoire. Ils se dégonflent tous, les uns après les autres, sans exception ».
Intimidation banale
Comme on pouvait s’y attendre, le propriétaire de l’Horloge du Sud a décidé que c’en était trop. Une photo triomphale a circulé sur les réseaux sociaux, mon visage barré des mots « annulé pour cause de négationnisme ». Toutefois, le groupe de réflexion du Conseil panafricain de Belgique a réagi avec brio et a rapidement annoncé que l’événement aurait finalement lieu dans une autre salle, à l’autre bout de Bruxelles. Il s’agissait d’un leurre. Un organisateur togolais est resté sur place pour rediriger les arrivants vers le nouveau point de ralliement, où une équipe de trois hommes – un Togolais, un Congolais et un Guinéen – filtraient avec courtoisie les invités sur le trottoir, avant de leur indiquer l’adresse exacte, située à proximité.
Nous avons fait salle comble et les exemplaires de mon livre se sont tous vendus. À la fin, j’ai demandé à Olivier Dossou, le président, si les vigiles volontaires avaient refoulé d’éventuels saboteurs. « Nous pensons qu’il y en a eu trois. Ils avaient l’air rwandais, ils cherchaient la « célèbre négationniste », avec beaucoup d’insistance. Trop même. » La prochaine fois qu’ils programmeraient un événement rwandais, m’a-t-il assuré, ils seraient prêts. Le plus choquant, c’est que cette intimidation soit pratiquée de manière tout à fait banale à l’étranger, pays après pays, par un régime africain dépendant fortement de l’aide et de la philanthropie internationale. En exploitant une législation européenne élaborée, à l’origine, dans le but bien intentionné de proscrire le racisme et la xénophobie, le Rwanda tente d’imposer sa vision dans tous les États où il dispose d’une diaspora et d’une ambassade. Trop souvent, cela fonctionne. Si Suella Braverman, la secrétaire d’État britannique à l’Intérieur, obtient gain de cause et que la cour d’appel confirme la légalité du projet rwandais en matière d’immigration, alors des centaines de personnes fuyant des persécutions politiques dans des pays tels que l’Irak, l’Afghanistan, l’Érythrée pourraient en théorie être bientôt dirigées vers le Rwanda. On croit rêver.